Gregoire Chamayou
Dans la tete de la NSA
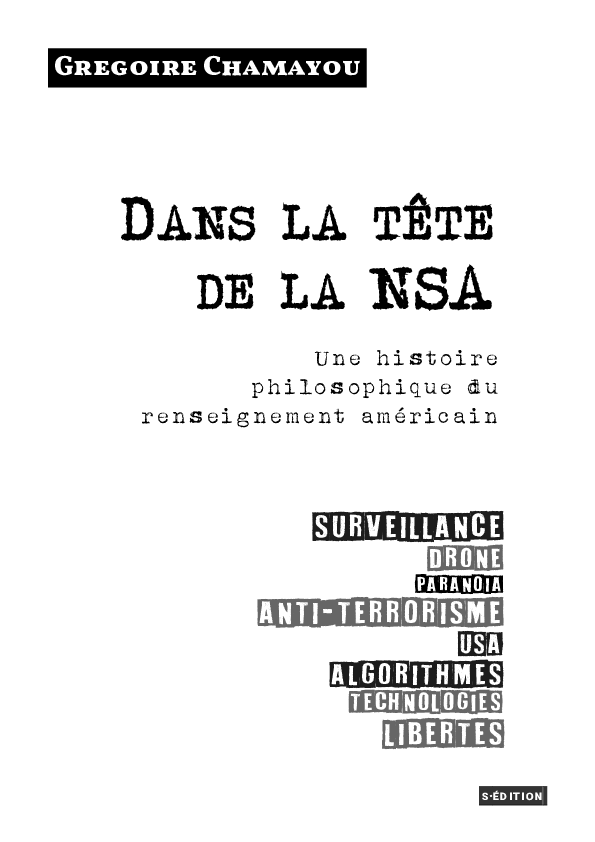
En exposant les secrets de la NSA, Edward Snowden a révélé les méthodes du renseignement américain. Il restait cependant à en montrer les motivations réelles et l’idéologie sous-jacente. Bienvenue dans un monde où nous sommes tous devenus des sous-marins soviétiques, mais où le fantasme d’une NSA capable de tout collecter et surtout de tout analyser est tout simplement faux.
Temps de lecture : ~ 42 minutes
Gunther Anders
De l'entreprise capitaliste a l'entreprise nazie

Ce texte est un extrait du livre L’Obsolescence de l’homme. Sur l’âme à l’époque de la deuxième révolution industrielle, initialement paru en 1956 (traduction française publiée en 2002 par les éditions de l’Encyclopédie des Nuisances/Ivrea). Gunther Anders y expose en quoi les abominables crimes des nazis ont été rendus possibles et même favorisés par le fonctionnement général du capitalisme (qui, de la même manière, pour la même raison, génère en permanence toutes sortes de désastres sociaux et écologiques). Günther Anders (1902 – 1992) est un penseur, journaliste et essayiste allemand puis autrichien Ancien élève de Husserl et Heidegger et premier époux de Hannah Arendt, il est connu pour être un critique de la technologie important et un auteur pionnier du mouvement antinucléaire. Le principal sujet de ses écrits est la destruction de l’humanité.
Temps de lecture : ~ 11 minutes
Quadrupanni et Floch
Pourquoi les flics sont-ils tous des bâtards
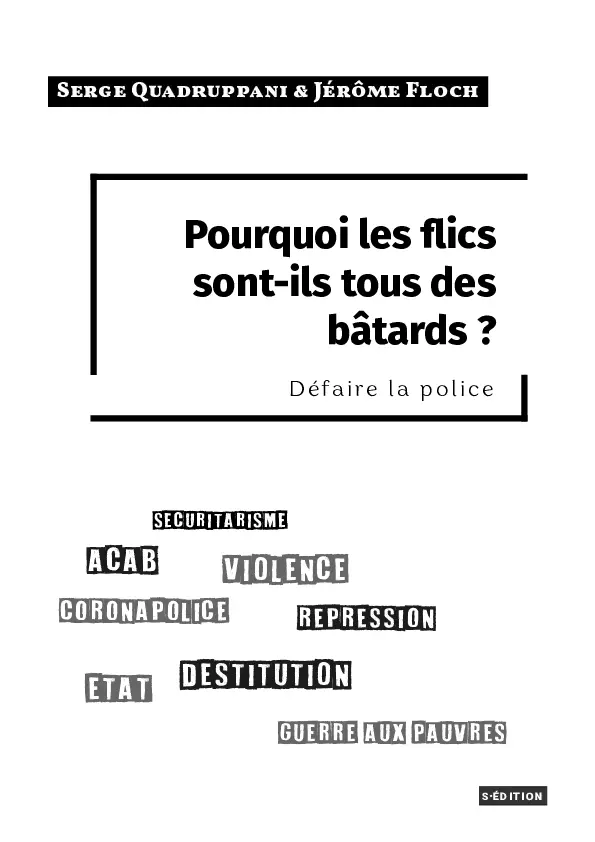
« Le policier n’est ni un guerrier ni un mafieux : le bénéfice de la violence qu’il prodigue au jour le jour ne lui revient jamais, elle est gratuite. S’il harcèle, racket ou brutalise, ce n’est jamais pour son propre intérêt, c’est parce qu’on lui commande de le faire. Les méfaits dont il doit s’acquitter quotidiennement ne répondent pas à son éthique propre mais à des idées vides, éloignées et abstraites : la violence légitime, la sécurité, la paix civile, l’ordre des choses… Il peut bien faire usage de son libre arbitre, choisir ses victimes selon ses goûts personnels, vouvoyer ou tutoyer celles et ceux qu’il contrôle mais ce que son uniforme recouvre, c’est son irresponsabilité fondamentale. La seule grandeur qui lui est accessible, c’est celle d’obéir à des ordres, sa seule liberté, c’est d’incarner à une échelle microscopique et dérisoire la raison d’État. « Mais derrière l’uniforme, il y a un être humain ! », non, ce qu’il y a c’est un sujet irresponsable de ses actes, une marionnette sans éthique, un exécutant au cœur froid. Ce qui rend la vie du policier aussi détestable, c’est la banalité et la vacuité de ce mal-là. »
Temps de lecture : ~ 36 minutes
Olivier Razac
contre l'abolitionnisme

« Après des études de philosophie à l’Université Paris 8 dans les années 90 et une période de production d’essais de philosophie politique sur des objets contemporains (le barbelé et la délimitation de l’espace, le zoo et le spectacle de la réalité, la médecine et la « grande santé »). J’ai travaillé pendant huit ans comme enseignantchercheur au sein de l’Administration Pénitentiaire. C’est dans cette institution disciplinaire que j’ai compris ce que pouvait signifier pour moi la pratique de la philosophie, c’est-à-dire une critique des rationalités de gouvernement à partir des pratiques et dans une perspective résolument anti-autoritaire. Depuis 2014, j’ai intégré l’université de Grenoble comme maître de conférences en philosophie. Je travaille sur la question de l’autorité politique, sur les notions de société du spectacle et de société du contrôle. J’essaie également de porter, avec les étudiants, des projets de philosophie appliquée déconstruisant les pratiques de pouvoir. Enfin, nous tentons de faire vivre un réseau de « philosophie plébéienne », anti-patricienne donc, mais aussi en recherche de relations avec tous nos camarades artisans de la critique sociale. » — Olivier Razac
Temps de lecture : ~ 29 minutes
Castoriadis
Autogestion et hierarchie

Cornelius Castoriadis (1922-1997) est un philosophe, économiste et psychanalyste grec, fondateur avec Claude Lefort du groupe Socialisme ou barbarie. Il consacra une grande partie de sa réflexion à la notion d'autonomie, par opposition à l'hétéronomie, constitutive selon lui des sociétés religieuses et traditionnelles, des régimes capitalistes mais aussi du régime de l'URSS. Il défendait l’idée d’une révolution en faveur de la démocratie directe et de l’auto-gestion généralisé. Une société sans Etat, ni hiérarchie d’aucune sorte. « Dans la société moderne le système hiérarchique (ou, ce qui revient à peu près au même, bureaucratique) est devenu pratiquement universel. Dès qu’il y a une activité collective quelconque, elle est organisée d’après le principe hiérarchique, et la hiérarchie du commandement et du pouvoir coïncide de plus en plus avec la hiérarchie des salaires et des revenus. De sorte que les gens n’arrivent presque plus à s’imaginer qu’il pourrait en être autrement, et qu’ils pourraient eux-mêmes être quelque chose de défini autrement que par leur place dans la pyramide hiérarchique. »
Temps de lecture : ~ 29 minutes
Gunther Anders
La fin du pacifisme
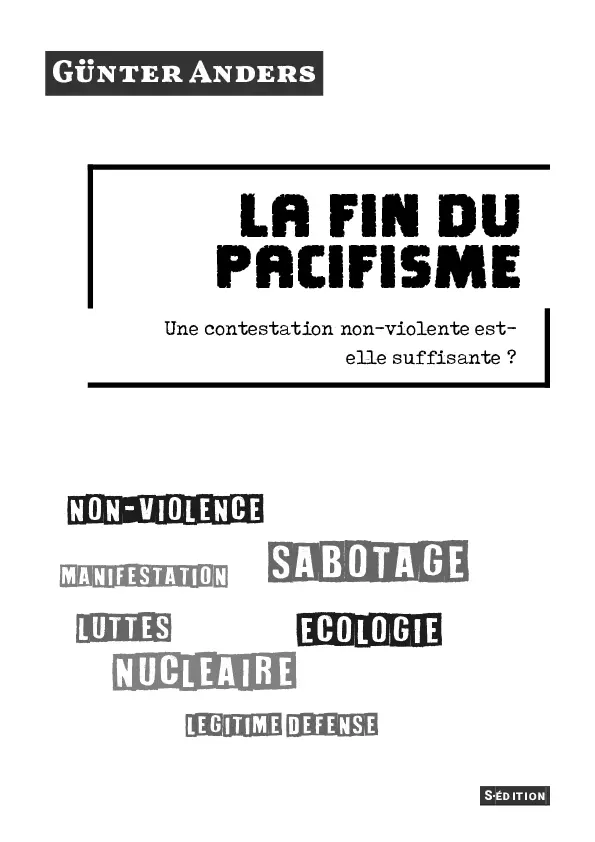
Günther Anders (né Günther Siegmund Stern) est un penseur, journaliste et essayiste allemand puis autrichien, né en 1902 à Breslau et mort à Vienne en 1992. Ancien élève de Husserl et Heidegger et premier époux de Hannah Arendt, il est connu pour être un critique de la technologie important et un auteur pionnier du mouvement antinucléaire. Le principal sujet de ses écrits est la destruction de l'humanité. Günther Anders a traité du statut de philosophe, de la Shoah, de la menace nucléaire et de l'impact des médias de masse sur notre rapport au monde, jusqu'à vouloir être considéré comme un « semeur de panique » : selon lui, « la tâche morale la plus importante aujourd'hui consiste à faire comprendre aux hommes qu'ils doivent s’inquiéter et qu'ils doivent ouvertement proclamer leur peur légitime ». Il a été récompensé de nombreux prix au cours de sa vie pour son travail, dont le Deutscher Kritikerpreis de 1967 et le prix Theodor-W.-Adorno de 1983. A 85 ans, suite à la catastrophe de Tchernobyl, il renonce à la non-violence et prône la « légitime défense » face au péril nucléaire. Allant jusqu’à affirmer qu’« il n’y a pas d’autre moyen de survivre que de menacer ceux qui nous menacent », les appels à la violence de Gunther Anders choquent et agitent les sphères militantes et intellectuelles, notamment en Allemagne. Ces textes marquent son revirement intellectuel : le premier explique pourquoi le sabotage est devenu selon lui insuffisant, et justifie la violence envers ceux qui menacent la survie de l’humanité ; le second, sous forme d’une interview imaginaire, reprend ce plaidoyé et critique les mobilisations non-violentes, qu’il qualifie de happening.
Temps de lecture : ~ 35 minutes