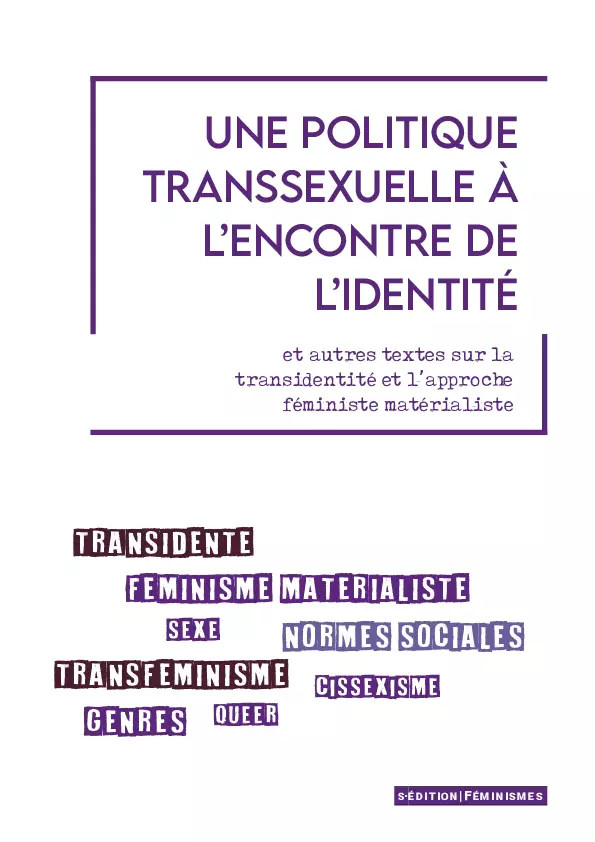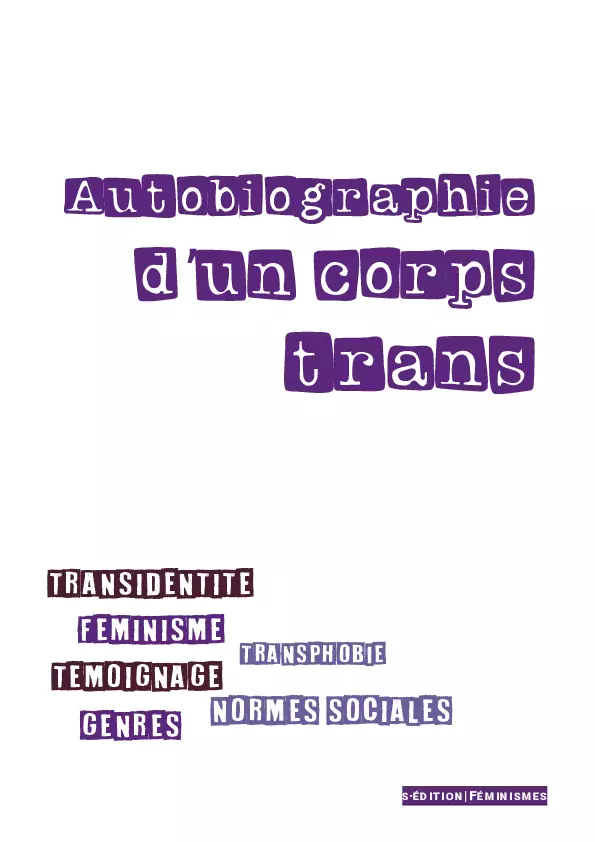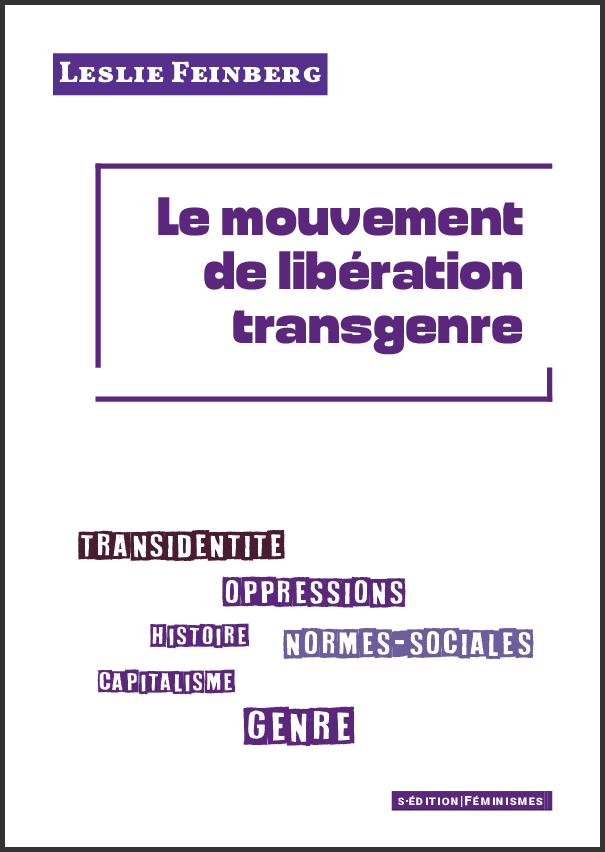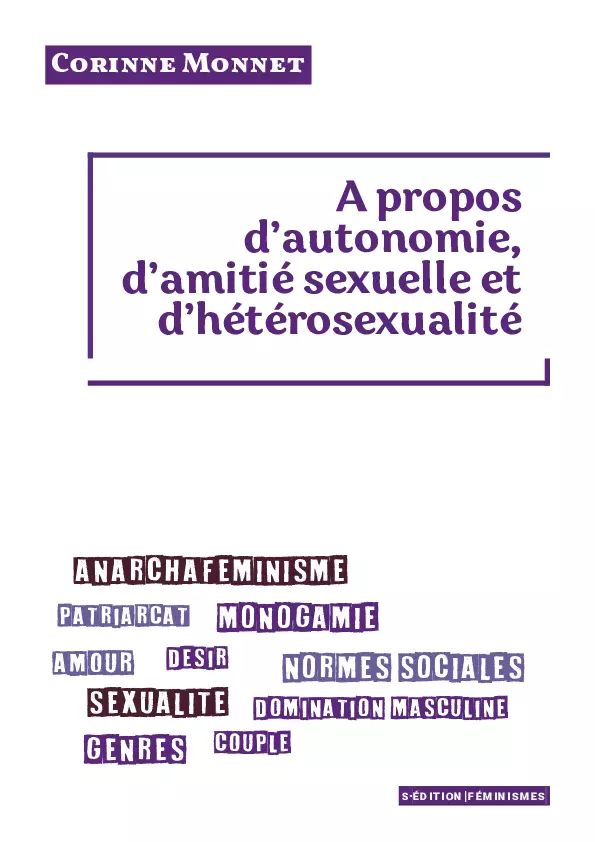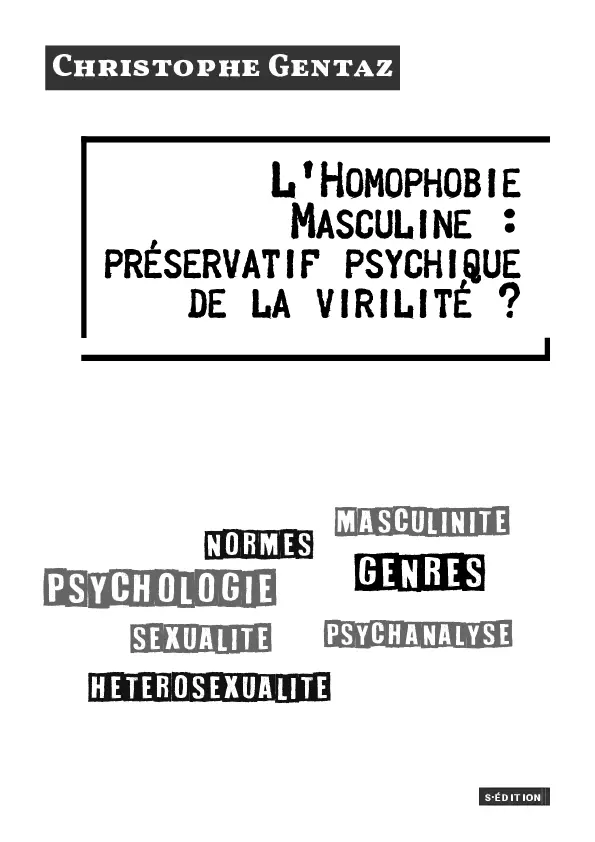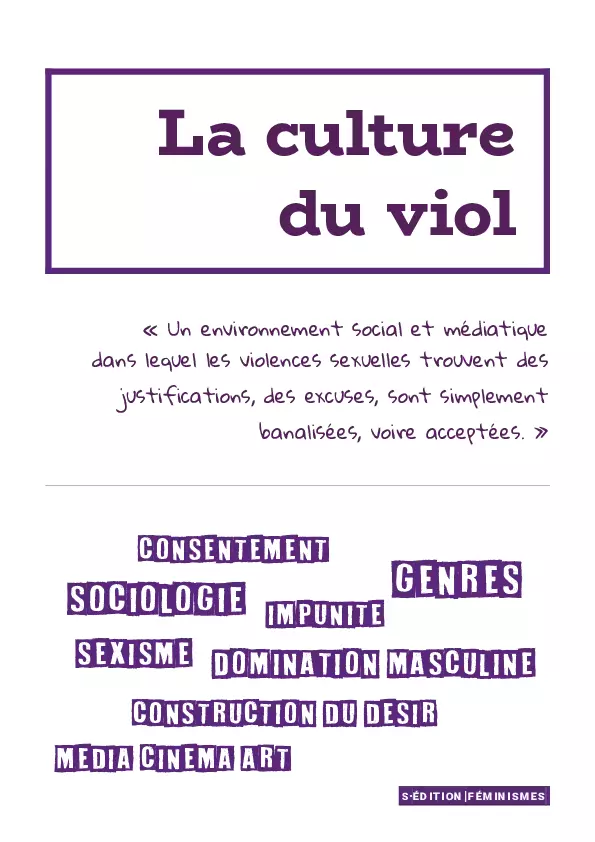— Une politique transsexuelle à l’encontre de l’identité
Temps de lecture : ~ 41 minutes
Une politique transsexuelle à l’encontre de l’identité
Marlène Ducasse
Marlène Ducasse est une militante marxiste et poète. D’autres textes sont consultables sur son site : marleneducasse.fr. Celui-ci fut initialement publié sur le site lesguerilleres.wordpress.com en aout 2020.
Différentes conceptions de ce que c’est « qu’être trans » s’affrontent en permanence depuis l’apparition d’un militantisme trans qui s’autorise à se définir comme tel. Dans nos espaces militants, la définition de ce que nous nommons parfois « transsexualité », parfois « transidentité » ou « transgenrisme », plus rarement « transsexuation » ou « transitude » est une définition en contradiction avec la manière dont « la société » perçoit l’existence trans et l’incorpore en son sein (quand elle ne veut pas nous voir disparaître).
Être trans, d’un point de vue hégémonique, acceptable socialement, c’est accepter un schéma d’assimilation, en parquant l’argumentaire psychiatrique sur notre existence. Cette conception archétypique veut que nous, trans, ne soyons simplement « pas né·e·s dans le bon corps », et qu’une pratique de « soin » puisse venir régler le problème. A en croire cette définition, nous serions des êtres « cassés », mais « réparables ». Alors, tout va bien.
Le militantisme trans s’est construit en opposition à cette manière de voir nos transitions, nous ne voulions plus « choisir » par défaut l’assimilation complète pour être accepté·e socialement, nous voulions nous-même pouvoir poser la question de qui nous sommes. Questionner le genre*, le sexe, comme les féministes cis ont pu, et peuvent, le questionner de leur côté. Il s’agissait de ne pas accepter une condition mortifère qui nous maintient dans un état de subalterne médicalisé·e si l’on veut éviter une mort certaine.
Pour combattre cette vision hégémonique de la « transitude », il a fallu développer d’autres manières de penser nos transitions, le genre et le sexe. S’inspirant des schémas politiques classiques à l’œuvre dans nos espaces militants « de gauche », elles se confrontent et se rejoignent, s’éloignent, se distancient, se combattent parfois, voire même, souvent.
Elles créent un véritable rapport politique entre elles, et ainsi, cherchent à s’affirmer au sein de l’espace militant trans.
Contre l’essentialisation psychiatrique, nombre de militant·e·s, dès les années 90, ont adoptés un schéma revendicatif basé sur la notion d’identité. Partant du postulat (partagé par d’autres courants) que la psychiatrie, la médecine, ne viendrait qu’appliquer sur les corps trans une biopolitique répressive, ce schéma identitaire vient affirmer que contre cette biopolitique, c’est le droit à « l’auto-détermination » qui doit s’imposer (contre le pouvoir holistique, la primauté de l’individu). Une pratique de « libération individuelle » qui se voulait répondre à des urgences en affirmant un « droit à l’existence », comme un droit inaliénable et sacré. Cette vision « libérale-libertaire » de la question trans, souvent centrée autour de la performativité du genre* développée par Butler dans Trouble dans le genre, est issue de la pensée queer*. Cette pensée concentre le débat non plus sur les structures bourgeoises de l’État moderne et sur les oppressions vécues en qualité de faits sociaux créateurs de discriminations, mais sur la question de l’identité. Il s’agirait de détruire le genre* en détruisant ce « soi-même » imposé par la société, pour se recréer en tant qu’individu plus ou moins genré, à partir de ses propres aspirations.
Mais cette conception de la question trans porte en elle-même beaucoup de contradictions. Se recréer soi-même à partir de ses propres aspirations sous-entendrait que cela soit possible, que le genre ne soit donc que performatif (produit par le simple fait qu’on le pense en tant que tel), et qu’il suffirait de changer la manière de (se) voir pour changer la manière dont la société peut se percevoir toute entière d’un point de vue « genré ». Mais, en lien avec ce que la pensée féministe a pu nous apporter, il est à constater que la vision queer* du genre part du principe que les individus seul·e·s sont en mesure de bouleverser le genre, voire de le détruire, du simple fait de leur existence « hors-normes ». Le queer vient donc imposer une certaine conception de nos sociétés, une conception du sexe, du genre qui lui est propre. Une conception antiféministe.
Au lieu de rédiger un simple pamphlet « anti-queer », il me semble bien plus pertinent de lui opposer une réalité différente, une autre politique concernant la question trans. Telle est la volonté de cet article.
Là où le queer* se fait de plus en plus étendu, il importe de proposer un autre modèle (en réalité déjà à l’œuvre dans nos milieux, mais minoritaire) pour ne pas stagner dans les querelles qui fondent nos réalités militantes locales (du point de vue de la France, en tout cas) depuis au moins 20 ans. Au détriment de réelles avancées sociales.
Cela fait un moment maintenant que je cherche à avoir une perception des plus justes sur la manière de me vivre en tant que femme trans. Au début de ma transition, ce fut certes beaucoup d’expériences, mais j’ai surtout mené une réflexion intense sur des questions qui me semblaient élémentaires : « En quoi serais-je trans avant d’être femme ? », « De quelles façons je suis une femme ? », etc.
Les premières personnes qui m’ont accompagné dans ma transition furent des personnes issues du mouvement queer*. Je me suis donc initialement (re)construite sur des rapports de « légitimité », d’individualité, de dépassement des normes par sa propre expérience, etc.
Et au fur et à mesure que je grandissais en tant que femme trans, au fur et à mesure que je réalisais ce que c’était que d’être femme, ce que c’était que d’être trans, dans une société sexiste et transphobe, je ressentis le besoin, comme beaucoup, de comprendre comment cette société-là fonctionnait, se structurait, et influençait la moindre petite parcelle de mon existence.
Et plus j’avançais dans cette réflexion, plus je réalisais à quel point la conception queer était insuffisante pour penser la transphobie et le sexisme. Il me fallait donc puiser dans d’autres sources et, tout en gardant à l’esprit une certaine conception de l’individualité, j’ai découvert, entre autres, le féminisme matérialiste*.
Il s’agissait dès lors pour moi de penser mon existence non plus comme libératrice, mais comme intégrée dans un rapport de forces dont je réalisais à peine l’influence sur ma vie. Je réalisais alors que la seule voie réellement « libératrice » était la voie de l’émancipation. Mais au sein d’une société où le sexisme et la transphobie fonctionnent en structures socialement construites, je savais que je n’étais pas la seule à exister dans ce rapport de forces non-choisi. S’émanciper soi, c’était alors s’émanciper collectivement.
Ébranler les structures sociales aliénantes ne pouvait se faire qu’à travers un projet social, collectif, réellement libérateur.
Je me suis donc plongée dans la lecture matérialiste, j’ai pu comprendre que je faisais partie d’une classe de sexe*, la classe des femmes. Que l’émancipation était donc une lutte de classes et que je ne pourrais la mener seule.
Certain·e·s lisant cela se diront peut-être qu’au fond ce n’est qu’un parcours banal d’une militante gauchiste, mais au-delà de ça, il faut saisir ce qu’il y avait d’important pour moi, comme pour d’autres, derrière cette idée anti-essentialiste d’émancipation collective. Je me comprenais comme faisant partie de quelque chose, je me trouvais des sœurs, de vie et de lutte, je me lançais dans un combat. Ma transition fût très vite un sujet politique, et je ne pouvais correctement la suivre qu’en m’engageant dans une voie qui me semblait cohérente. Et une fois qu’on a acquis cette conscience de classe (de sexe), on ne peut plus se contenter de sa propre individualité. Il faut aller de l’avant.
Le FHAR (Front Homosexuel d’Action Révolutionnaire), dans les années 70, annonçait son programme en disant : « Nous voulons détruire la famille et cette société parce qu’elles nous ont toujours opprimés »[1]. Au même titre qu’en tant qu’homosexuel·le·s nous nous engageons dans une lutte contre ce qui nous opprime en tant qu’homosexuel·le·s (une lutte contre les structures sociales telles que la « famille »), comment en tant que trans pouvons-nous engager dans la lutte contre la transphobie et le cissexisme* ? Et est-ce suffisant ?
Aller à l’encontre de la posture identitaire, c’est se poser beaucoup (beaucoup) de questions sur les réalités sociales matérielles. Sur le terrain on se rend vite compte que « trans », ce n’est pas un groupe complètement homogène, qu’en notre seins certain·e·s subissent du racisme quand d’autres en tirent profit, certain⋅e⋅s subissent l’homophobie, la lesbophobie, quand d’autres s’accommodent bien du reste. Mais malgré tout, du fait que nous soyons trans, nous formons un groupe social avec des intérêts propres. Nous nous inscrivons dans un rapport social, nous nous devons de nous penser en termes collectifs pour appréhender qui nous sommes, et les enjeux de nos luttes potentielles. Il me semblait inenvisageable de continuer une transition dans mon coin dès lors que je réalisais quelle était l’oppression que nous subissions en tant que trans.
C’est là que la position transféministe a toute son importance. Parce qu’elle apporte des éléments à la grille de lecture matérialiste qui permettent de penser concrètement la transgression du genre, et parce qu’elle ne place pas la transgression comme un but politique mais comme une preuve de la non-naturalité des rapports sociaux de sexe.
Une fois ces enjeux-là posés, nous vient une évidence : si la question trans demeure au-delà d’une « transgression du genre », du fait qu’elle fait partie d’un raisonnement plus global sur le monde qui nous entoure, être trans devient donc un processus bien particulier. Un processus de transsexuation.
Si le mot « transsexuel·le » a la connotation négative qu’on lui connaît à cause de l’institution psychiatrique, le terme utilisé majoritairement aujourd’hui par nos milieux militants, celui de « transgenre » est malheureusement trop peu correct, trop vague pour décrire au mieux les réalités sociales que nous vivons.
Car en plus de faire partie d’un processus en mouvement, « le genre précède le sexe » (Delphy). C’est l’organisation sociale qui cherche à maintenir l’oppression sexiste par l’argumentaire biologique sexuel, et non le sexe biologique qui subit les affres du sexisme.
Ainsi, si le genre est l’oppression patriarcale et le sexe les éléments justificatifs de l’oppression, si le sexe, c’est ce qui est apparent dans l’oppression et ce à partir de quoi nous sommes amenées à nous penser en tant qu’individus, alors en tant que femmes trans, nous sommes bien dans un rapport de transsexuation.
Penser notre vécu, notre expérience, comme relevant de la transsexuation permet ainsi de sortir de la logique de l’identité et d’imaginer un schéma cohérent pour combattre activement le sexisme (et donc la transphobie). Car, là où des universitaires comme Bourcier vont revendiquer qu’« on doit pouvoir être libre d’auto-déterminer son genre »[2], ou comme Preciado, qu’il nous faut désirer un « genre utopique » pour se « désidentifier »[3], nous, transsexuées, affirmons que seule la lutte des classes de sexe est envisageable pour détruire le genre et ainsi, émanciper l’humanité entière de la société sexiste et transphobe. C’est cet horizon-là qu’il nous faut viser.
En tant que transfuges de classes de sexe, nous, femmes trans, affirmons participer de façon pleine et entière à la lutte contre le sexisme, que nous subissons de plein fouet comme toutes les femmes.
Comment penser la transitude ? Une approche matérialiste
Anastasia
Ce texte fut initialement publié en aout 2020 sur le site lesguerilleres.wordpress.com, où l’on peut retrouver d’autres textes d’Anastasia.
Qu’est-ce qu’être trans ? Les réponses habituellement données à cette question sont peu matérialistes et souvent vides de sens.
« Être trans c’est être né·e dans le mauvais corps. » : nous voilà de nouveau avec une belle rhétorique essentialiste sous les bras – comme si notre genre précédait notre existence, comme s’il était produit par des nécessités biologiques et non par des contingences sociales.
« Être trans c’est se sentir/être d’un autre genre que celui qui nous a été assigné à la naissance » : ouh le bel idéalisme ! C’est reparti pour une analyse individualisante et psychologisante présupposant le genre comme un « ressenti » et pas comme un rapport de pouvoir.
« Être trans c’est sentir de la dysphorie » : si c’est souvent un sentiment de mal-être extrême qui pousse à transitionner, c’est faire dans un même mouvement une psychiatrisation (comme assujettissement à la psychiatrie et à sa coercition) de nos vécus et un saut logique qui n’a pas lieu d’être : la situation matérielle d’une personne trans n’est pas déterminée en premier lieu par sa dysphorie supposée, même si la dysphorie peut l’engager – l’asymétrie des situations entre les hommes trans et les femmes trans suffit à s’en convaincre. De plus, la baser sur la dysphorie serait faire une lecture très ethnocentrique et occidentalisée de la transitude.
Enfin, le plus acceptable mais tout de même bancal « être trans c’est vouloir transitionner, transitionner ou avoir transitionné » : le désir de transition ne s’autoréalise pas et nécessite d’autres facteurs (comme la possibilité concrète de transitionner) pour pouvoir agir sur la place de la personne dans les rapports sociaux.
Cet article se propose donc d’établir une conception simple et matérialiste de la transitude (ou transsexualité/transsexualisme, ou transsexuation). C’est volontairement que sont écartés les termes de transidentité et de transgenrisme, le premier étant centré sur une notion idéaliste, le second se détachant des rapports sociaux premiers (entre classes de sexe) pour n’envisager que les habitus* qui en découlent a posteriori (ce qu’on pourrait appeler le genre), quand il ne désigne pas tout simplement une idée du soi déconnectée de toute réalité sociale. Il reste volontairement abstrait afin que le modèle puisse être réutilisé, modifié, en bref qu’il reste une conception et non une description.
Il faudrait pour cela distinguer deux plans de lecture de la transitude : l’un qui se baserait sur l’historicité de la situation sociale personnelle dans les rapports de sexe, l’autre qui serait purement matériel. Commençons par le premier.
A la différence des catégories d’homme et de femme, les catégories cis et trans ne forment pas de classes sociales, mais décrivent des trajectoires entre ces classes de sexe[4]. De la même façon que des transclasses sont des transfuges de classe sociale (au sens marxiste orthodoxe du terme), les transsexuel·les sont des transfuges de classe de sexe* (voire la thèse d’Emmanuel Beaubatie à ce sujet). Un·e prolétaire devenu bourgeois·e est transclasse, une femme devenue un homme est transsexuel. Et vice-versa si le processus est un déclassement et pas une ascension (bourgeois·e vers prolétaire, homme vers femme). Les causes et conséquences ainsi que les modalités des changements de classe de sexe ne sont pour autant pas les mêmes que celles d’un changement de classe au sens marxiste : s’il est possible d’établir des liens et de s’en servir pour vulgariser la théorie par analogie, on ne peut cependant les superposer. Suivant cette conception, est trans toute personne qui est transfuge de classe de sexe, c’est-à-dire qui en a changé. Pas question de dire que nous avons toujours été un homme/une femme au fond de nous : ce serait masquer l’aspect strictement social de ces catégories – les hommes ne sont des hommes qu’en tant qu’ils sont la classe qui s’approprie les femmes et les exploite sous le patriarcat, et inversement. Tant que notre situation sociale est celle d’un homme dans les rapports sociaux de sexe, c’est-à-dire tant que nous sommes perçu·es comme des hommes et traité·es comme tel·les, nous restons des hommes. Des hommes déviants à leur classe, parfois. Des hommes subalternes, déclassés, marginalisés, peut-être. Des hommes avec un désir d’être des femmes et un devenir[5] de femme, assurément. Mais des hommes tout de même. Parce que la catégorie d’homme est transversale et non homogène. Penser le « point de bascule » paraît très compliqué et relativement peu pertinent : le changement de classe ne se fait pas instantanément. Dans le cadre d’une transition binaire, durant toute une période, où le sujet est en transition, il est dans un entre-deux trouble et violemment réprimé – par ce que l’on pourrait appeler cissexisme* ou transphobie, moyen pour le patriarcat d’assurer la rigidité des classes de sexe, leur discrétion et de réaffirmer son narratif naturaliste.
Il est également possible de considérer cis et trans comme des situations purement sociales, strictement matérielles, sans prise en compte du vécu passé. Être trans serait alors être matériellement confronté·e, vis-à-vis des institutions, de l’espace public, des relations interindividuelles et sociales, au cissexisme. Être cis, ne pas l’être. Là où la conception présentée dans le paragraphe précédent marquait, par la transition, une rupture irrémédiable entre les états cis et trans : on devient trans par la transition et on ne redevient pas cis (même en détransitionnant/retransitionnant, voire deux fois plus, puisque nous aurions alors tout de même effectué plus d’un changement de classe de sexe*, peu importe qu’il s’ancre dans une situation sociale assignée à la naissance), cette conception-ci instaure une forme de logique ternaire : une personne cis d’un sexe devient trans en transitionnant – ce qui la cantonne à un rôle social hors des classes binaires traditionnelles, puis retrouve parfois une forme de statut de cis conditionnel dans l’autre sexe en cispassant. Puisque de la même manière qu’en passant pour une femme on en devient une, en passant pour un·e cis on est traité·e comme tel·le. Et donc, socialement on le devient. Or la cissexualité n’est rien d’autre qu’une situation sociale.
Cependant cette réintégration à la situation sociale cis dans la classe opposée n’est pas systématique : certaines personnes souhaitent conserver un statut androgyne/non-binaire, d’autres ne parviennent tout simplement pas à cispasser pour diverses raisons. De plus, comme nous l’avons précisé ci-dessus, ce statut cis est éminemment conditionnel : certaines personnes ne peuvent jamais renouer avec leur famille du fait de leur transition. Les confrontations aux systèmes médicaux, carcéraux, étatiques de manière générale, ne sont que rarement similaires à celles qu’ont les personnes « inconditionnellement cis ». En effet, les personnes trans « redevenues cis » conservent un potentiel devenir trans : elles gardent cette épée de Damoclès en permanence brandie au-dessus de leur tête, puisque l’État et la médecine conservent des traces de leur transition, puisqu’elles peuvent à tout moment être outées, puisqu’elles sont dépendantes des hormones produites, distribuées et commercialisé·es par des structures cissexistes pour survivre.
Une telle conception permet de penser la transitude non comme un groupe relatif à l’identité de ses membres mais comme une situation concrète. Elle admet l’hétérogénéité de ces trajectoires puisque certaines sont ascendantes quand d’autres sont descendantes : il n’y a pas de symétrie possible entre les hommes trans et les femmes trans. Elle donne des clés pour (se) penser en tant que personne trans et s’intégrer au modèle matérialiste développé par les féministes de la deuxième vague, sans avoir recours à des essentialismes* ou des mystifications semblables à celles mentionnées en début d’article.
Pendant longtemps je n’ai pas transitionné parce que je doutais de ma transitude : que voulait donc dire « être une femme au fond de moi » ? La vérité, je crois, c’est que je ne l’étais pas. Pas plus que je n’étais trans. Mais je pouvais le devenir en choisissant de quitter cette position sociale masculine et ce corps d’homme avec lesquels je n’étais pas à l’aise, pour transitionner. Et c’est tout ce qui comptait. C’est lorsque j’ai compris cela que j’ai pu me lancer.
La socialisation comme théorie du genre incomplète
Sœur Natalie
Texte originellement publié sur TRANSGRRRLS en mai 2019, puis sur lesguerilleres.wordpress.com.
La façon exacte par laquelle un sujet individuel se retrouve à avoir un genre est une question centrale pour les féministes de gauche. La dénaturalisation et la démystification du genre a longtemps été un projet du féminisme radical. Révéler le genre comme un phénomène accidentel et historiquement émergent est nécessaire pour comprendre et combattre l’oppression du genre.
Le but de cet article est de mettre en place une critique de la théorie de la socialisation, qui combine une forme de psychologie développementale de comptoir avec des aperçus personnels pertinents pour créer quelque chose qui a l’air très substantiel, même s’il n’en est rien. Je vais donc me concentrer sur la façon dont nous interagissons avec la structure du Genre en tant qu’individu⋅es, et moins sur ce que cette structure est réellement. Cela écarte cette question de première importance, mais ici je veux juste supposer que nous sommes d’accord sur le fait qu’une structure que nous appelons le Genre existe – peu importe si nous la concevons de manière féministe matérialiste, anti-civ, butlerienne, ou autre. Personnellement, je prends une ligne féministe matérialiste, mais je crois que ceci ne dénature pas trop mon propos.
J’utilise la terminologie suivante : Genre, avec un grand G, désigne la totalité des relations socio-économiques qui renforcent l’ordre genré. Ceci inclut la division du travail patriarcal, la famille nucléaire, le mariage (qui, au moins historiquement, est une institution qui cherche à concentrer la propriété privée entre les mains des hommes, faisant des femmes leurs dépendantes), la binarité du genre comme idéologie, la pensée transantagoniste/transphobe, et généralement toutes les manières par lesquelles nous sommes emboîtées dans une des deux assignations de genre. Par contre, le genre, avec un petit g, désigne ce qu’on pourrait appeler le sens interne de l’identité genrée, même si je ne veux pas impliquer que tout le monde a un sens inné et pré-social de leur genre avec un petit g. Le terme est utile juste pour designer les façons dont les gens se comprennent et se représentent à leurs yeux et ceux des autres, ce qui ne s’aligne pas toujours avec l’idéologie patriarcale.
Le féminisme libéral a échoué à décrire suffisamment l’interaction entre le Genre et le genre. Beaucoup de commentateurs trans-libéraux supposent simplement que le genre est inné et anhistorique, une position que nous, en temps que féministes matérialistes et radicales, ne pouvons accepter, étant donné qu’elle implique que, d’une manière ou autre, l’ordre genré existant est lui aussi inné, anhistorique, et inévitable. Il faut que notre réponse à la question « Qu’est-ce-que ça veut dire d’être une femme » soit plus nuancée que « une femme est une personne qui se ressent femme, probablement à cause de sa physiologie/neurologie/ de son ADN féminine. » Cette position est utile uniquement pour contrer une transphobie vulgaire. Elle ne capture pas l’aspect structurel. Elle voit le Genre comme un ensemble de pratiques externes qui oppresse les individus qui ont des identités de genre variées, mais ne peut expliquer l’existence du Genre ou du genre comme phénomènes généralisés dans le Nord Global, car l’historisation du Genre serait aussi l’historisation du genre, ce qui rendrait suspect les bases immuables neurologiques/médicales de l’identité du genre en général, comme les expériences internes du genre se révéleraient être historiquement accidentelles et ancré dans une totalité socio-économique. Elle échoue aussi à situer le Genre dans une histoire continue d’impérialisme, d’esclavage, et de génocide colonial. C’est un écueil depuis longtemps critiqué par des féministes noires et décoloniales, comme Maria Lugones ou Hortense Spillers, mais ces critiques n’ont pas l’air d’avoir atteint le féminisme mainstream[6]. Nous avons donc besoin de développer une approche alternative qui explique cette interaction et les dynamiques psychiques qu’elle engendre tout en étant attentive à la contingence du Genre/genre et aux histoires brutales d’exploitation et d’accumulation coloniale que préfigure leur intelligibilité.
La théorie de la socialisation, qui se présente d’un point de vue plus radical, apporte bien un concept utile : la façon dont nous sommes traitées génère un ensemble de réponses usuelles via un conditionnement inconscient par un mécanisme de punition/récompense sociale. Ceci prend en compte la vérité empirique que les humains sont des créatures assez faciles à manipuler (dans le sens des recherches de Pavlov ou Skinner, et aussi du marketing et de la publicité). Ce point de vue est certainement utile pour décrire la psychologie de masse de démographies genrées mais semble inadéquat a l’échelle individuelle[7]. Par exemple, la théorie de la socialisation semble offrir très peu de place à la variance de genre, ce que nous appelons maintenant en Occident la transidentité. Cette variance du genre semble innée chez les humain⋅es, car nous discernons une très grande variété d’expressions, d’identifications, de rôles, et de descripteurs de genre à travers la plupart des sociétés humaines. Si les humain·e·s internalisaient simplement les mœurs de nos cultures, la transidentité serait inconcevable, ou au moins rarissime. Étant donné que, matériellement, la transidentité existe, nous sommes obligées d’étendre notre conception de l’interaction du genre avec le Genre. Avec cette variance de genre existe la dysphorie, que j’entends comme la réponse affective individuelle à la répression de la variance de genre par le Genre (et aussi l’internalisation de cette structure, causant de l’auto-punition pour la variance de genre quand elle s’exprime dans une personne). La théorie de la socialisation échoue précisément au niveau de cet affect subjectif. Comme elle ne considère pas des forces subjectives ou, plutôt, des variances à petite échelle, la socialisation n’explique pas la dysphorie parce qu’elle n’a aucune façon d’expliquer l’émergence du genre (je compte apporter une explication plus tard dans cet article). L’argument typique dans cette veine est qu’une femme trans vit sa socialisation d’une manière très différente d’un homme cis, et que la théorie de la socialisation ignore cette différence psychique. Par contre, la théorie de la socialisation est correcte quand elle dit que tout le monde internalise un ensemble de pratiques genrée qui ne viennent pas nécessairement facilement. Dans ce sens, ce processus est psychologiquement violent pour tout le monde. Par contre, il nous reste cette question : pourquoi certain·e·s acceptent ou gèrent cette limitation ontologique (tu es un garçon) mieux que d’autres ?
La théorie de la socialisation néglige aussi l’effet du racisme et de la colonisation sur le développement du Genre. En fait, isoler une seule « socialisation masculine » ou « socialisation féminine » devient extrêmement difficile lorsque l’on considère l’hétérogénéité de l’humanité. Même dans un seul pays, comme la France ou les États-Unis d’Amérique, des personnes noires, natives, et autrement racisées vivent le Genre très différemment que les Blanc⋅hes. Les hommes noirs sont hyper-masculinisés avec un effet mortel (je pense a Mike Brown, un gamin décrit par son assassin d’une manière animaliante[8]), tandis que les femmes asiatiques sont vues comme des récipients soumises aux désirs d’hommes blancs. Ces différences dans les expériences genrées ont bien sûr pour résultat des comportements, habitudes, et rôles genrés différents. En somme, une socialisation différente.
Je ne veux pas complètement discréditer la socialisation, mais démontrer ses fautes et proposer une solution. L’avantage de la théorie de la socialisation comparée à des théories du genre libérales est qu’elle refuse de naturaliser le genre tel qu’il existe, et donc prend au sérieux la proclamation de Beauvoir, « On ne naît pas femme, on le devient. » Ce refus est politiquement utile parce qu’il démystifie le Genre comme un ensemble de relations économiques qui ont une histoire et donc un futur incertain. Ceci ouvre un terrain théorique qui rejette la famille nucléaire, la division du travail genrée, et tous les autres aspects de l’exploitation des femmes dans l’économie politique de l’hétérosexualité. Il semble aussi évident que, de manière générale, être élevé⋅e dans un rôle social précis a un certain effet psychologique, sinon nous ne pourrions pas dire que les hommes ont une tendance plus forte que les autres à avoir plus d’idées patriarcales ou homophobes. En outre, je veux proposer une interaction dialectique entre le Genre et le genre, c’est-à-dire, nos expériences internes de genre seraient la synthèse de la variance du genre et de l’infini des possibilités par lesquelles nous essayons de nous montrer à l’Autre avec les structures matérielles et symboliques du Genre. Donc le genre (l’identité) serait une propriété émergente, ou autrement dit, une synthèse, d’un système complexe composé de deux tendances : une tendance vers la différence à une petite échelle (la variance du genre) et une tendance vers une norme économico-politique à grande échelle (le Genre).
J’interprète cette dialectique comme une « non-linéarité » dans le système, une interprétation avancée par Amir Hernandez[9]. La « non-linéarité » est un concept mathématique qui décrit le degré de complexité d’un problème. Dans le contexte de cet article, il est suffisant d’interpréter la non-linéarité comme deux boucles de rétroaction : A a un effet sur B, puis le changement de B entraîne un changement de A, ce qui modifie la façon dont A agit sur B. Après, la boucle continue et A et B évoluent en tandem, chacun ayant un effet sur l’autre et donc indirectement sur soi-même. Tandis que les conditions matérielles du patriarcat et la superstructure idéologique (le Genre) est primaire, elles ne sont pas seules et sont couplées avec des facteurs individualisés. Ces facteurs individuels, qui jusqu’ici ont pris la forme de « variance de genre », sont multiples. D’abord, il y a la nécessité de se montrer soi-même à l’Autre et d’essayer de lui faire comprendre qui on est pour être reconnue, pour que la compréhension du sujet par l’Autre soit possible. Cette dialectique hégélienne/psychanalytique se situe dans le contexte d’une symbolique que nous n’avons pas créée, car elle dépend de la base économique de notre société. Donc, une des variables individuelles est la grande diversité de façons d’entreprendre cette quête de reconnaissance incomplète dans un langage qui n’est pas le nôtre. Après, il y a aussi la possibilité que certain·e·s humain·e·s sont prédisposé·e·s à des comportements qui sont genrés dans notre symbolique. Ces prédispositions pourraient être génétiques[10], épigénétiques, développementales, psychologiques, ou autre. Ces facteurs individuels influencent la manière dans laquelle une personne interagit avec son environnement. Par exemple, qui iel choisit comme ami·e·s et quels espaces sociaux iel fréquente. Beaucoup de femmes trans vivent « du temps entre mecs » comme quelque chose de très stressant, tandis que les hommes cis on l’air d’aimer ces situations sociales. Des différences dans le vécu du Genre entraînent souvent des groupes de potes différents, des activités différentes, etc. Ce qui change la manière dont une personne internalise le Genre, donc la façon par laquelle son genre se forme. Ce n’est pas, pour ainsi dire, que les femmes trans n’ont aucune habitude « masculine » ou que les hommes trans n’ont aucun comportement « féminin », mais que c’est beaucoup plus difficile de graver ces comportements dans des sujets profondément inconfortables que dans des sujets qui les acceptent plus facilement (les personnes cis). Cette interaction entre l’individu et ses alentours matériels et superstructurels est donc dialectique, c’est-à-dire, couplée d’une manière non-linéaire. Comme dans un système d’équations différentielles non-linéaires, chaque terme influence l’évolution de l’autre, et donc de manière indirecte, soi-même.
Nous devons, bien sûr, répondre a la question de quel côté de cette dialectique est primaire. Les conditions externes et non-individuelles le sont, pour plusieurs raisons. Premièrement, ces conditions sont inéluctables et s’appliquent à tous les membres d’un certain groupe, ou d’une certaine classe, d’une façon plus ou moins uniforme, tandis que des facteurs individuels sont non-uniformes par excellence, et donc génèrent des effets moins forts, car il n’y a souvent pas de renforcement externe à une tendance individuelle ou autre[11]. Deuxièmement, des conditions matérielles contraignent sévèrement le degré auquel un⋅e individu⋅e peut changer son environnement et donc créer un cycle auto-renforçant. Par exemple, quelqu’un⋅e en questionnement de genre dans une ville sans association trans et sans les moyens financiers de chercher ce support éprouvera beaucoup plus de difficulté au cours de son questionnement qu’une personne avec ces ressources. Cela risque de repousser son sentiment de transidentité si profondément dans sa psyché qu’iel ne les retrouvera plus de sa vie. Les personnes qui détransitionnent à cause d’abus transphobes sont un autre exemple de la prédominance des conditions socio-économiques du Genre sur le genre. Troisièmement, les conditions matérielles produisent l’ordre symbolique au travers duquel le sujet se comprend lui-même. Alors, ces conditions fixent les règles du jeu à l’avance. L’expression du genre est donc toujours une traduction de l’intraduisible dans la langue d’autrui. Sans un élargissement des termes de possibilité, ou dit autrement, sans une plus grande possibilité de termes sous lequel l’expression peut se produire, certains facteurs individuels resteraient incompréhensibles au sujet (d’où l’intensité cathartique d’apprendre que le mot « trans » existe et que un monde trans existe, lui aussi). Donc ce modèle dialectique maintient la primauté des conditions matérielles de nos vies, soulignant l’expérience (et non le ressenti) et le rôle indéniable de nos environnements dans la formation de nos comportements genrés et même de notre sens d’identité.
Ce modèle dialectique non-linéaire a plusieurs avantages. Premièrement, il prend en compte la variance de genre, même s’il n’offre pas de prédictions sur la façon exacte dont cette variance va s’exprimer. Au lieu d’un déterminisme total, il essaye d’évoquer la complexité du genre dans un cadre matérialiste. Deuxièmement, il ne tombe pas dans un matérialisme* réductif et bancal, prenant des positions plus nuancé dans le débat de la nature contre la culture. Troisièmement, en faisant plus attention aux conditions matérielles spécifiques qu’on considère – au lieu de supposer qu’un ensemble de conditions est universel et vécu de la même manière par tous les sujets – il réduit l’universalisation d’un vécu du genre blanc américano-européen parce qu’il est assez flexible pour gérer toutes les façons dont les gens sont imprégnés dans une totalité socio-économique. De plus, on peut considérer des traumas intergénérationnels ou les autres aspects de l’esclavagisme et le colonialisme existant comme des facteurs individuels dans la psychologie des personnes racisées et colonisées et des constituants des conditions externes du Genre qui peuvent certainement avoir un effet considérable. Nous avons besoin de comprendre les processus par lesquels quelqu’unE devient une femme pour comprendre ce que c’est d’être une femme. Des assertions simplistes de genre sont insuffisantes malgré la catharsis qu’elles apportent. Par contre, nous devons éviter un matérialisme* réductif qui simplifie trop le monde, qui devient à sa propre façon de l’idéalisme, car l’histoire devient une machine sans conducteur dans laquelle la volonté[12] humaine n’a aucune place. Au lieu de remplacer le genre inné par une programmation sociale déterministe, nous devrions défendre une position nuancée et dialectique qui cherche à trouver le mouvement et l’interaction entre toutes les variables dans un système extrêmement complexe. Seul un matérialisme* détaillé peut exposer l’oppression de genre comme une force historiquement contingente et éviter les écueils du réductionnisme.
Traître à sa classe
Anastasia
Texte originellement écrit pour et publié par « Les Gouines Écrivent » (instagram), puis sur le site lesguerilleres.wordpress.com
On m’a demandé d’écrire sur mon parcours. Mon parcours de transfuge de sexe. J’ai changé de sexe. Je dis souvent que c’est la pire décision de toute ma vie. Objectivement c’est vrai : j’ai perdu énormément. La mobilité sociale descendante que représente la transition MtF[13] est un déclassement brutal qui (m’a) fait perdre énormément sur le plan matériel : boulot, logement, liens amicaux, liens familiaux, globalement liens affectifs en somme. Mais si c’était à refaire je le referais – cent fois s’il le fallait – plutôt que de croupir dans un corps et une classe qui me semblaient immondes. Être un mec, même pédé (et Dieu sait que je l’étais jusqu’à la trogne, comme quoi même dans mon plus grand malheur il y avait du positif) m’était trop insupportable.
Qu’est-ce que le sexe ? Christine Delphy écrit dans L’Ennemi Principal que « le genre précède le sexe ». Ce qu’elle entend par là, c’est que le genre – système politique, structure sociale de domination masculine, quelquefois appelé patriarcat ou hétérosexualité, qui hiérarchise et divise du même coup l’humanité en deux groupes dont l’un sera physiquement approprié et exploité par l’autre – précède logiquement et techniquement la justification naturalisante de cette division. Le système politique de domination ne s’instaure pas, selon les féministes matérialistes, en fonction d’une différence de nature qui lui préexiste. La différence est politique et sociale, la réalité ne produit pas de catégories métaphysiques ou « naturelles ». Ce sont les classes dominantes, détentrices des moyens de production intellectuels et scientifiques, qui produisent l’idéologie de la différence des sexes a posteriori du rapport d’exploitation déjà effectif. De la même façon que la classe capitaliste produit un narratif sur la classe prolétaire, que les blancs produisent l’idéologie raciste, les hommes produisent la pensée straight (Monique Wittig), c’est-à-dire le système de pensée qui statue qu’il existe des catégories biologiques distinctes, discrètes, exclusives et exhaustives, opposées et complémentaires, qui naturellement doivent s’unir dans l’hétérosexualité. Le féminisme matérialiste* dit : ces catégories ne sont pas naturelles mais construites selon un mode d’exploitation antérieur et arbitraire, qui après avoir divisé pratiquement la classe exploitante et la classe exploitée, trouve des critères physiques pour les discrétiser, critères qui sont entérinés par la doxa de sexe (périphrase pompeuse qu’utilise Haicault pour parler de la part symbolique des rapports de sexe : “ensemble de significations, de croyances, d’affirmations, qui utilise tous les systèmes de signes (langage, corps, images, sons) et tous les moyens de communication”) et l’effacement politique mais aussi physique de tous ceux et toutes celles qui ne s’y conforment pas (répression des homosexuels, lesbiennes, transsexuel·les, mutilation des intersexes). L’hétérosexualité est l’organisation sociale qui met à disposition le corps et la force de travail de la classe exploitée (les femmes) pour celle de la classe exploitante (les hommes). Le mariage est un contrat statuant la propriété de l’une par l’autre. En somme, pour paraphraser Guillaumin : non, le sexe [comme catégorie biologique] n’existe pas, oui, le sexe [comme catégorie sociale] existe. Ce contrat permet à la classe capitaliste l’accumulation du capital par la transmission de son héritage et la reproduction de la force de travail de la classe prolétaire assurée gratuitement par les femmes (reproduction, élevage, éducation, soin, travail domestique).
Revenons à la transition. Je m’appuierai principalement sur les travaux d’Emmanuel Beaubatie et de Pauline Clochec. Si le sexe n’est pas une réalité biologique intangible mais une catégorie sociale à laquelle on est ou non rattaché·e, alors il devient possible d’en changer. Je m’intéresse ici spécifiquement à la forme contemporaine et occidentale de transitude au sein du système de genre tel qu’il existe aujourd’hui : la transsexualité. Il est important de noter que cette configuration n’est pas anhistorique. L’impérialisme et la colonisation ont participé à l’exportation et à l’imposition violente de ce système de genre et à l’effacement des sociétés dont la division sexuelle s’opérait différemment. Cet écrit n’ayant pas vocation à dresser une histoire du genre à travers le monde et les modes de production mais davantage à s’intéresser au mode actuel de changement de sexe, je ne m’y attarderai pas.
L’écueil dans lequel tombent nombre de présentations de la transsexualité est le narratif offert selon lequel le changement de sexe serait motivé par une incohérence entre une identité psychologique et une identité biologique. Ce discours est actualisé au travers des rhétoriques queer* vulgaires qui distinguent le genre (psychologique) et le sexe (physique). Cet essentialisme* s’est historiquement développé alors que la justification superstructurelle de la division sexuelle du travail (la naturalisation des catégories de sexe) était mise à mal par des individus qui changeaient de sexe ou désiraient en changer. L’institution psychiatrique a rétabli une justification pour re-naturaliser ces catégories : la naturalisation des sexes est passée de strictement physique à psychique. Mais les patient·es transsexuel·les ne demandaient ni une psychiatrisation, ni la mise en cohérence d’un dualisme identitaire (âme et corps, psyché et physique…). Ceci n’est que l’explication imposée par la psychiatrie. Les revendications trans se sont portées contre la psychiatrisation et pour la liberté simplement à changer de sexe (socialement et physiquement).
Cette forme de transition est assez récente. Elle a été permise à la fois par les avancées médicales, les découvertes en endocrinologie, la production d’hormones sexuelles de synthèse, le développement des chirurgies génitales suite aux guerres mondiales (elles-mêmes rendues possibles par les avancées techniques), et par les évolutions du capitalisme. D’un point de vue physiologique, sur ce qui construit le « sexe biologique » (génome, caractéristiques sexuelles primaires et secondaires, taux hormonaux), les personnes trans ont acquis la capacité d’en changer les trois quarts. D’un point de vue social, le passage d’un mode de vie sédentaire rural où le travail salarié est attribué selon la lignée familiale et sans mobilités envisageables à une vie urbaine aux fortes mobilités ont permis à des individus de changer de sexe sans compromettre autant leurs conditions matérielles d’existence et de subsistance : changer de travail, de collègues, d’entreprise, d’entourage et de ville étant devenu possible, il était du même coup devenu possible de changer d’identité sociale. Des prémisses de ces phénomènes s’observent dès le XIXe siècle avec souvent des femmes qui quittent le domicile parental rural pour vivre comme des hommes en ville ou des hommes qui désertent et vivent comme des femmes pendant des années (“au cas où”). Ces mobilités de sexe se développant, la reconnaissance légale des parcours de transition par la mise en adéquation de l’identité sociale et de l’identité légale s’en est suivie (non pas qu’elle soit simple, au moins fut-elle possible).
S’attarder sur le pourquoi du désir de changement de sexe sans y rechercher des explications sociologiques n’est qu’un ressort sexiste et cissexiste. Le fait est que des personnes passent d’une catégorie de sexe à laquelle ils et elles ne parviennent pas à s’intégrer à une autre. La transition et la transsexualité peuvent alors être comprises comme un ensemble de procédés, un processus, permettant de passer d’une catégorie de sexe à une autre, à la fois physiquement et (donc) socialement. Seul ce fait, et ses conséquences sur les conditions d’existence des personnes trans, comptent vraiment.
Ce texte, je le dédie à celle sans qui il n’existerait pas. Celle sans laquelle je n’existerais pas. Celle à qui je dois tout, et tellement plus encore. Celle que j’appelle ma mère et dont j’ai fait inscrire le nom sur mon état-civil. Je t’aime, Pauline.
Lexique féministe matérialiste
Ces définitions sont issu du « lexique féministe matérialiste » du site lesguerilleres.wordpress.com, d’où sont issues les textes de ce livret.
– Féminisme matérialiste : pour ce courant du féminisme profondément anti-essentialiste et issu du marxisme, l’origine du patriarcat ne doit surtout pas être cherchée dans une quelconque nature spécifique des femmes, qu’elle soit biologique ou psychologique, mais bien dans l’organisation de la société. Les féministes matérialistes se sont donc attachées à analyser les rapports sociaux de sexe comme un rapport entre des classes sociales antagonistes et non entre des groupes biologiques. Pour elles, les rapports hiérarchiques entre les classes de sexe sont notamment fondés par une exploitation du travail et du corps des femmes par les hommes, exploitation qui peut recouper l’exploitation capitaliste mais n’y est pas réductible. La perspective politique qui découle de leurs thèses est révolutionnaire, car la lutte des classes de sexe doit aboutir à la disparition de ces classes et donc du genre et du sexe.
– Genre : chez Delphy, le genre est défini comme « le système de division hiérarchique de l’humanité en deux moitiés inégales. », autrement dit la division du travail. Il est pris au singulier, et n’est donc pas individualisant : Delphy ne pense pas le genre comme une identité intrinsèque mais comme une structure sociale qui précède le sexe.[14] Toujours dans un cadre matérialiste, mais plus individuel, le genre peut aussi être appréhendé comme l’expression de sa classe de sexe dans ses comportements, en réponse à la socialisation.
– Sexe : toujours d’un point de vue delphiniste, le sexe est, ou bien la justification biologique à la division arbitraire du genre a posteriori (s’il n’y avait pas de genre, le sexe serait dénué de signification et la binarité n’existerait pas, la nature ne créant pas de catégories, contrairement à la société – il n’existe en effet pas que deux formes de sexuation mais une infinité, qui sont réduites politiquement et chirurgicalement, par des mutilations, à deux ensembles prétendus exclusifs et exhaustifs)[15], ou bien, par extension, la classe de sexe.
– Classes de sexe : classes sociales fondées sur le sexe (et non sur le genre puisque c’est bien le sexe qui fonde notre situation dans les rapports sociaux), dont l’une exploite l’autre (c’est-à-dire vole sa force de travail). La notion de classe sociale désigne, dans son sens le plus large, un groupe social de grande dimension (ce qui le distingue des simples professions) pris dans une hiérarchie sociale de fait et non de droit (ce qui le distingue des ordres et des castes). La hiérarchie est ici bien matérielle puisqu’il y a rapports d’exploitation et d’appropriation.
– Cissexisme : d’après Pauline Clochec, il est « plus approprié de parler de « cissexisme » plutôt que de « transphobie », du fait du caractère trop psychologisant de ce dernier terme, qui fait référence à une peur irrationnelle. Dans nos sociétés patriarcales le cissexisme est d’abord un ensemble d’institutions, de rapports objectifs et de représentations. S’il est bien sûr aussi une peur, une haine et/ou un mépris, ces phénomènes subjectifs ne sont pas des déviances irrationnelles et individuelles par rapport à une norme sociale qui serait, elle, pleine de tolérance. Le cissexisme est une actualisation de la norme patriarcale : la peur, la haine, le harcèlement, les meurtres, les assassinats et les agressions des personnes trans sont des représentations et des comportements absolument normaux dans nos sociétés. On peut contester que ces traits soient rationnels au nom d’une idée plus haute de la raison mais ils appartiennent cependant au type de rationalité ou à la logique propre de nos sociétés. »[16]
– Queer : la théorie queer se rattache au post-structuralisme et à la pensée de l’agentivité (agency, courant sociologique postulant et étudiant la capacité du sujet à agir hors des contraintes sociales structurelles déterministes) et pense le genre et la sexualité comme n’étant pas définies biologiquement, mais pas non plus socialement. Elle s’appuie beaucoup sur la performativité du genre développée par Judith Butler (le genre serait une performance sociale) et est parfois rattachée au matérialisme*, bien que cela soit vivement critiqué.[17]
– Essentialisme : thèse selon laquelle les choses (objets, personnes, catégories, idées, ensembles…) ont une essence, une nature intrinsèque, immuable et naturelle qui leur est propre. Est par exemple essentialiste cellui qui considère qu’il existe une nature féminine, que les femmes se définissent en elles-mêmes et en dehors des rapports sociaux de sexe.
– Matérialisme : thèse métaphysique moniste (qui ne fait pas la distinction traditionnelle corps/esprit) selon laquelle il n’existe rien que de la matière, seule constituante du réel. Sous sa forme dite dialectique, développée par Karl Marx et Friedrich Engels à partir de la philosophie hégélienne, conception selon lequel l’analyse philosophique, économique, politique, historique (et, de façon anachronique, sociologique) doit se réduire à l’analyse de rapports sociaux d’un point de vue des conditions matérielles. C’est un mouvement du contenu – historique, social, économique, humain et pratique – impliquant l’opposition des classes, de la propriété et de la privation, et du dépassement de cette privation ; des contradictions matérielles existantes.[18]
Pour simplifier, le matérialisme* est une position épistémologique, philosophique et politique qui se centre sur les conditions (« matérielles », concrètes) d’existence et notamment la place dans les rapports sociaux de (re)production, d’exploitation, d’appropriation. Par exemple, il est possible de dire qu’il y a inégalité matérielle entre les prolétaires et les bourgeois·es puisque les bourgeois·es détiennent les moyens de production desquels iels tirent profit, tandis que les prolétaires n’ont que leur force de travail qu’iels sont donc contraint·es de vendre aux bourgeois·es. De façon similaire, les femmes, dont le corps est objectifié et approprié par les hommes (cf. sexage), sont contraintes de travailler pour les hommes et sont rappelées à l’ordre par des moyens coercitifs et violents pour les réassigner à cette position subordonnée.[19] Elles sont donc bien matériellement infériorisées par rapport aux hommes.
– Habitus : matrice des comportements individuels, ensemble des façons d’agir en société résultant de sa situation matérielle, de son environnement et de sa situation sociale lors de sa socialisation. Selon Bourdieu, par le biais de cette acquisition commune de capital social, les individus de mêmes classes peuvent ainsi voir leurs comportements, leurs goûts et leurs « styles de vie » se rapprocher jusqu’à créer un habitus de classe.[20]
– **Socialisation : **La socialisation est le processus au cours duquel un individu intériorise les normes, valeurs, et structures sociales et par lequel il formate ses mécanismes psychologiques et sociaux en fonction de différents facteurs (race, classe, sexe, handicap, etc.). Elle résulte des contraintes imposées par les structures sociales, les agents et fonctionnements sociaux et du développement de comportements prosociaux et d’interactions entre l’individu et son environnement matériel et socioculturel. Elle favorise la reproduction sociale.
[1] Front Homosexuel d’Action Révolutionnaire, Rapport contre la normalité, 1971.
[2] France Culture, « Le grain à moudre », Sam Bourcier : « On est dans une revendication du droit à l’autonomisation et dans une dépathologisation », 11 avril 2019. https://www.dailymotion.com/video/x75nx2 m
[3] Daumas C., Paul B. Preciado : « Nos corps trans sont un acte de dissidence du système sexe-genre », Libération, 19 mars 2019. https://www.liberation.fr/debats/2019/03/19/paul-b-preciado-nos-corps-trans-sont-un-acte-de-dissidence-du-systeme-sexe-genre_1716157
[4] Beaubatie Emmanuel, 2017, Transfuges de sexe. Genre, santé et sexualité dans les parcours d’hommes et de femmes trans’ en France, sous la direction de Michel Bozon, EHESS.
[5] Cette notion me semble pertinente pour penser nos situations sociales d’un point de vue matérialiste (et donc également déterministe – dans le sens des rapports de cause à effet à la fois de la matière et des rapports sociaux qui en découlent). Attention toutefois à ne pas réduire cette approche à une normalisation et à une uniformisation des situations sociales : le devenir dans cet article n’est que l’état encore irréalisé.
[6] Ceci malgré la popularité croissante de l’intersectionnalité à gauche, au moins rhétoriquement. La question de si la version « woke Twitter » de l’intersectionnalité prend vraiment au sérieux la coconstruction de la race et le Genre dans la totalité des relations de classes capitalistes reste hors de portée de cet article.
[7] Certain·es peuvent formuler l’objection que les tendances générales de grandes populations sont les seuls phénomènes du genre qui devraient nous intéresser. Dans ce cas, iels ne devraient pas opposer un modèle à une échelle individuelle.
[9] https://colddarkstars.wordpress.com/2019/01/
[10] Je ne crois pas que la transidentité soit explicable par quelque chose d’aussi simple qu’un « gène trans », mais je ne discrédite pas complètement la possibilité d’une origine psychobiologique complexe. En tout cas, cette explication scientifique serait beaucoup moins déterministe et plus attentive aux effets de l’environnement sur une personne que « le cerveau trans » que nous voyons popularisé dans les médias.
[11] D’ailleurs, c’est pour la même raison que nous constatons beaucoup d’expériences en commun parmi des groupes de genre. C’est-à-dire, il existe plus ou moins un vécu de femme trans parce que nous vivons dans des conditions externes similaires. Tout un univers de ressenti existe dans la boîte « femme trans », une boîte qui existe et dont les murs se resserrent en fonction du Genre, les conditions externes que nous vivons.
[12] Ajout lors de la republication : afin d’éviter les présupposés a minima bancals sur lesquels repose le concept de volonté humaine, un brin libéral, nous pouvons l’envisager comme une ignorance des facteurs déterminants entraînant une impression de volonté libre, ou un simple affect déterminé. Spinoza, tout ça, tout ça.
[13] « Male to Female »
[14] (2002). Christine Delphy : « Penser le genre » : Note de lecture par Françoise Armengaud. Nouvelles Questions Féministes, vol. 21(1), 126-133. doi : 10.3917/nqf.211.0126
[15] Christine Delphy, « Le genre précède le sexe », Je ne suis pas féministe mais… https://youtu.be/AIdmbGQR9yM
[16] Pauline Clochec, « Du cissexisme comme système », Observatoire des transidentités https://www.observatoire-des-transidentites.com/2018/10/17/du-cissexisme-comme-systeme/
[17] Elsa Dorlin, « Le queer est un matérialisme* », Les cahiers de critique communiste – femmes, genre, féminisme, 2007, p. 47-58
[18] Pascal Charbonnat, Histoire des philosophies matérialistes, Paris, Kimé, 2013, p.450 ; Henri Lefebvre, Le matérialisme* dialectique, Presses Universitaires de France, 1990, p. 73-76
[19] Christine Delphy, L’Ennemi Principal tome 1 : économie politique du patriarcat, Paris, Syllepse, 2009
[20] Pierre Bourdieu, Questions de sociologie, Paris, Minuit, 2002, p. 65