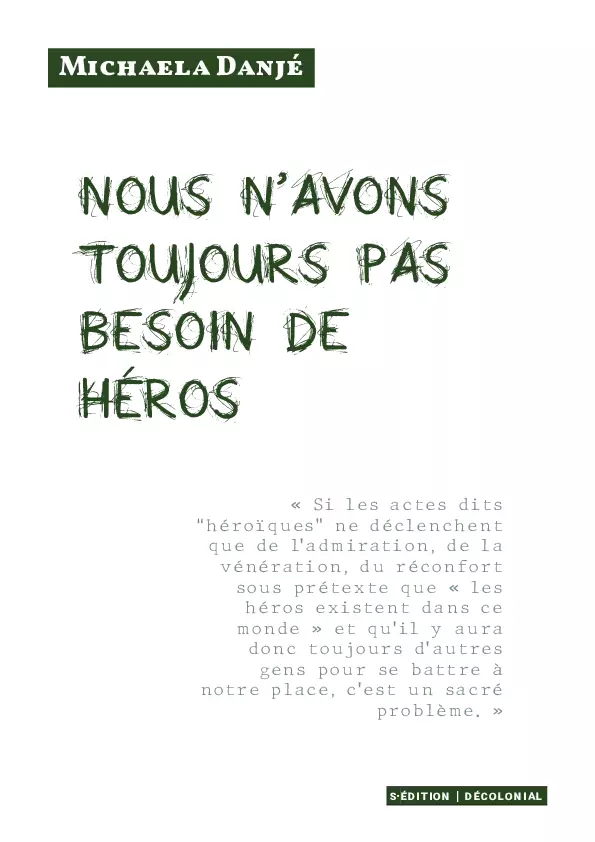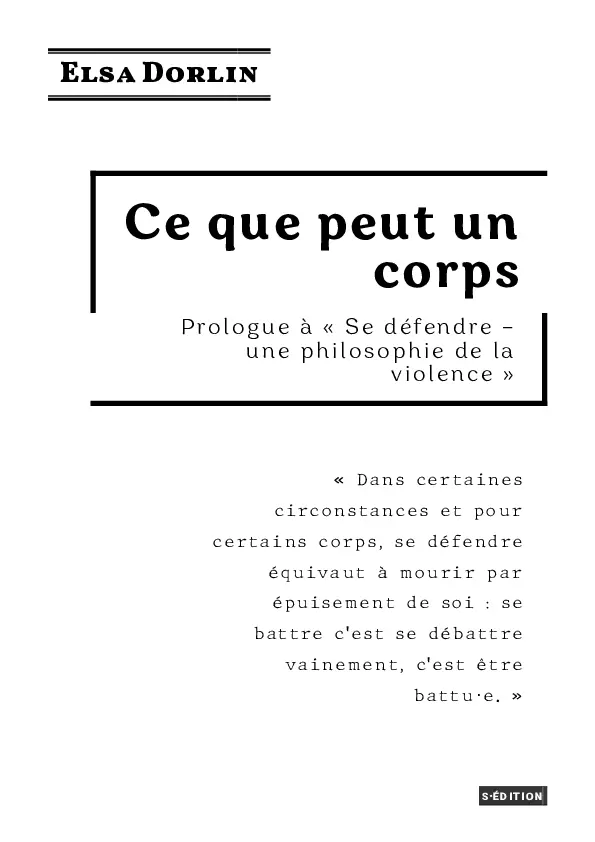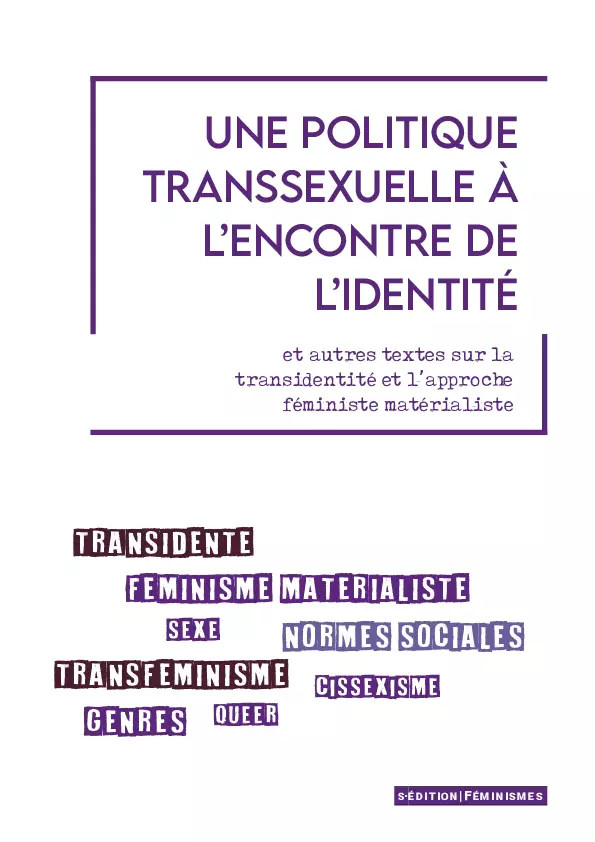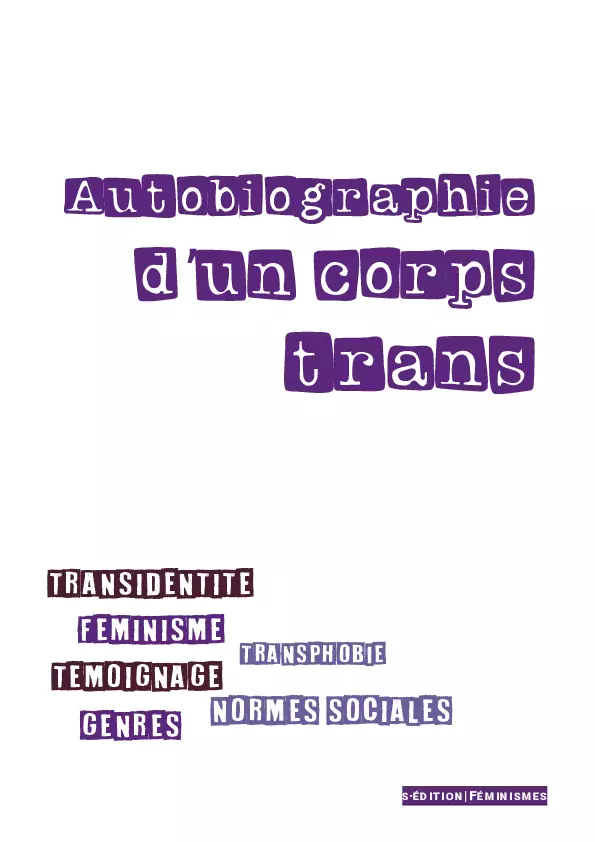Sara Ahmed et Oristelle Bonis — Les rabat joie féministes
Temps de lecture : ~ 35 minutes
Ce texte a été initialement publié en anglais sous le titre “Feminist Killjoys (And Other Willful Subjects)”. The Scholar and Feminist Online, vol. 8, n° 3, en 2010[1]. Il a été traduit en français par les Cahiers du Genre, en 2012** **(n° 53).
Il n’est pas toujours facile de se rappeler comment on est devenue féministe, ne serait-ce que parce qu’il est difficile de se souvenir du temps où on ne se sentait pas féministe. Est-il possible de s’être toujours sentie féministe ? Possible de l’avoir été dès le début ? Une histoire féministe est un début possible. Peut-être parviendrons-nous à faire saisir la complexité de cet espace militant qu’est le féminisme en décrivant comment il devient un objet du sentiment, un lieu d’investissement, une manière d’être au monde, de donner du sens à notre rapport au monde. À quel moment ‘féminisme’ est-il devenu un mot qui vous parlait – un mot ‘parlant’ et qui parle de vous, de votre existence, voire une parole qui vous fait exister ? Un mot dont le son est aussi le vôtre ? De quelle manière nous rassemblons-nous en nous rassemblant autour de ce mot, comment nous lions-nous en nous liant à lui ? Quel sens cela avait-il et quel sens cela a-t-il de s’accrocher au ‘féminisme’, de se battre en son nom ? d’éprouver le sentiment que ses hauts et ses bas, ses va-et-vient, coïncident avec notre parcours personnel ?
Quelle est-elle, mon histoire ? Tout comme vous, j’en ai plus d’une. Pour raconter mon histoire féministe, je peux – c’est une possibilité – partir d’une table. Autour de la table, une famille s’est rassemblée. Nous nous y asseyons toujours à la même place : mon père à un bout, moi à l’autre, mes deux sœurs d’un côté, ma mère en face. C’est toujours ainsi que nous nous asseyons, comme si chacun s’efforçait de protéger sa position. Souvenir d’enfance, certes. Mais souvenir aussi d’une expérience quotidienne, dans le sens, parfaitement littéral, où elle se répétait chaque jour. Quotidienne et intense : mon père qui posait des questions, mes sœurs et moi qui y répondions, ma mère qui la plupart du temps se taisait. À quel moment l’intensité se transforme-t-elle en tension ?
Au commencement, il y a une table. Autour de cette table, la famille assemblée s’engage dans des échanges polis au cours desquels certains sujets seulement peuvent être abordés. Quelqu’un dit quelque chose qui vous pose problème. Vous êtes plus tendue ; ça se tend. Entre vous et ça, il est difficile, vraiment, de faire la différence. Vous réagissez, peut-être en pesant vos mots. Vous expliquez pourquoi, à votre avis, ce qui vient d’être dit pose problème. Et vous avez beau vous exprimer avec calme, vous sentez que vous commencez à vous énerver – vous reconnaissez, et c’est frustrant, que vous vous laissez énerver par quelqu’un d’énervant. Dire ce que vous pensez, mettre les choses sur la table, ne fait qu’aggraver la situation. Vous avez créé un problème en déclarant problématique ce qui vient d’être dit. Vous devenez le problème que vous avez créé.
Vous êtes alors l’objet de la désapprobation générale, de ces regards capables de vous transpercer, de vous exclure. Vous vous êtes aliénée l’entourage, et cette expérience peut faire voler un monde en éclats. La famille se rassemble autour de la table ; ce devrait être un moment de bonheur. Mais tout ce qu’il faut mettre en œuvre pour que ces moments restent heureux, pour que la surface de la table soit assez polie pour renvoyer une belle image de la famille. Tout ce que l’on est censée taire, faire, être pour préserver cette image. Si ce que vous dites, ce que vous faites, ce que vous êtes ne renvoie pas à la famille l’image de son bonheur, le monde paraît déformé. À cause de vous, il y a déformation. Vous devenez vous-même la déformation que vous avez provoquée. Encore un repas de gâché. Se situer hors du cadre de l’image peut permettre de voir ce dont elle n’est pas et ne sera jamais le reflet.
Devenir féministe entraîne parfois à vivre dans l’aliénation du bonheur (mais pas seulement, pas uniquement : oh, la joie de pouvoir quitter la place qu’on vous avait donnée !). Éprouver du bonheur à proximité des bons objets, c’est avoir sa place dans le rang : regarder dans la bonne direction. L’aliénation – la sortie des rangs d’une communauté affective – survient quand lesdits objets ne procurent pas le bonheur attendu. Dans l’écart qui sépare la valeur affective d’un objet et l’expérience que nous avons de cet objet, s’étend toute une gamme d’affects dirigés par les modes d’explication que nous présentons pour combler ce vide.
Lorsqu’une chose censée nous rendre heureuse nous déçoit, nous entreprenons d’expliquer pourquoi la chose en question est cause de déception. Pensez au mariage, imaginé comme « le plus beau jour de votre vie » bien longtemps avant qu’il n’arrive. Que se passe-t-il au Jour J, le grand jour, si le bonheur n’est pas au rendez-vous ? Dans son essai remarquable, The Managed Heart, Arlie Russell Hochschild se penche sur le cas de la mariée qui, au lieu d’éprouver du bonheur le jour de son mariage, se sent « déprimée, contrariée » et vit en conséquence un « affect déplacé », ou se laisse affecter de manière déplacée. Pour sauver la situation, il faut ressentir ce qu’on attend de vous :
Saisissant tout ce qui sépare le sentiment idéal de celui, réel, qu’elle a laissé s’exprimer, la mariée tente de se convaincre d’être heureuse.
Sa capacité à ‘sauver la situation’ dépend de la mesure dans laquelle elle va réussir à convoquer de force les affects qui conviennent, ou à tout le moins réussir à persuader l’entourage que c’est bien ceux qu’elle éprouve. Rectifier nos sentiments, c’est nous déprendre d’une affection plus ancienne, opérer une désaffection. La mariée s’oblige à être heureuse en s’empêchant d’être malheureuse. Cet exemple nous enseigne qu’il est possible de ne pas habiter totalement son bonheur, voire de vivre dans son aliénation, pour peu que l’ancienne affection reste vivace en durant davantage qu’un souvenir, ou que la nécessité même de devoir se résoudre à ressentir ceci plutôt que cela suscite un malaise intérieur.
On ne peut pas toujours combler l’intervalle entre les sentiments éprouvés et ceux qu’il faudrait éprouver. « On ne peut pas » : derrière la formule catégorique existe tout un monde de possibles. Le militantisme opère-il à partir de cet écart pour l’élargir, en étendre les limites ? À ne pas réussir à le combler, on risque d’abord de ressentir comme de la déception, ou un sentiment de déception. La déception peut entraîner une remise en cause angoissante (Pourquoi cela ne me rend-il pas heureuse ? Qu’est-ce qui ne va pas chez moi ?), ou bien un récit rageur qui fait de l’objet ‘censé’ vous rendre heureuse une cause de déception. La rage, quand elle ne le prend pas pour cible, se déverse sur celles et ceux qui vous avaient promis le bonheur en élevant ce genre d’objet au rang de bons objets. Ces moments-là font de nous des étrangères, des parias affectives.
J’appelle ‘parias affectives’ les personnes qui vivent des affects aliénants. Il n’y a pas de chaise pour vous à la table du bonheur. Or que se passe-t-il quand on perd sa place ? Le militantisme est souvent affaire de places assises. Le mot ‘dissident’, par exemple, vient du latin dis (‘à part’) et sedere (‘s’asseoir’). La dissidente est celle qui s’assied à l’écart. Ou encore, celle qui n’aurait pas sa place à table si elle s’y asseyait : il y a désaccord sur la chaise qu’elle y occupe. Dans Queer Phenomenology, mon obsession pour les tables m’a empêchée de remarquer la bizarrerie (queerness) propre aux sièges. J’y ai pourtant glissé que le monde apparaîtrait sous un jour bien différent si nous entamions sa description en partant du corps qui perd sa chaise, ou sa place (Ahmed 2006, p. 138).
Les rabat-joie
Ne pas avoir sa chaise à la table du bonheur, c’est incarner une menace potentielle, non seulement pour la table elle-même mais aussi pour ce qui se trouve rassemblé autour et dessus. Si vous n’y avez pas votre place, vous risquez même de vous mettre dans les pattes des personnes qui y siègent et veulent par-dessus tout conserver la leur. Laisser planer la menace qu’elles pourraient perdre cette place rabat la joie des personnes assises. La figure de la rabat-joie féministe est tellement reconnaissable ! Tellement significative ! Prenons donc au sérieux la figure de la rabat-joie féministe. Rendre la parole à la rabat-joie pourrait être un projet féministe. Si assimiler les féministes à des rabat-joie constitue une forme de rejet, ledit rejet vient ironiquement révéler une capacité d’agir (agency) : nous pouvons répondre par ‘oui’ à l’accusation.
La figure de la rabat-joie féministe prend tout son sens si nous la situons dans le contexte des critiques féministes du bonheur, de la manière dont le bonheur sert à justifier les normes sociales en les présentant comme des biens sociaux (dans la mesure où l’on comprend le bonheur comme quelque chose de bien, un bien social est une cause de bonheur). Pour citer la remarque astucieuse de Simone de Beauvoir :
Il n’y a aucune possibilité de mesurer le bonheur d’autrui et il est toujours facile de qualifier d’heureuse la situation qu’on veut lui imposer.
Ne pas accepter la place ainsi désignée, c’est peut-être aussi refuser le bonheur qu’on nous souhaiterait. S’engager dans l’activisme politique revient donc à engager un combat contre le bonheur. Quand bien même nous nous battons pour d’autres choses, quand bien même il y a d’autres mondes que nous voulons créer, sans doute partageons-nous ce contre quoi nous nous élevons. Raison pour laquelle nos archives militantes sont des archives du malheur. Pensons simplement à la somme de travail critique accompli à ce jour : à toutes les critiques féministes de ‘l’épouse et mère comblée’ ; aux critiques noires du mythe du ‘joyeux esclave’ ; aux critiques queers de la ‘félicité conjugale’ que serait l’hétérosexualité version sentimentale. La lutte dont le bonheur est l’enjeu définit l’horizon de nos revendications politiques. Nous héritons de cet horizon.
Aller délibérément à l’encontre d’un ordre social qui est protégé en tant qu’ordre moral, injonction au bonheur, c’est être prête à provoquer le malheur, quand bien même le malheur n’est pas la cause dont on se réclame. Être disposée à provoquer le malheur n’est peut-être pas sans rapport avec la façon dont nous vivons nos vies individuelles (ne pas choisir ‘le droit chemin’, cela peut se lire comme un refus du bonheur qui, dit-on, suivrait ce chemin). Les réactions parentales au coming-out, par exemple, peuvent explicitement prendre la forme du malheur : le malheur des parents ne vient pas de ce que l’enfant est homo (queer), en fait ils s’affligent du malheur de l’enfant[2]. Même si on ne veut pas causer le malheur de ceux qu’on aime, la vie homosexuelle peut amener malgré soi à vivre avec ce malheur. En acceptant toutefois de provoquer le malheur, on peut s’immerger dans la lutte collective et travailler en association avec d’autres, qui partagent nos points d’aliénation. Celles qui ne trouvent pas leur place à la table du bonheur peuvent toujours se trouver les unes les autres.
Donc, oui, prenons au sérieux la figure de la rabat-joie féministe. Douche-t-elle la joie d’autrui lorsqu’elle signale les situations sexistes ? Ou expose-t-elle au grand jour les sentiments mauvais dissimulés, escamotés ou niés sous les insignes de la joie ? Les sentiments mauvais ne s’invitent-ils que parce que de la colère est exprimée, ou bien la colère marque-t-elle plutôt l’instant où les sentiments mauvais qui circulent entre les objets viennent crever, poindre à la surface d’une certaine façon ? La féministe qui se trouve dans la pièce démoralise donc tout le monde, non seulement parce qu’elle parle de sujets aussi accablants que le sexisme, mais aussi parce qu’elle révèle au grand jour que le bonheur a pour fondement l’effacement des signes de mésentente. Les rabat-joie féministes ‘tuent la joie’, en un certain sens : elles contrarient le fantasme voulant que le bonheur soit accessible dans tels lieux et pas dans tels autres. En tuant un fantasme, on risque aussi de tuer un sentiment. Ce n’est pas simplement que les féministes ne sont pas emballées par ce qui est censé procurer du bonheur : tel qu’il est interprété, notre échec à être heureuses serait un sabotage du bonheur des autres.
Examinons par exemple le rapport entre la négativité de la figure de la rabat-joie féministe et le jugement négatif d’emblée porté sur certains corps. Selon Marilyn Frye, l’oppression nous impose de facto de manifester par des signes divers le bonheur que nous éprouvons de notre condition.
Nous devons, dit-elle, sourire et être gaies, comme on l’exige souvent des opprimés. En nous exécutant, nous exprimons notre docilité, notre consentement à la situation qui nous est faite.
Être opprimée, c’est devoir montrer des signes de bonheur, des signes témoignant que vous vous êtes faite à cette condition même si ça n’a pas été tout seul.
À défaut de rayonner de bonheur, écrit encore Marilyn Frye, tout nous expose à être prises pour des personnes mauvaises, aigries, en colère ou dangereuses.
Être identifiée comme féministe, c’est être assignée à une catégorie difficile, une catégorie marquée par la difficulté. Vous vous dites ‘féministe’, et tout de suite on vous voit comme quelqu’un « avec qui il n’est pas facile de s’entendre ». Vous devez montrer que non, vous n’êtes pas difficile, en affichant des signes de bonne volonté et de bonheur. Frye fait allusion à ce genre d’expérience lorsqu’elle écrit :
Cela signifie, à tout le moins, que nous risquons d’être prises pour des gens « difficiles », ou avec qui il est désagréable de travailler, ce qui peut suffire à priver quelqu’un de son gagne-pain.
La croyance en un malheur féministe (le mythe selon lequel les féministes seraient des rabat-joie parce qu’elles ne savent pas être joyeuses), est encore une chose que nous constatons. Le désir de croire que les femmes deviennent féministes parce qu’elles sont malheureuses existe. Il a pour fonction de défendre le bonheur contre la critique féministe. Je ne veux pas dire par là que les féministes ne connaîtraient pas le malheur : devenir féministe, justement, c’est peut-être prendre conscience qu’il existe quantité de raisons d’être malheureuse. La conscience féministe peut se comprendre comme une conscience du malheur, conscience qui a pour condition de possibilité le refus de détourner le regard. Or, c’est ce sur quoi je veux insister, lorsque les féministes sont vues comme des personnes malheureuses, les rapports de pouvoir, la violence et les conflits sont bien souvent considérés comme la conséquence de leur malheur alors qu’ils en sont la cause.
Engager des luttes politiques sur les causes du malheur est possible, mais nous avons besoin d’écrire une histoire du malheur. Besoin d’entendre dans ce mot, mal-heur, plus que la négation du bon-heur. L’histoire du mot ‘malheur’ a possiblement des choses à nous apprendre sur le malheur de l’histoire du bonheur. Dans sa première acception, le terme ‘malheureux’ s’appliquait à qui s’attirait la malchance ou des ennuis. Ensuite seulement il en est venu à désigner qui se sent malheureux – misérable (wretched) ou triste. La rapidité du transfert de sens – causer le malheur ou être décrit comme malheureux – est elle aussi instructive. Instruisons-nous, il le faut.
L’étymologie du terme anglais wretched (misérable) le dérive de wretched, qui a d’abord désigné un étranger, un exilé, un banni. Apparu en vieil anglais, wretched, qui avait alors le sens « d’individu vil et méprisable », était censé traduire la condition peu enviable des parias. Peut-on récrire l’histoire du bonheur du point de vue de l’étranger, de l’exilé, du banni ? Si nous écoutons les personnes ainsi cataloguées, leur misère cessera peut-être de leur appartenir. La douleur de l’étranger a peut-être un autre point de vue à nous offrir sur le bonheur : non parce qu’elle nous éclairerait sur ce que cela fait ou doit faire de vivre en étranger, mais parce qu’en éloignant de nous le bonheur du familier, elle pourrait bien nous le rendre étranger.
La phénoménologie nous aide à comprendre que le familier est ce qui n’apparaît pas. Une phénoménologie queer montre comment le familier n’apparaît pas à celles et ceux qui l’habitent. Il se révèle à nous, queers et ‘autres autres’, parce que nous ne l’habitons pas. Y être étranger est la condition de la conscience du familier. Raison pour laquelle être une rabat-joie peut constituer en soi un projet de développement du savoir et d’invention d’un monde.
Autour des tables féministes
Les exigences féministes en appellent parfois à la colère, pour développer un sentiment de rage contre les injustices collectives. Il est cependant capital de ne pas instituer l’émotion féministe en lieu de vérité : comme s’il était toujours évident, comme s’il allait de soi que notre colère est juste. Vertueuse, la colère court le risque de devenir tyrannique, et c’est à tort, parfois, que nous considérons qu’elle nous donne raison. Nous savons avec quelle facilité une politique de la colère peut se substituer à une politique du bonheur : le droit présumé au bonheur peut très vite verser dans une colère dirigée contre des autres (des immigrés, des migrants, des étrangers) qui ont pris le bonheur supposé nous appartenir ‘de plein droit’. Notre impuissance à nous préserver d’un usage aussi défensif de l’émotion est précisément ce sur quoi je voudrais m’arrêter. Toutes les émotions ne sont pas justes, y compris celles dont la force est apparemment alimentée par une injustice vécue. Les émotions féministes sont opaques et ne sont transmises que par le biais d’une médiation : ce sont des sites de lutte et nous devons nous obstiner à lutter avec elles[3].
Après tout, les émotions ont toute leur place dans les espaces féministes où la solidarité est rarement pleine et entière. En tant que féministes, nous avons nos tables à nous. Ce n’est pas parce que nous n’avons pas notre place autour de la table familiale que nous allons nécessairement nous asseoir toutes ensemble. La figure de la rabat-joie féministe trouve assez bien sa place à côté de celle de la femme noire en colère, si bien analysée par les écrivaines féministes noires, dont Audre Lorde (voir Lorde 1984) et bell hooks (voir hooks 2000). Rabat-joie, c’est une description possible de la femme noire en colère : elle peut même rabattre la joie féministe, par exemple en attirant l’attention sur les formes de racisme au sein de la politique féministe. Elle n’est d’ailleurs pas obligée d’aller jusque-là pour doucher la joie. Écoutons bell hooks :
Un groupe de militantes féministes blanches qui ne se connaissent pas participent à une réunion pour y débattre de théorie féministe. Sans doute se sentent-elles liées par leur commune qualité de femme, mais qu’une femme de couleur entre dans la pièce et l’atmosphère change sensiblement. La femme blanche se crispe, elle n’est plus détendue, elle n’est plus à la fête.
La ‘tension’ devient perceptible, mais qui plus est elle se loge quelque part : ressentie par certains corps, sa cause est attribuée à un autre, perçu comme s’il était hors du groupe, comme s’il venait faire obstruction au plaisir et à la solidarité. Le corps de couleur est désigné comme cause de la tension qui s’instaure et qui signe aussi la dissolution d’une atmosphère de partage. Si vous êtes une féministe de couleur, vous n’avez même pas besoin d’ouvrir la bouche pour provoquer de la tension. La proximité de certains corps suffit à changer la tonalité affective. Cet exemple en dit long sur la manière dont l’histoire charge l’atmosphère, et sur la capacité de certains corps qui apparaissent comme faisant obstruction à changer cette atmosphère. Est-ce à partir du moment où nous arrivons à situer d’un commun accord les points de tension que s’instaure une atmosphère de partage ?
L’histoire peut perdurer en s’engluant dans une situation de tension. Vous exprimer sous le coup de la colère en tant que femme de couleur revient alors à confirmer votre position de cause de la tension : votre colère est ce qui vient menacer le lien social. Pour citer Audre Lorde :
Quand les femmes de couleur osent extérioriser la colère qui enserre trop de nos contacts avec les femmes blanches, on nous accuse souvent en disant que, je cite “nous créons une atmosphère de désespoir”, “nous empêchons les blanches de surmonter leur culpabilité”, ou encore que “nous faisons obstacle à une communication sereine et à l’action”.
Le dévoilement de la violence devient l’origine de la violence. La femme de couleur doit tirer un trait sur sa colère pour que la blanche puisse avancer.
Image fantasmatique, la figure de la femme noire en colère ne cesse de produire son effet. Des arguments raisonnables, réfléchis, sont disqualifiés au prétexte qu’ils sont inspirés par la colère (ce qui bien sûr vide la colère de sa raison d’être), et comme cela vous met en colère, votre réaction, dans l’interprétation qui en est faite, vient confirmer un fait d’évidence : non contente d’être en colère, vous êtes excessive. Pour dire les choses autrement, la colère devient alors un attribut des féministes de couleur. Votre colère porte sur les façons par lesquelles le racisme et le sexisme réduisent les choix de vie des femmes de couleur. C’est un jugement porté sur une situation d’inégalité. Mais quand, vous entendant, on vous associe à cette colère, on induit qu’elle est le moteur de votre discours. Votre colère, alors, apparaît sans fondement : tout se passe comme si vous étiez contre X parce que vous êtes en colère, et non pas en colère parce que vous êtes contre X. L’injustice qui consiste à interpréter vos propos comme motivés par la colère vous rend furieuse, et il devient plus difficile alors de prendre vos distances avec l’objet de votre colère. Vous ne pouvez plus vous dissocier de lui, tant vous êtes furieuse qu’on ait réussi à vous associer à votre colère. Et en vous mettant en colère contre cette association, vous les engagez encore plus à voir dans votre colère la vérité ‘cachée derrière’ vos propos, ce qui bloque votre colère, l’empêche de s’exprimer. Vous êtes bloquée par l’impossibilité de vous exprimer.
Il est des corps qui deviennent des points de blocage, des points qui rompent la fluidité de la communication. Pensons au magnifique poème en prose d’Ama Ata Aidoo, Notre sœur rabat-joie, où Sissie, la narratrice noire, doit travailler pour que d’autres puissent continuer à vivre à leur aise. Un jour, dans un avion, une hôtesse blanche l’invite à aller s’asseoir dans le fond avec ‘ses amis’, deux Noirs qu’elle n’a jamais vus. Elle voudrait dire qu’elle ne les connaît pas, et puis elle hésite.
Le refus de se joindre à eux aurait créé une situation embarrassante, n’est-ce pas ? Compte tenu, de plus, que même si l’hôtesse avait à l’évidence l’air civilisée et bien éduquée, elle était formée à veiller au confort de tous ses passagers.
Dans cet instant de flottement, c’est le pouvoir qui a la parole. Vous êtes d’accord ? Quel sens cela a-t-il de ne pas l’être ? Créer de l’embarras, c’est être perçue comme embarrassante. Le maintien de conditions confortables pour tous implique ‘l’accord’ de certains corps. Refuser cet accord, c’est refuser la place qu’on vous assigne : on vous voit alors comme celle qui crée des problèmes, qui met les autres mal à l’aise. La manière dont nous qualifions les bons et les mauvais sentiments est l’enjeu d’un combat politique qui oscille autour de la question, toute simple en apparence, de savoir qui suscite quels sentiments en qui. Il est des sentiments qui collent à certains corps à cause de la façon dont nous décrivons les espaces, les situations, les fictions. Et les corps à leur tour peuvent s’engluer, selon les sentiments auxquels ils se voient associés.
Se mettre en travers
Rabat-joie : celle qui se met en travers du bonheur des autres. Ou celle qui tout simplement se trouve être là – car dès l’instant qu’on est là on peut être considérée comme se trouvant en travers de la voie. À elle seule votre entrée dans une pièce est un rappel de toutes les histoires venues se mettre en travers de la façon dont cet espace a été occupé. Il y en a tant, n’est-ce pas, d’histoires féministes portant sur des pièces, des chambres, sur qui les occupe, et sur la place à y faire. À partir du moment où entrer revient à se mettre en travers, que se passe-t-il, que faites-vous ? On pourrait partir d’une politique de l’obstination (willfulness) pour repenser la figure de la rabat-joie. Plus haut, j’ai avancé que les archives militantes étaient des archives du malheur, constituées par les luttes de celles qui se sont obstinées à combattre le bonheur. Combat que nous pourrions décrire aussi comme celui de celles qui sont prêtes à faire preuve d’obstination. Une archive du malheur est une archive de l’obstination.
Revenons en arrière. Prêtons l’oreille à ce qui est derrière nous – à qui nous a précédées. Le terme womaniste désigne, selon Alice Walker, « une féministe noire ou de couleur […]. Il renvoie généralement à un comportement outrancier, audacieux, courageux ou obstiné. Il évoque le désir d’en savoir plus, et de façon plus approfondie, que ce qui est “bon” pour soi, ou considéré tel. […] Une femme responsable, qui prend en charge, sérieuse » (Walker 2005). Le lesbianisme, pour Julia Penelope, est « obstination » :
La lesbienne résiste au monde créé par l’imagination masculine. Quelle preuve d’obstination que de revendiquer de vivre comme nous voulons !
Le féminisme radical de Marilyn Frye prend l’adjectif willful dans le même sens :
La création obstinée [willful] de significations nouvelles, de nouveaux lieux de signification, de nouvelles façons d’être, ensemble, dans le monde, est semble-t-il notre plus bel espoir, en ces temps dangereusement mortels.
L’obstination, équivalent de l’audace, l’obstination comme mode de résistance, créativité.
Une définition classique peut nous aider à comprendre pourquoi l’obstination s’impose. Est obstiné (willful), qui « soutient ou est prêt à soutenir ses intentions face à la persuasion, aux instructions, aux ordres ; gouverné par la volonté sans égard pour la raison ; déterminé à agir à sa guise ; entêté ou pervers » (Oxford English Dictionary). Vous ne vous laissez pas persuader par les arguments raisonnables des autres et on vous traite d’obstinée, de perverse ? Vous connaissez bien cette situation ? Cela évoque quelque chose pour vous ? Vous accuser d’entêtement, c’est assimiler ce que vous êtes à une volonté obstinée d’être ainsi – vous ne voulez pas céder, laisser le passage, changer de direction. Ce qu’on nous impute à charge peut-il devenir une charge au sens où Alice Walker utilise ce mot : ce que l’on prend en charge ? Notre obstination est retenue à charge contre nous ? Nous pouvons l’accepter et mobiliser cette charge.
Sans doute faut-il s’obstiner pour poursuivre dans la même direction, si la direction dans laquelle on va est jugée ‘mauvaise’. Aller à contre-courant d’une foule, dans ‘la mauvaise direction’, est une expérience que nous avons toutes faite. Même si personne ne vous pousse, ne vous presse, vous sentez l’élan collectif de la foule à l’instar d’une poussée, d’une pression. Pour continuer à avancer, vous devez pousser plus fort que tous ces individus qui vont dans la bonne direction. Le corps ‘engagé dans la mauvaise direction’ est perçu, vécu, comme un obstacle qui vient se mettre ‘en travers’ de la volonté impulsée par l’élan. Simplement persévérer à ‘continuer d’avancer du même pas’ requiert de certains corps un effort immense – un effort qui aux yeux des autres risque d’apparaître comme une preuve d’entêtement ou d’obstination, d’acharnement insistant à aller à contre-courant. Il faut se montrer insistante pour avancer à contre-courant ; c’est parce que vous insistez que les autres décrètent que vous allez à contre-courant. Vous êtes alors un paradoxe vivant : il vous faut devenir ce qu’on décrète que vous êtes.
N’allons surtout pas supposer, c’est crucial, que l’entêtement serait le seul fait d’individus solitaires marchant à rebours du social. Mais notons en même temps que le social peut être vécu comme une force : une force ne s’éprouve jamais plus directement que lorsqu’on tente de lui résister. Est nommée obstination l’expérience qui consiste à ‘se dresser contre’, raison pour laquelle une politique de l’obstination doit nécessairement être une politique collective. Collectif à penser ici autrement que comme un socle fondateur : par obstination, il faut plutôt entendre la volonté de se rassembler de celles qui luttent pour assurer l’existence sur d’autres bases. On a besoin de soutien quand on ne suit pas le mouvement général. C’est pour cela que dans mon esprit une politique féministe queer est une politique de la tablée : les tables offrent des appuis aux rassemblements, et nous avons besoin d’être appuyées dès lors que nous vivons nos vies avec ce que les autres, à partir de leur expérience, perçoivent comme de l’entêtement ou de l’obstination.
Un flux est un effet produit par des corps allant dans la même direction. Aller, c’est aussi se rassembler. Un flux peut être l’effet de rassemblements de toute sorte : de tables, par exemple, objets apparentés qui appuient des rassemblements humains. Il m’est arrivé si souvent de devoir attendre une table alors qu’un couple ‘normal’ s’en voyait normalement proposer une. Certaines doivent insister pour devenir les bénéficiaires d’une prestation sociale : il faut signaler sa présence, agiter le bras, lancer : « Hé, ho ! Je suis là ! » D’autres n’ont qu’à se montrer, car il et elle ont déjà leur place à table avant même de l’avoir prise. L’obstination décrit les conséquences inégales de cette différenciation.
À la qualification d’entêtement s’ajoute l’attribution d’affects négatifs aux corps venus se mettre en travers, à ces corps qui en se mouvant tels qu’ils se meuvent vont ‘à contre-courant’. Être qualifiée de têtue vaut donc, de fait, accusation : vous êtes rabat-joie. Les discussions aussi suivent des flux, des courants ; elles sont saturées, et leur saturation perceptible caractérise l’ambiance. Vous qualifier de têtue revient à vous désigner comme celle qui ‘casse l’ambiance’. Une collègue m’a raconté qu’il lui suffisait d’ouvrir la bouche, dans les réunions, pour s’attirer des regards exaspérés qui signifient clairement « ça y est, elle la ramène ». Les regards exaspérés n’ont pas de secrets pour moi, féministe ayant grandie dans une famille conventionnelle. On sait, forcément. Quoi qu’elle dise, celle qui s’exprime en tant que féministe est généralement perçue comme une querelleuse qui ‘déclenche la dispute’, qui trouble la paix fragile. Être obstinée, c’est fournir un point de tension. L’obstination a les propriétés de la glue : c’est une accusation qui colle à la peau.
Si nous qualifier d’obstinées revient à nous désigner comme la cause du problème, il nous faut donc revendiquer cette obstination et en faire notre socle politique. Dans l’histoire du féminisme queer, ce ne sont pas les sujets obstinés qui manquent. Pensons par exemple au Club de l’Hétérodoxie, un club qui au début du xxe siècle rassemblait des femmes non orthodoxes à Greenwich Village. Elles se décrivaient comme une « petite bande de femmes obstinées [willful] », ainsi que nous l’apprend Judith Schwarz dans le livre magnifique consacré à ce club (Schwarz 1986, p. 103). Est hétérodoxe qui « ne souscrit pas aux croyances communément admises, ou soutient des opinions non orthodoxes ». Se montrer obstinée, c’est volontairement faire état de son désaccord, c’est se positionner en fonction d’un désaccord. Et rendre public ce désaccord amène parfois à se montrer désagréable. Le féminisme, pourrait-on dire, est une création de femmes plutôt désagréables.
L’histoire politique des grèves et des manifestations est celle d’individus déterminés à se mettre physiquement en travers, à faire de leurs corps des points de blocage venus interrompre le flux de la circulation humaine et les flux plus massifs de l’économie. Quand elle devient style politique, l’obstination ne désigne plus simplement la volonté de ne pas aller dans le sens du courant, elle en vient à désigner la volonté de l’obstruer. On peut considérer qu’une grève de la faim est de l’obstination sous sa forme la plus pure : un corps qui exprime sa capacité d’agir (agency) en se laissant ramener à une volonté d’obstruction, une situation où l’obstruction aux autres devient auto-obstruction – obstruction du passage dans le corps. L’histoire de l’obstination est l’histoire de celles et ceux délibérément prêt·e·s à se mettre physiquement en travers.
Les formes politiques de la conscience aussi peuvent se ramener à de l’obstination : non seulement il est difficile de parler de ce qui désormais disparaît aux regards, mais qui plus est il faut être déterminé à contrarier ce mouvement de récession en se mettant en travers. Un des arguments du féminisme de la deuxième vague (qu’il partage avec le marxisme et les mouvements politiques noirs) vaut à mon avis la peine d’être défendu : que la conscience politique n’est pas donnée, mais atteinte. Susciter la prise de conscience est un aspect essentiel du travail politique collectif, et la tâche est ardue dans la mesure où la conscience est conscience de ce qui recule. Pour autant qu’un point de récession soit ce qui donne en partie le pouvoir d’occuper l’espace (l’occupation est reproduite par la dissimulation des signes d’occupation), toute prise de conscience est une résistance à une occupation.
Prenons l’exemple du racisme. Nommer le racisme : cela seul peut être une preuve d’obstination, comme si le discours sur les divisions était ce qui divise. Comme la conscience sociale du racisme est en recul, mettre le sujet sur la table revient semble-t-il à le faire exister. J’ai déjà souligné que le fait même de parler du racisme est vécu comme une intrusion de la femme noire : comme si sa colère contre le racisme était ce qui provoquait les divisions au sein du féminisme. Reculer revient à revenir en arrière ou se retirer. Concéder revient à s’incliner, à céder. On demande souvent aux personnes de couleur de concéder que le racisme est en recul : on nous demande de nous incliner, de céder le passage pour qu’il puisse se retirer peu à peu. Mais ce n’est pas tout. Au-delà, on nous demande souvent d’incarner un engagement en faveur de la diversité : il nous faut sourire dans leurs brochures. Le sourire de la diversité a pour fonction d’empêcher l’émergence d’une conscience du racisme : c’est une forme de recul politique.
Il est extrêmement difficile de parler du racisme, car le racisme agit aussi en censurant la preuve même de son existence. Il s’ensuit que parler du racisme expose à passer pour quelqu’un qui ne s’emploie pas à le décrire mais à le fabriquer de toutes pièces. Les enjeux sont très élevés : parler du racisme, c’est occuper un espace saturé par la tension. L’histoire est saturation. Un projet de recherche sur la diversité auquel j’ai participé a notamment révélé que le racisme sature les espaces institutionnels et le quotidien, au point que les personnes de couleur sont fréquemment amenées à prendre des décisions stratégiques visant à ne pas évoquer le racisme qu’elles subissent (Ahmed et al. 2006). Si d’emblée votre présence pose problème, si elle paraît ‘déplacée’ au sein des institutions de la blanchité (whiteness), vous pouvez avoir de bonnes raisons de ne pas vous servir d’un lexique pouvant être perçu comme menaçant (Puwar 2004). Ne pas parler du racisme peut être une façon d’habiter les espaces du racisme. Vous atténuez la menace que déjà vous incarnez en arrondissant les angles de votre langage, de votre apparence, en vous distanciant le plus possible de la figure de la personne noire en colère. Naturellement, nous le savons, il suffit parfois de pénétrer dans une pièce pour que la distance s’abolisse, car cette figure vous précède.
Si vous parlez du racisme, on va trouver que décidément vous tenez « à remettre le sujet sur la table », que vous ne voulez pas en démordre. Comme si le racisme ne se maintenait que parce qu’on en parle. Le racisme apparaît ainsi souvent, dans les formes de représentation contemporaine, en tant que représentation d’une expérience passée. Prenez le film Joue-la comme Beckham (2002, réalisation : Gurinder Chada). La liberté d’être heureux est l’un des principaux postulats du film – en l’occurrence il s’agit de la liberté de la fille, Jesminder, de faire ce que bon lui semble pour être heureuse (elle veut jouer au foot : l’idée qu’elle se fait du bonheur la met à proximité d’une certaine conception nationale du bonheur). Son père n’a pas oublié le racisme, et ses souvenirs viennent se mettre en travers du bonheur de Jesminder. Rappelons deux de ses interventions dans le film ; la première a lieu au début et la seconde à la fin :
Quand j’étais jeune, à Nairobi, personne ne lançait la balle comme moi sur les terrains de cricket de l’école. Notre équipe a même gagné la coupe d’Afrique de l’Est. Mais quand je suis arrivé dans ce pays, plus rien. Les connards de Blancs du club ont ri de mon turban et m’ont envoyé faire leurs sacs. Elle finira forcément par être déçue, comme moi.
Quand les joueurs anglais de cricket, ces connards, m’ont flanqué à la porte de leur club comme un chien, je ne suis pas allé me plaindre. Au contraire, j’ai juré que je ne jouerais plus jamais. Qui en a souffert ? Moi. Mais Jess, non, je ne veux pas qu’elle souffre. Pas question qu’elle fasse les mêmes erreurs que son père, qu’elle accepte la vie comme elle est, qu’elle accepte les difficultés. Elle, je veux qu’elle se batte. Et je veux qu’elle gagne.
Quand il intervient pour la première fois, le père déclare qu’elle ne devrait pas jouer pour ne pas souffrir comme il a souffert. La deuxième fois, il dit qu’elle devrait jouer pour ne pas souffrir comme il a souffert. Ces deux prises de parole contiennent le désir implicite de prévenir la souffrance de la fille, exprimé comme désir qu’elle n’aille pas reproduire la souffrance du père. La seconde intervention laisse entendre que le refus de participer à un sport national constitue la ‘vérité’ cachée derrière la souffrance de l’immigré : tu souffres parce que tu ne joues pas, ne pas jouer s’entendant ici comme une exclusion que le sujet s’inflige. Pour que Jess puisse être heureuse, il doit la lâcher, la laisser faire à sa guise. Et du coup, il lâche aussi sa souffrance, le malheur dû à son acceptation du racisme en tant que ‘raison’ de son exclusion.
Dans la première intervention, le père, à mon sens, est représenté en mélancolique : il refuse de lâcher sa souffrance, il a incorporé l’objet même de la perte. Son refus de laisser Jess jouer peut s’interpréter comme un symptôme de la mélancolie : une fixation obstinée sur sa blessure[4]. Il le dit d’ailleurs lui-même : « Qui a souffert ? Moi. » Un sentiment désagréable naît chez l’immigré qui s’accroche au racisme, ce scénario où la souffrance trouve son explication. L’immigré malheureux ne veut pas lâcher les tristes insignes de la différence, le turban par exemple, ou le souvenir des moqueries que lui a valu son turban, car ils sont ce qui relie la différence à une histoire du racisme. Comme si pour tirer un trait sur la douleur du racisme il fallait renoncer à voir dans le racisme un mémento de cette douleur. J’irai jusqu’à dire qu’il devient possible de voir dans le racisme ce à quoi est attaché l’immigré mélancolique : attachement à une blessure qui permet aux immigrés de justifier leur refus de participer au sport national (les blancs dans leur club). Se souvenir d’une expérience de racisme, ou décrire une expérience en l’associant à du racisme, cela peut suffire à se mettre en travers du bonheur d’autrui.
La conscience du racisme finit par être appréhendée comme une espèce de fausse conscience, une conscience de ce qui désormais n’est plus. Le racisme mis sous verre devient un souvenir qui nous épuiserait si nous le conservions vivant. Opérer la conversion est un devoir citoyen : si le racisme n’est plus conservé que dans nos mémoires, dans nos consciences, alors il s’en ira, pour peu que nous voulions bien, nous aussi, déclarer sa disparition. Ici, le scénario implicite ne dit pas que ‘nous inventons’ le racisme, mais que faute d’arriver à ‘tourner la page’, nous lui conservons intact son pouvoir sur la vie sociale. ‘Tourner la page’ est par conséquent un devoir moral, comme si le seul fait de passer à la page suivante annulait la précédente.
Conclusion : Manifeste de la rabat-joie
La liberté d’être heureuse a vite fait de se traduire en liberté de détourner le regard de ce qui compromet le bonheur : c’est un des enseignements d’Audre Lorde (1984, p. 76). L’histoire des critiques féministes du bonheur se laisse aisément transposer en manifeste : ne détournez pas le regard, ne tournez pas la page. Refuser de tourner la page est une forme de déloyauté. L’obstination elle-même est une forme de déloyauté : pensons à l’appel lancé par Adrienne Rich pour nous engager à la déloyauté vis-à-vis de la civilisation.
Nous ne fermerons pas les yeux sur ce qui perdure. Nous ne serons pas loyales à ce qui porte préjudice.
Sans doute faut-il repenser l’obstination pour la poser en style politique : un refus de détourner le regard de ce sur quoi trop souvent on ne s’arrête pas. Celles qui insistent sur la réalité du racisme, du sexisme et de l’hétérosexisme sont accusées d’entêtement : elles refusent qu’on ferme les yeux sur ces réalités. Dans un monde où ‘le bonheur de la diversité’ est employé comme technologie de description du social, le simple fait de parler d’injustices, de violence, de pouvoir, de subordination peut signifier faire obstacle, ‘se mettre en travers’ du bonheur des autres. Ainsi, tel qu’il est perçu, votre discours semble remuer le couteau dans la plaie, comme si vous vous accrochiez à on ne sait quoi – à une mémoire individuelle ou collective, à l’idée que cette histoire n’a pas trouvé sa résolution – en raison de la douleur que vous ressentez. On dit souvent que s’engager politiquement dans la lutte contre le racisme revient à se taper la tête contre un mur. Le mur reste en place, mais qui s’y cogne se blesse. Peut-être nous faut-il accepter cette douleur, même si bien entendu nos discours et nos actions ne s’y résument pas. Nous pouvons non seulement reconnaître que nous ne sommes pas la cause du malheur qui nous est imputé, mais aussi apprécier les effets d’une telle imputation. Nous pouvons revendiquer la position de sujets obstinés, revendiquer d’être des rabat-joie féministes, des femmes noires en colère, parler des discussions que nous avons eues à table, dans des séminaires ou des réunions, et rire en reconnaissant combien le lieu que nous occupons nous est familier – même si nous n’occupons pas toutes (décidément pas) le même lieu. On peut même trouver une certaine joie dans la critique du bonheur à laquelle nous nous engageons. Car obstinées nous sommes et obstinées nous resterons.
[1] (http://sfonline.barnard.edu/polyphonic/print_ahmed.htm).
[2] Voir, par exemple, Nancy Garden (1982, p. 191).
[3] Sur l’émotion féministe, on peut notamment se reporter aux travaux précurseurs d’Alison Jaggar (1996) et d’Elizabeth Spelman (1989). On trouvera un argument essentiel sur la nécessité de faire la différence entre l’injustice et le rapport personnel à la douleur et au sentiment d’avoir été blessée dans Lauren Berlant (2000). Enfin, pour une mise en relation plus poussée du féminisme et de l’émotion, voir “Feminist Attachments” (Ahmed 2004), où l’étonnement, l’espoir et la colère sont considérés comme des émotions féministes.
[4] La question de la mélancolie raciale est particulièrement bien exposée par Anne Anlin Cheng (2001) et par David L. Eng et Shinhee Han (2003).