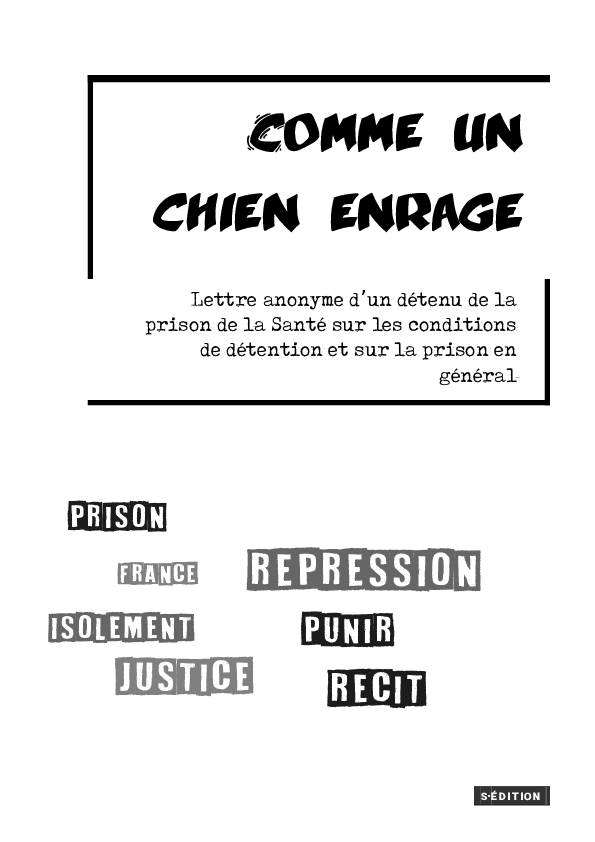Olivier Razac — contre l'abolitionnisme
Temps de lecture : ~ 29 minutes
Cet article est issu d’une intervention au colloque Peine et utopie organisé par Jérôme Ferrand, Marc Ortolani et Ugo Bellagamba (laboratoires Ermes, Université Côte d’Azur et Cerdap2, Université Grenoble Alpes) à Nice les 7 et 8 décembre 2017
Le titre choisi, « contre l’abolitionnisme », de la prison ou de la peine, même assorti d’un point d’interrogation, peut certes paraître un peu brutal. Quoique pas pour tout le monde, pour beaucoup il s’agirait plutôt d’une évidence[1]. Mais ici, au sein de réflexions sur les rapports entre peine et utopie, il sonne comme une provocation. En fait, il faut l’entendre d’une manière plus malicieuse. Ce propos n’a pas vocation à rejeter purement et simplement une position politique mais à la problématiser pour pouvoir se la réapproprier. La question posée repose en effet sur un embarras théorique et pratique concret, vécu, face à deux positions opposées. Celle d’un « réformisme mou », d’un côté, qui consiste à se contenter de revendications d’amélioration des conditions de détention mais aussi d’une meilleure efficacité de l’institution carcérale. Par exemple selon cette idée « militante », en partie interne à l’administration pénitentiaire, qui consiste à promouvoir l’alignement des droits des détenus sur le droit commun à partir de l’appellation d’« usager du service public pénitentiaire ». On comprend, qu’en retour, si les détenus sont des usagers, l’administration pénitentiaire est, ou doit devenir, un vrai service public. Ce qui implique qu’elle soit soumise à des exigences gestionnaires d’efficacité et plus seulement à un impératif symbolique de rétribution toujours obscurément mêlé d’un pathos de vengeance sociale et individuelle. On prétend coupler ainsi progrès administratif et progrès humaniste, voir émancipateur[2].
Après avoir longtemps vécu et perçu les inévitables va-et-vient entre ces deux pôles binaires, de fait à somme nulle ou quasiment nulle, je voudrais suivre cette ligne, aussi confortable qu’un tranchant de rasoir, qu’on peut appeler « réformisme radical »[3]. Pour esquisser cette ligne, nous passerons par plusieurs déplacements de la manière de poser le problème : Il s’agira d’abord de fermer une possibilité ambiguë, celle de la disparition, plus ou moins rapide, de la prison par le développement de la probation, des peines dites alternatives » à l’incarcération. Cela nous poussera à poser la question au niveau d’un abolitionnisme pénal en général, ce qui implique également de dépasser la question pénale vers la question sociale. La disparition du pénal inhérent à un ordre social supposant en effet un changement radical de cet ordre. Mais alors on aura peut-être l’impression d’être passé de l’autre côté. Par un effet de purification, nous aurions dépassé des positions médiocres et coupables (réformisme humanitaire, réductionnisme carcéral, développement des « alternatives » etc.) vers une position entière et sans tâches, la seule défendable, à partir de laquelle nous pourrions juger et condamner toutes les demi-mesures. Or, nous voudrions sortir de ce dualisme. Ce que l’on voudrait dire ici est à la fois simple et difficile à accepter et à pratiquer, en particulier d’un point de vue militant. C’est que toute affirmation d’une transformation, ou plutôt d’une rupture radicale, de l’ordre social existant et de son fonctionnement part de cet ordre et se construit progressivement selon un certain trajet théorique et pratique. En se coupant ensuite de l’existant et du parcours qui a permis de s’en dégager, cette position ne gagne pas en force, c’est-à-dire en capacité d’avoir des effets, mais se place d’elle-même dans le ciel des idées d’autant plus belles qu’elles sont impuissantes.
Des illusions de la concurrence entre probation et prison
Au-delà de l’illusion intenable selon laquelle la prison pourrait se réformer elle-même afin de correspondre aux exigences d’une peine véritablement moderne, on trouve le projet le plus consistant, historiquement, d’une réforme interne du système pénal, celui de la « probation ». Concernant l’impossible réforme carcérale, il y aurait plusieurs argumentations possibles. Celle de Foucault paraît la plus convaincante parce qu’elle ne se contente pas d’un constat historique empirique du type : « Non seulement la prison pénitentiaire moderne n’a jamais cessé d’être considérée comme une institution en échec, mais les reproches qu’on lui adresse restent globalement les mêmes aujourd’hui qu’au début du 19ème siècle (insalubrité, incapacité éducative ou réformatrice et, comme on sait, « école du crime »[4]) ». Au-delà de ce constat, la critique foucaldienne identifie une contradiction structurelle et fonctionnelle au principe du projet de la prison moderne. Cette contradiction se repère d’abord au niveau des finalités de l’institution qui doit, d’un côté, appliquer la loi pénale, c’est-à-dire permettre la rétribution symbolique et politique d’un citoyen ayant volontairement désobéi aux règles communes et, d’un autre côté, produire une utilité sociale en transformant l’individu, par le même moyen, afin qu’il adopte un comportement normal. Les tensions entre ces deux finalités sont redoublées pour des raisons plus conjoncturelles par le fait, d’une part, que cette rétribution et cette correction auraient aussi bien pu être effectuées par d’autres moyens que la privation de liberté, d’autre part, qu’une fois la privation de liberté largement privilégiée par le développement progressif d’un archipel carcéral, ces institutions, ces dispositifs, sont face à des exigences fonctionnelles tout à fait indépendantes de l’application de la loi, c’est-à-dire maintenir l’ordre interne et empêcher les évasions. On pourrait ajouter différentes figures de cette contradiction, voire de ce paradoxe : celle d’un espace d’exclusion souveraine d’ennemis, en même temps qu’un espace d’inclusion quasi thérapeutique d’individus à réformer ; celle d’une temporalité tournée vers l’acte passé, en même temps que tournée vers des comportements futurs etc. D’où cette idée d’une « impossible prison[5] » mais qui continue d’exister et même de se développer sans jamais remettre en cause la structure du problème qu’elle pose.
-
- Il faut tout reprendre à la base. Ce n’est pas qu’on n’ait pas songé depuis longtemps à réformer. Tantôt le code, tantôt les institutions pénitentiaires. Mais précisément, l’insuffisance, donc le danger, est là, dans cette politique du couteau de Jeannot : un coup le manche, un coup la lame. Il y a d’un côté l' « idéalisme » de la loi, ou sa pudibonderie : elle connaît ce qu’elle interdit et les sanctions qu’elle prévoit ; mais elle regarde de loin et d’un œil impavide les institutions et les pratiques qui la mettent en œuvre : après tout, ce que fait la police, ou ce qui se passe dans les prisons, n’a pas tellement d’importance, du moment que cela permet de faire respecter la loi. Quand on réforme le code, on pense aux principes de l’interdiction, non à la réalité du châtiment. En face, il y a le « pragmatisme » de l’institution pénitentiaire : elle a sa logique ; elle a ses procédés et ses prétentions. Quand on a entrepris de la réformer, on a toujours cherché à savoir comment elle pourrait corriger ce qu’il y a dans la loi de général, et de rigide : comment elle pourrait, sous la caution plus ou moins mythique de la psychologie, de la médecine ou de la psychiatrie, gérer une punition, dont elle revendique pour elle seule la compétence. Ainsi, cahin-caha, depuis plus de cent cinquante ans ont avancé les réformes : celles de la loi qui ne veut pas sa voir comme elle punit ; celles du régime pénitentiaire qui tente de se substituer au droit[6]. »
Ainsi, quelle que soit la rigueur du constat, le discours d’échec de la prison moderne est rigoureusement attaché à son histoire. Donc la réforme pénale ne peut pas venir de la prison, elle doit venir d’ailleurs, d’une autre forme de peine, c’est dans cette perspective que se construit le discours moderne de la probation, dès ses débuts. On peut se contenter ici de tracer une ligne générale partant du constat de Matthew Davenport Hill en 1840 selon lequel : « [Dans la mesure où] l’on avait raison de croire que l’individu n’était pas entièrement corrompu – où l’on pouvait raisonnablement espérer son redressement – et où l’on pouvait trouver des personnes assez généreuses pour servir de tuteurs et se charger du jeune délinquant, [on estimait fondé] de remettre immédiatement le jeune délinquant aux soins de ces personnes, persuadé que les chances de redressement étaient meilleures sous la surveillance de ces tuteurs que dans la prison du comté[7]. » Argument rappelé avec force à partir des années 1950 par les tenants de la Défense sociale nouvelle auxquels se réfèrent directement ou indirectement ceux qui croient encore que la probation possède la moindre dimension « alternative » et que l’on pourrait jouer la probation contre la prison. Marc Ancel peut ainsi dire qu’« un des principaux problèmes de la politique criminelle d’aujourd’hui est, sauf les exceptions inévitables, de se « débarrasser de la prison"[8]. » Tout en demandant immédiatement : « par quoi la remplacer ? ». La liste des « évolutions » de la politique criminelle passe alors par les formes « allégées » d’emprisonnement, les formes de probation (dont sont distinguées le « traitement » médicalisé ou le travail obligatoire alors cités en référence au système soviétique mais qui font aujourd’hui partie de l’arsenal probatoire sous la forme de l’obligation de soin presque systématique et du Travail d’intérêt général), suivent l’amende et, finalement, le processus de dépénalisation dont on sait le « succès » qu’il a eu…
Depuis cette époque, Il existe un large consensus réformiste et progressiste selon lequel les différentes formes de probation pourraient permettre de lutter contre l’utilisation abusive de la prison, voire contribuer à la faire disparaître progressivement. Pourtant, cette idée n’a aucune consistance et ne résiste pas à quelques arguments aussi simples qu’imparables. D’abord, quantitativement, nulle part le développement du, très mal nommé, « milieu ouvert » n’a permis une déflation carcérale. Au contraire, le développement conjoint des deux dispositifs a produit une très large extension de la population pénale (enfermée et non enfermée)[9]. Ensuite, sociologiquement, une mesure de probation recrute dans la population de mesures de probation moins contraignantes beaucoup plus que sur la population carcérale. Les mesures de probation produisent une extension du filet pénal (augmentation de la quantité, de la diversité et de l’intensité de la répression pénale)[10]. Enfin, structurellement, les peines de probation reposent toutes sur la menace de l’incarcération. Prison et probation ne sont que deux faces d’un système fonctionnellement intégré. Développer la probation implique l’existence de la prison et, plus encore, les « échecs » de probation nourrissent l’incarcération.
Malgré ces constats et arguments maints fois rappelés, le mythe de la probation alternative a la peau dure. Un petit récit canadien quelque peu « mythifié » nous permettra de saisir la portée pratique de cette illusion. Tout serait parti d’un traumatisme originel, comme souvent dans les mythes, l’article de Martinson dans les années 1970, caricaturé par la suite dans l’expression : « Nothing works », c’est-à-dire qu’il serait indémontrable que des peines de réinsertion actives dans la communauté sont plus efficaces pour prévenir la récidive que de laisser croupir les gens en cellules. Face à cela, les acteurs de la probation canadienne, souvent humanistes et progressistes d’une manière affirmative, se seraient lancés dans la construction de grande ampleur d’un système pénal intégré du concept « What works ? » (qu’est-ce qui marche ?) qui désigne la capacité à démontrer, dans le langage quantitatif et gestionnaire de l’administration, l’efficacité des mesures pénales en général et de la probation face à la prison en particulier. Le rêve était qu’en indexant la probation sur l’exigence de sécurité publique (en l’occurrence plutôt du public des victimes potentielles) sous l’angle du paradigme du risque (sur l’évaluation et le traitement quantifiés des risques de passage à l’acte), on pourrait défendre objectivement la probation comme plus efficace que la prison et donc permettre une sérieuse déflation carcérale. Ce n’est pas ce qui s’est passé. Le résultat a été une augmentation du taux d’incarcération, une extension et une systématisation du paradigme du risque (même pour les courtes peines), une limitation des libérations conditionnelles, un durcissement du régime de probation, une technicisation et une déshumanisation de l’accompagnement[11]. À tel point que les canadiens, et d’une manière plus générale certains acteurs du positivisme du « What works ? », ont opéré une auto-critique de ce processus afin de rééquilibrer le système[12]
Pour autant, cela n’empêche pas des institutions françaises de réactiver le même type d’arguments en faveur du développement de la probation comme alternative à l’incération. C’est le cas d’une partie de l’administration de la justice, ce qui a particulièrement été visible autour du processus de la Conférence de consensus pour une nouvelle politique publique de prévention de la récidive en 2013, portée par Christiane Taubira. On sait que les résultats sont faibles, en témoigne l’échec de la « contrainte pénale »[13] qui se voulait une peine de probation détachée de l’incarcération, mais qui ne pouvait être qu’un sursis avec mise à l’épreuve bis n’ayant pour effet que de complexifier la réponse pénale. Plus étonnant, ce discours alternatif structurellement et empiriquement fautif reste également porté par des institutions plus contestataires comme le syndicat Snepap-Fsu dans une alliance ambiguë avec les abolitionnistes, ou plutôt réductionnistes, de l’Observatoire International des Prisons. En témoigne le travail de Sarah Dindo sur le sursis avec mise à l’épreuve[14] qui articule trois aspects : une commande de l’Administration pénitentiaire dans un contexte de mouvement social des agents de probation, une volonté affichée de jouer la probation contre la prison (« Je voulais réaliser une étude de terrain sur la probation, dont je pense qu’elle est « l’avenir de la peine », alors que la prison relève d’une culture passéiste[15] »), une stratégie de technicisation du métier pour le rendre plus crédible en transposant les outils étrangers. Cela n’a donné et ne donnera aucun résultat de réduction carcérale et ne peut que provoquer une extension, une diversification et une intensification de la réponse pénale générale.
Ce qu’implique l’abolitionnisme pénal
Il est donc nécessaire de dépasser la revendication d’abolition de la prison et d’inclure dans cette revendication les peines dites « alternatives », en fait « itératives », donc de s’acheminer vers un abolitionnisme pénal plus cohérent, mais aussi plus ambitieux. Insistons sur le fait qu’il ne s’agit pas ici d’un « choix » politique mais d’une nécessité argumentative, l’autre possibilité (probation versus prison) étant tout simplement dépourvue de sens. L’abolitionnisme pénal est un champ discursif et pratique ancien et complexe. Il ne s’agit pas d’en synthétiser la problématique ou même de privilégier tel ou tel courant. Les quelques arguments proposés ici ont un objectif beaucoup plus restreint. Il s’agit d’abord d’expliciter les présupposés d’une approche du crime et de la peine qui soutiennent une approche abolitionniste du problème. Pour cela, je m’inspirerai librement du concept de « comportement problématique » tel que posé par Christian Debuyst dans les années 1970 et 1980. Cela permettra ensuite de mieux saisir à quels niveaux on doit agir et ce dont on a besoin si l’on prétend régler toute une série de conflictualités et de violences sociales sans faire appel à la réaction pénale. Nous pourrons enfin saisir la radicalité politique impliquée logiquement par toute posture abolitionniste de ce genre.
Christian Debuyst, assistant d’Étienne De Greef dans les années 1950, a marqué la psychologie clinique appliquée au phénomène criminel en articulant les problématiques liées classiquement au passage à l’acte individuel avec les approches plus sociologiques centrées sur la réaction sociale et le fonctionnement de la répression légale[16]. Il a longtemps enseigné à l’École de criminologie de l’Université de Louvain dans une proche de la criminologie critique portée, entre autres, par la revue Déviance et société, surtout dans les années 1970 et 1980. Si on ne peut pas parler d’une approche frontalement abolitionniste, Debuyst propose de sortir de la seule perspective pénale, aussi bien en ce qui concerne la compréhension que le traitement du phénomène dit « criminel ». Il s’agit d’abord de changer de langage et de perspective d’analyse concernant les actes que les praticiens ou les acteurs du système de justice (voire l’opinion publique ») abordent comme toujours déjà définis et configurés par la grille de lecture légale et pénale. De ce point de vue, le problème qu’il reste à résoudre est singulièrement restreint. Il est juridiquement délimité par la définition de l’infraction. Il est centré sur la responsabilité individuelle d’un auteur. Il est orienté par les qualifications négatives attribuées à cet individu selon des « savoirs » (médecine, psychologie, criminologie) prétendant connaître la « nature » qui est la « cause » d’un comportement qui résulte pourtant d’une série de « décisions préalables » des institutions publiques. Enfin, la compréhension de ce problème partiel et partial est subordonnée à l’urgence politique sécuritaire de neutralisation des risques que le délinquant qu’on s’est donné représente. « En d’autres termes définir un acte comme délinquant n’est pas sans conséquence. C’est en quelque sorte une interprétation que l’on donne ou une définition à travers laquelle un comportement est vu et perdra ainsi le caractère problématique qui est le sien, du fait d’être d’emblée placé dans une catégorie présentant des caractéristiques précises : celle principalement de constituer une transgression et d’inclure de ce fait des processus d’attribution à l’égard de son auteur (attribution d’une série de qualifications négatives)[17]. »
Pour autant Debuyst refuse de suivre l’analyse constructiviste critique jusqu’à une pure et simple dissolution du phénomène qui a été qualifié de « délit » ou de « crime ». Ce serait la piste la plus « simple » pour un abolitionnisme radical. Le système pénal est construit sur des chimères, ou plutôt, c’est lui qui produit la délinquance dont il prétend nous protéger. Si on détruit ce système, il n’y a plus de délinquance, donc plus de problème. Or, ce raisonnement est une manière de substantialiser les constructions sociales et institutionnelles en en faisant les seules réalités déterminées en dessous desquelles n’existerait qu’un pur champ de libertés indéterminées. C’est à dire rien du tout. Folie de l’abstraction engagée ou de l’engagement abstrait. Pour quelqu’un comme Debuyst, au contact clinique des phénomènes dont il parle, il s’agit au contraire de restituer les caractéristiques déterminées du comportement et de la situation qui ont été reconfigurés par l’action pénale. Pour autant, il ne tombe pas non plus dans la naïveté inverse qui consisterait à prétendre atteindre un « acte pris en lui-même (un « acte social » brut)[18] ».
La notion de « situation problème » est d’abord un outil méthodologique qui permet de s’affranchir des ornières pénales afin d’élargir le cadre de compréhension et donc les possibilités de réaction sociale[19]. C’est une autre construction du phénomène, non pas comme transgression d’un délinquant, mais justement comme problème, comme quelque chose dont la compréhension ne doit pas être considérée comme déjà donnée mais comme élaborer. Dès lors, cela implique de prendre en considération beaucoup d’autres choses que le couple délit-délinquant, comme le vécu des différents protagonistes, leurs relations, leurs capacités de réaction, leurs rapports avec les institutions etc. « On comprend, dès lors qu’il importe de tenir compte du régime socio-politique considéré comme un ensemble dans lequel un comportement prend place et qui détermine les formes que prendront les inter-relations en rapport avec les possibilités d’expression et d’accès aux ressources des uns et des autres ; qui détermine également les modèles auxquels les uns et les autres pourront se référer comme justifications ou comme manières de faire[20]. » Dès lors, les différents niveaux d’analyse s’emboîtent et rétroagissent. Si l’on prend l’exemple d’un acte qualifié pénalement de « vol » ; pour se donner une autre perspective et problématiser le phénomène, il faudrait passer de l’individu qui a effectué un certain geste encore non qualifié aux personnes directement concernées, puis aux groupes sociaux de référence pour chacun (qui contribuent à donner d’autres définitions de ce qui s’est passé), puis aux rapports différentiels entre ces individus et ces groupes avec les réactions institutionnelles (ainsi le rapport avec un agent de police ou un juge ne sera pas le même en fonction des différentes places sociales occupées) et, au final, intégrer les différentes évaluations des justifications de l’ordre social. En ceci, il est question de justice et d’efficacité. Il n’y a pas de raisons de présupposer que le traitement pénal institutionnalisé produit une réaction plus ajustée à la réalité complexe du problème, ni que cette réaction permette de limiter efficacement les conséquences néfastes de ce problème. « Lorsque nous parlons de comportement problématique, au contraire, une atteinte à ce bien serait de l’ordre d’un « problème » qui ne supposerait pas directement une inculpation, mais serait à résoudre entre le groupe social et les protagonistes de la manière la plus adéquate pour tous[21]. »
On comprend que cette manière problématisante d’aborder les phénomènes capturés par la réaction pénale ouvre des niveaux d’action très différents du triptyque police-juge-pénitentiaire. Il s’agit de partir des situations de conflits au plus près de leur moment et de leur milieu d’émergence, quand et où ça se trame. Ceci afin d’éviter que ces situations atteignent des points d’irréversibilité et des seuils d’intensité et de visibilité qui conduisent à l’intervention de l’État. Cela implique d’une manière générale des ressources que l’on peut appeler « communautaires ». D’abord, des ressources d’interconnaissance pour que les conflits puissent être perçus et compris au-delà des protagonistes directement impliqués (au delà du cercle intra-familial par exemple). Ensuite, des ressources de solidarité pour que d’autres personnes puissent se sentir concernées par ce conflit et acceptent de s’impliquer dans son traitement ou sa résolution. Enfin, des ressources d’institutionnalisation qui permettraient aux groupes sociaux primaires (en interactions directes) de stabiliser des formes de traitements des problèmes dans des dispositifs ajustés aux niveaux de discussion, de décision et de mise en œuvre des solutions[22]. Or, et c’est le centre du problème soulevé ici, nous savons bien que nous sommes très largement dépourvus de telles ressources ou, dit autrement, qu’elles ont été pulvérisées par le développement de la société moderne. Pour le dire très schématiquement, nous sommes pris entre le marteau du capitalisme (en particulier dans sa forme néolibérale) et l’enclume de l’État centralisé (en particulier post-jacobin). D’un côté, la colonisation des existences par la concurrence généralisée des producteurs et la marchandisation des expériences des mêmes en tant que consommateurs (il faudrait ajouter la médiatisation de toute relation par des dispositifs techniques) produisent un terrain social impropre au développement d’interconnaissances directes accompagnées d’une communauté d’intérêt – difficile de trouver du temps, du désir et des capacités pour régler ensemble nos problèmes. D’un autre côté, toute tentative d’une organisation autonome et locale des relations humaines qui s’affranchirait de ces logiques n’est pas simplement dénigrée, mais combattu férocement par l’État et son « monopole de la violence légitime ». Dès lors, les situations conflictuelles (tensions familiales, incompréhensions entre groupes sociaux séparés par l’âge, le genre, le lieu ou le style de vie, ressentiments liés aux dissymétries et injustices sociales, colère face à des organisations exploitantes ou oppressantes, ou pur désespoir d’une vie abandonnée ou pourchassée) prospèrent d’abord sous le radar, sans intérêt pour l’État et avec des capacités partagées de les prendre en charge très insuffisantes. Ensuite, dès que ces situations atteignent un certain niveau d’intensité, l’œil de l’État s’abaisse pour éliminer ce qui trouble l’ordre économique et politique dominant, en même temps que tous les regards se lèvent vers le souverain (police, justice, prison) en implorant son aide tout en attendant avec inquiétude son jugement.
Cela implique donc que l’abolitionnisme pénal nous emmène nécessairement très loin, vers une critique radicale de l’organisation capitaliste et étatique de notre société. Être abolitionniste, cela signifie être anti-capitaliste d’une manière sérieuse et opérer une critique libertaire sans concession du pouvoir de l’État et des institutions qui prétendent exercer une autorité, un pouvoir sans réciprocité, sur des gouvernés. Or, ce n’est pas si courant, tant l’abolitionnisme pénal, et surtout carcéral, peut se contenter d’être une « pétition de principe » humaniste ne prenant pas en considération ce qui reste de problématique sous le pénal, ce qu’il faudrait donc faire à la place et, surtout, ce que cela implique de révolutionnaire concernant l’ordre actuel[23]. C’est également difficile, parce que ces implications radicales produisent nécessairement un seuil politique que beaucoup ne voudront pas suivre, en particulier les réformistes qui participent plus ou moins directement au système pénal. Pourtant, si le discours abolitionniste prétend produire la moindre efficacité politique (c’est-à-dire le moindre changement ou évolution de la situation), il doit bien réussir à convaincre au-delà des déjà convaincus. En même temps, il doit le faire sans renier ses implications (logiques) radicales, sinon il perd toute consistance argumentative et donc politique.
D’où la structure de problème schématique à laquelle je voulais arriver : D’un côté, une myopie soit-disant pragmatique qui refuse cet élan vers « l’idéal » et se contente de gérer l’existant en ne se rendant pas compte que le fait que des détenus soient maltraités n’est pas un « défaut technique » que l’on pourrait résoudre avec un peu de bon sens. On met le début mais pas la fin.
De l’autre côté, une presbytie idéaliste qui prend pour négligeable, et même louche ou condamnable, toute « demie-mesure ». Tout ce qui « participe » du système actuel n’étant qu’impureté, faux semblant, lâche collaboration, illusion naïve ne conduisant qu’à la pérennité de la domination etc. On met la fin mais pas le début.
Or, il n’y a pas de « compromis » possible entre ces deux positions. Nous disions que les abolitionnistes les plus conséquents (ceux de l’ICOPA, par exemple) ont bien réfléchi à ce problème. Mais il apparaît surtout réglé par des arrangements très partiels entre abolitionnistes et réformistes (comment collaborer à un moment, comment chercher à convaincre l’autre, surtout comment s’en distinguer) chacun restant sur son quant à soi. La position abolitionniste n’arrivant finalement pas à inclure rationnellement dans sa propre définition cette manière de « se salir les mains ». La position réformiste se méfiant de ces prosélytes qui les utilisent, veulent les convaincre et finalement les méprisent. Pour échapper à ce dilemme, il faudrait pouvoir maintenir la tension paradoxale entre les deux extrêmes, ne pas devoir décider entre les deux, mais ne pas non plus les mixer. C’est ce qu’on appelle ici avec un peu de malice « réformisme radical ». Poser que l’abolition du système pénal est la seule démarche rationnellement valide (parce la punition légale, quelque soit sa forme, ramènera toujours à la case prison qui n’est que la forme actuelle du droit de « faire mourir » souverain) mais savoir en même temps ce que cela implique comme combat politique. Et poser également que tout ce qui peut faire sens, être tendu rationnellement, vers cette finalité est également légitime (tire justement sa validité de cette mise en tension) : l’amélioration des conditions de détention, les dépénalisations, la modification du travail de la police et des tribunaux, le réductionnisme carcéral, le développement de formes d’alternatives aux poursuites et de médiations, l’institutionnalisation de ressources sociales coopératives et solidaires etc. etc. Ce qu’il faudrait réussir à faire, c’est d’agir partout où c’est possible pour contribuer à la réforme du système pénal actuel sans jamais oublier que cette action vise son abolition, que cette abolition implique « que nous parvenions un jour à l’abolition des classes et de l’État[24] » et le développement d’une coopération libre entre les individus. Ce qui permet de ne pas se laisser capturer par le réformisme gestionnaire. Mais il faut dans le même temps réussir à agir dans la situation présente sans juger et être jugé (d’abord par soi-même) par l’écart (énorme) qui sépare cette action de ce vers quoi elle est tendue. Sinon, on s’isole, on se fatigue et on se décourage. On peut même devenir aigri et méchant.
Quel est finalement l’apport de cette maigre contribution ? Bien sûr, on peut trouver des arguments qui semblent très proches dans les débats qui agitent l’abolitionnisme pénal et, d’une manière plus générale, les rapports entre radicalité politique et « réalisme » réformiste. Mais il y a une forme singulière de radicalité qui en est généralement absente, une radicalité proprement philosophique qui consiste à ne pas régler le problème posé par un paradoxe en tranchant le nœud du problème pour en tirer des opinions inconciliables. L’antinomie entre « l’absolu » de la radicalité et le « relatif » de la situation présente ne peut être que stérile. Ce qui est radical, ce n’est pas de choisir entre ces deux doxas, mais de faire l’impossible, faire jouer l’absolu dans le relatif, maintenir le paradoxe d’une action relative tendue vers une idée absolue et d’une idée absolue exprimée dans une action relative.
Bibliographie :
Ancel M., La défense sociale, Presses Universitaires de France, Que sais-je ?, 1985. Coquet M., De l’abolition du système pénal. Le regard de Louk Hulsman, Éditions Campus Ouvert, 2016.
Debuyst, C., « Passage à l’acte, comportements et situations problématiques », Bulletin de Psychologie, 359, 1983.
Debuyst C., « La clinique criminologique à la croisée des chemins », Déviance et Société, 2010/1 (Vol. 34), p. 71-91.
Delisle C., Basualdo M., Ilea A. et Hughes A., « The International Conference on Penal Abolition (ICOPA) », Champ pénal/Penal field [En ligne], Vol. XII, 2015, mis en ligne le 20 août 2015 (consulté le 10 septembre 2018).
Dindo S., Sursis avec mise à l’épreuve : la peine méconnue. Une analyse des pratiques de probation en France, Direction de l’Administration Pénitentiaire, 2011.
Foucault M., Surveiller et punir, Gallimard, Tel, 1975.
Foucault M., « Il faut tout repenser, la loi et la prison » (extrait), Libération, n°45, 5 juillet 1981 dans Dits et écrits, tome IV, Gallimard, Bibliothèque des Sciences Humaines, 1994.
Kensey A., Lévy R. et alii., Poursuivre et punir sans emprisonner : Les Alternatives à l’incarcération, La Charte, Les dossiers de la revue de droit pénal et de criminologie, n°12, 2006.
Lalande P., « La probation perdue dans l’angle mort de la probation québécoise », Ministère de la Sécurité publique du Québec, 2012 (Source Internet : https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/services-correctionnels/publications-et-statistiques/la-probation-perdue-dans-langle-mort-de-la-criminologie-quebecoise/en-ligne.html) (consulté le 18 septembre 2018).
McNeill, F., Farrall, S., Lightowler, C., and Maruna, S., « Reexamining “Evidence-Based Practice” in Community Corrections : Beyond “a Confined View” of What Works », Justice Research and Policy, 14(1), 2012, p. 35-60.
Perrot M. (dir.), L’impossible prison, Éditions du Seuil, 1980.
Pires A. et Digneffe F., « Vers un paradigme des inter-relations sociales ? Pour une reconstruction du champ criminologique », Criminologie, 25(2), 1992, 13–47.
Tournier P.-V., La prison. Une nécessité pour la République, Buchet Chastel, 2013.
Vacheret M., « Scientificité, technicisation et mécanisation, la déresponsabilisation des agents pénaux », dans Actes du colloque : Le pénal aujourd’hui : pérennité ou mutations, Centre international de criminologie comparée, 2008. (Source Internet : http://www.erudit.org/livre/penal/2008/index.htm) (consulté le 20 septembre 2016).
[1] Voir par exemple le livre de Pierre-Victor Tournier, La prison. Une nécessité pour la République, Buchet Chastel, 2013.
[2] Sur la promotion de la notion de service public pénitentiaire voir la loi du 24 novembre 2009, dite « loi pénitentiaire ». Il est intéressant de constater que cette notion délicate peut être reprise dans d’autres contextes. Ainsi sur le site de l’Observatoire international des prisons (OIP) : « Les conséquences de la grève sur les usagers contraints du service public pénitentiaire » (même si l’ajout du terme « contraint » vient problématiser la notion, mais pas nécessairement les illusions qu’elle comporte). (Source : https://oip.org/communique/les-consequences-de-la-greve-sur-les-usagers-contraints-du-service-public-penitentiaire/) (consulté le 20 septembre 2018).
[3] Il ne s’agit pas ici de prétendre soulever une question nouvelle. Les rapports entre abolitionnisme et réformisme sont réfléchis de longue date, directement par le mouvement abolitionniste lui-même. Une recherche qualitative interne portant sur la 15e Conférence internationale sur l’abolitionnisme pénal (ICOPA) en 2014 évoque ainsi la question « abolition versus reform » comme un des points clés de l’histoire du mouvement. Claire Delisle, Maria Basualdo, Adina Ilea et Andrea Hughes, « The International Conference on Penal Abolition (ICOPA) », Champ pénal/Penal field [En ligne], Vol. XII | 2015, mis en ligne le 20 août 2015 (consulté le 10 septembre 2018).
[4] On trouve déjà tous ces arguments dans l’enquête de la Société royale pour l’amélioration des prisons en 1819.
[5] Michelle Perrot (dir.), L’impossible prison, Seuil, 1980.
[6] Michel Foucault, « Il faut tout repenser, la loi et la prison » (extrait), Libération, n°45, 5 juillet 1981 dans Dits et écrits, tome IV, Gallimard, Bibliothèque des Sciences Humaines, 1994.
[7] Cité dans Pierre Lalande, « La probation perdue dans l’angle mort de la probation québécoise », Ministère de la Sécurité publique du Québec, 2012 (Source Internet : https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/services-correctionnels/publications-et-statistiques/la-probation-perdue-dans-langle-mort-de-la-criminologie-quebecoise/en-ligne.html) (consulté le 18 septembre 2018).
[8] Marc Ancel, La défense sociale, Presses Universitaires de France, Que sais-je ?, 1985, p. 83.
[9] En ce qui concerne la France, nous sommes passés d’une population pénale d’environ 50.000 personnes au milieu des années 1970 (moitié prison, moitié probation) à une population de 250.000 en 2015. Ce qui implique une multiplication par cinq (par trois pour la prison, par sept pour la probation). Par ailleurs, il faut comprendre que ce constat possède le statut d’une évidence. Nous avons pu entendre récemment Marcelo Aebi, professeur de criminologie à l’université de Lausanne et participant au dispositif européen SPACE II (statistiques des mesures de probation) dire simplement à une journée d’étude organisée par l’Administration pénitentiaire : « J’ai de sérieux doute sur le le fait que la probation soit utilisée actuellement comme alternative. »
[10] Ainsi, en ce qui concerne le bracelet électronique : « Le profil socio-démographique des placés ressemble davantage à celui des condamnés pris en charge en milieu ouvert et cette ressemblance donne à penser qu’il ne s’agit pas d’une population qui aurait été vouée à l’emprisonnement en l’absence de cette mesure. » Annie Kensey, René Lévy et alii., Poursuivre et punir sans emprisonner : Les Alternatives à l’incarcération, La Charte, Les dossiers de la revue de droit pénal et de criminologie, n°12, 2006, p. 87.
[11] Voir par exemple Marion Vacheret, « Scientificité, technicisation et mécanisation, la déresponsabilisation des agents pénaux », dans Actes du colloque : Le pénal aujourd’hui : pérennité ou mutations, Centre international de criminologie comparée, 2008. Source Internet : http://www.erudit.org/livre/penal/2008/index.htm (consulté le 20 septembre 2018).
[12] En témoignent les travaux autour de la désistance et du « good lives model » portés, entre autresn par Shadd Maruna et Fergus McNeill. Voir par exemple : McNeill, F., Farrall, S., Lightowler, C., and Maruna, S., « Reexamining “Evidence-Based Practice” in Community Corrections : Beyond “a Confined View” of What Works », Justice Research and Policy, 14(1), 2012, 35-60.
[13] « Nouvelle mesure » instituée par la loi du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales.
[14] Sarah Dindo, Sursis avec mise à l’épreuve : la peine méconnue. Une analyse des pratiques de probation en France, Direction de l’Administration Pénitentiaire, 2011.
[15] Entretien avec Sarah Dindo par Yann Maurin (CPIP) (Source : http://www.psyetdroit.eu/wp-content/uploads/2017/03/YMSD-SME.pdf) (consulté le 20 septembre 2018).
[16] « Debuyst se donne pour tâche de bâtir un pont entre la pensée phénoménologique de De Greeff sur la manière de faire déviante et la sociologie de la réaction sociale des « Neo-Chicagoans ». » Ce faisant, il a abouti aussi à bâtir un pont entre les deux périodes problématiques de l’École de Chicago. Car Debuyst veut tenir compte des deux dimensions de la question : la genèse des situations-problèmes et la réaction sociale et pénale à leur égard. », dans Alvaro Pires et Françoise Digneffe, « Vers un paradigme des inter-relations sociales ? Pour une reconstruction du champ criminologique », Criminologie, 25(2), 1992, 13–47.
[17] Christian Debuyst, « Passage à l’acte, comportements et situations problématiques », Bulletin de Psychologie, 359, 1983, p. 275.
[18] Christian Debuyst, « La clinique criminologique à la croisée des chemins », Déviance et Société, 2010/1 (Vol. 34), p. 71-91, p. 77.
[19] Il est évident qu’il y a de nombreux rapprochements à faire avec la notion de « situation problématique » développée par Louk Hulsman. Sur ce sujet voir Margaux Coquet, De l’abolition du système pénal. Le regard de Louk Hulsman, Éditions Campus Ouvert, 2016. Selon Debuyst, ce développement s’est fait en parallèle et il rappelle la particularité du point de vue clinique qui est le sien, contrairement à Hulsman.
[20] Christian Debuyst, « Passage à l’acte, comportements et situations problématiques », art. cit., p. 277-278
[21] Christian Debuyst, « La clinique criminologique à la croisée des chemins », art. cit., p. 77.
[22] On peut ici penser à l’intérêt de Hulsman pour les « community boards » qui impliquent une proximité communautaires entre les conciliateurs et les personnes impliquées, un non-professionnalisme, un rôle de compréhension mutuelle plus que de résolution etc. Voir Margaux Coquet, op. cit., p. 135-136
[23] En témoigne les fréquentes indignations fiévreuses, tout à fait superficielles, comme cette tribune intitulée : « Abolir la prison, ses mécanismes et ses logiques » qui exige « que soit jetée aux oubliettes de l’Histoire cette maudite habitude qui permet à l’homme d’enfermer l’homme et de le tenir emmuré. » Comme s’il ne s’agissait ici que d’une mauvaise habitude archaïque qu’une prise de conscience et un effort de civilisation (de sociétés « postmodernes [sic]») suffiraient à balayer. (Source : https://blogs.mediapart.fr/edition/les-invites-de-mediapart/article/040614/abolir-la-prison-ses-mecanismes-et-ses-logiques)
[24] Guy Debord, In girum imus nocte et consumimur igni, Gallimard, Nrf, 1999, p. 20.