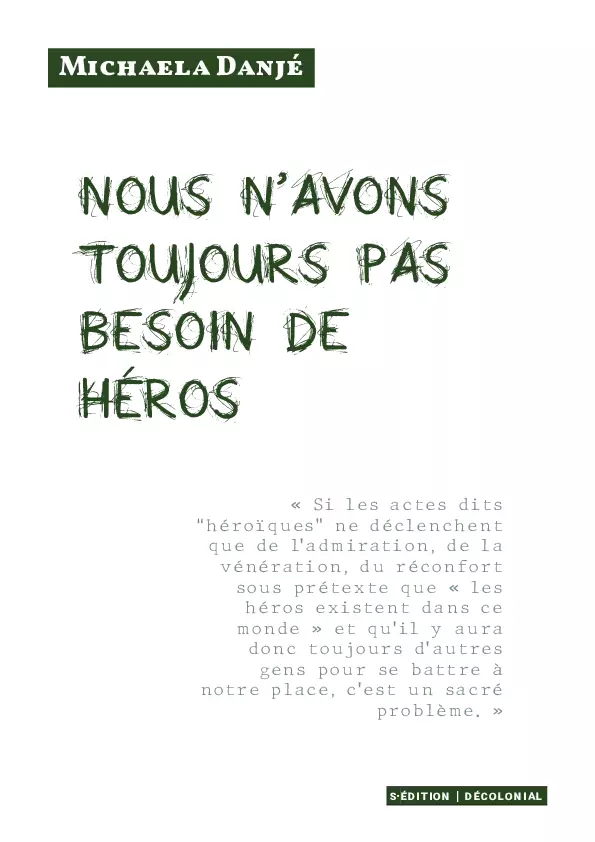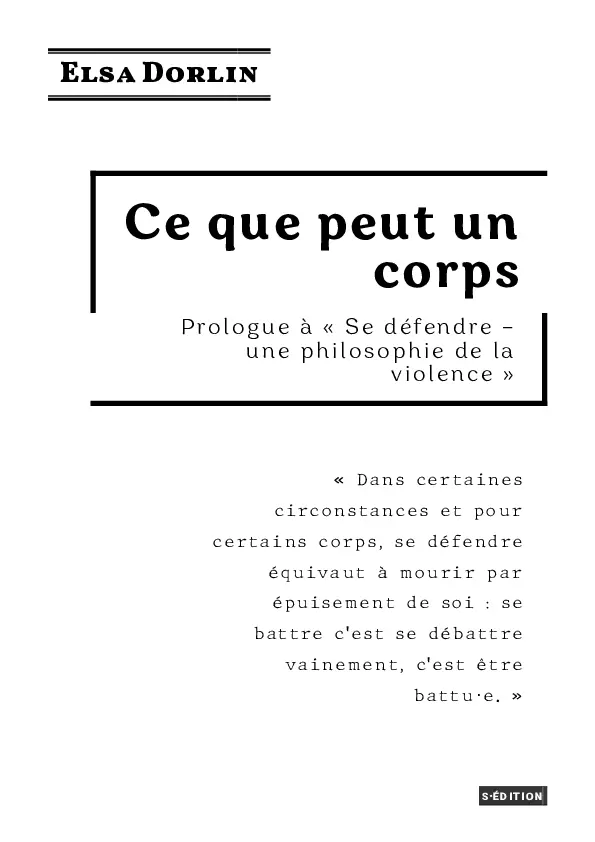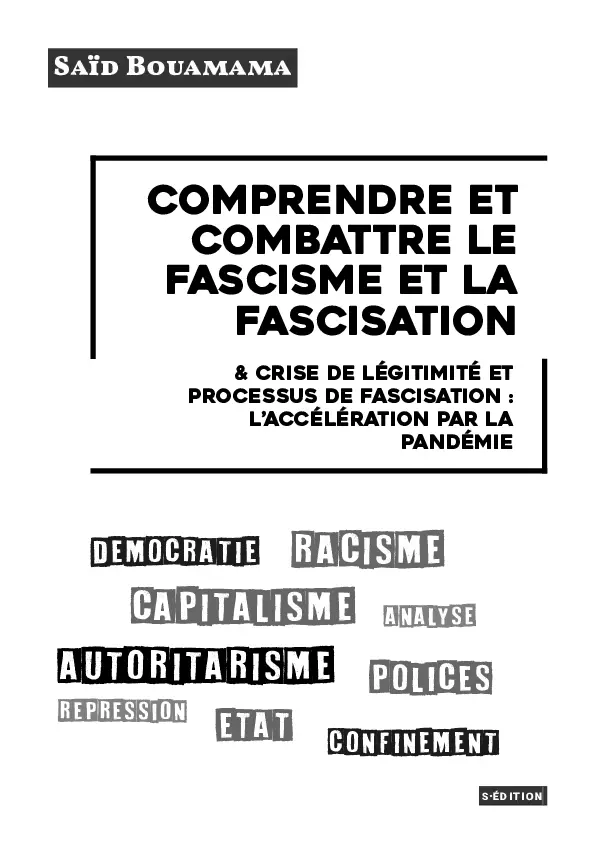Michaela Danje — Nous n'avons toujours pas besoin de heros
Temps de lecture : ~ 18 minutes
Ce texte fut initialement publié en novembre 2019 par le collectif Cases Rebelles (cases-rebelles.org), un collectif noir anti-autoritaire composé actuellement exclusivement de femmes queers et trans, qui vise à lutter contre toutes les formes de domination dans une perspective afrocentrée.
L’espace révolutionnaire et panafricain du bateau
Le 27 mars 2019 le El Hiblu 1, un pétrolier commercial battant pavillon de Palaos et qui tient son nom de son propriétaire Salah El Hiblu, secourait au large de la Libye une centaine de personnes en exil qui avaient pris la mer sur un canot pneumatique. C’est un avion militaire de l’EUNAVFOR MED opération Sophia qui a dirigé le pétrolier vers l’embarcation en détresse qui de toute évidence se dégonfle progressivement. Dans l’action de sauvetage, six hommes, convaincus que le navire est libyen, décident de rester sur le canot de peur d’être ramenés en Libye. Fin de l’histoire pour ce qui les concerne : nul ne sait ce qu’il est advenu d’eux.
Jusque là rien que de très banal dans l’horreur devenue quotidienne du cimetière-méditerranée.
À bord du pétrolier, le dialogue s’instaure entre les personnes qui parlent anglais et le second capitaine Nader El Hiblu, libyen et frère de Salah. Le capitaine est turc et il ne parle pas anglais. Les rescapé⋅es qui viennent d’échapper à une mort probable veulent savoir où l’équipage entend les emmener.
Nader El Hiblu révèle le trajet initialement prévu : partis d’Istanbul, ils font route vers Tripoli. C’est la panique et le désespoir qui s’abattent sur la centaine d’exilé⋅es. Nader El Hiblu leur promet alors qu’il va les aider. Il détourne le navire vers l’Europe et annonce qu’il attend qu’un point de rendez-vous soit fixé avec des bateaux de secours européens.
Que s’est-il passé ensuite ?
Pendant la nuit, Nader échange avec l’avion de l’opération Sophia. Il déclare qu’il a un problème à bord, que les exilé⋅es ne veulent surtout pas retourner en Libye. Il décrit la situation par les mots « crazy » et « very bad ». L’avion lui promet l’arrivée prochaine d’un bateau de garde-côtes libyens. Il attend, puis ne voyant rien venir change de cap à minuit et demi pour se diriger vers Tripoli. Il verrouille la cabine, sa conscience et pousse son bâtiment à vitesse maximale.
Au petit matin, les exilé⋅es reconnaissent avec stupeur dans la terre qui leur apparait au loin l’enfer libyen ; un pays à la négrophobie débridée, une terre de torture, de viol, d’esclavage et de famine.
Bien évidemment, iels se mettent à crier, à pleurer, à clamer qu’iels préfèrent la mort à la Libye et certain⋅es – ou tou⋅tes on ne sait pas – annoncent qu’iels refuseront d’embarquer sur le bateau des garde-côtes libyens dont on leur a annoncé l’arrivée.
La suite est floue et les versions divergent radicalement.
Si l’on en croit la presse dominante qui s’empare rapidement de l’affaire et les gouvernements européens, un groupe d’exilé⋅es aurait pris le contrôle du bateau par la force et l’aurait contraint à détourner chemin vers Malte. La presse et les politiques s’emballent et les gros mots sont lâchés ; il est question de prise d’otage, d’acte de piraterie.
Dans la nuit du 27 au 28 mars, une unité des forces spéciales de armées maltaises qui avaient embarqué sur un vaisseau de patrouille P21 prend d’assaut le El Hiblu 1 et son dangereux groupe de noir⋅es trempé⋅es, affamé⋅es, épuisé⋅es. Pour l’opération digne d’un film hollywoodien, les militaires maltais sont assistés d’un vaisseau de patrouille P51, deux intercepteurs rapides et un hélicoptère. Ils ne rencontrent bien entendu aucune résistance et le navire arrive à La Valette le matin à 8h30. Cinq personnes, considérées comme les meneurs, sont mises en état d’arrestation. Fin du scénario hollywoodien et du cirque médiatique. Les vies noires retournent dans l’ombre. Dans le dédale glaçant de l’accueil européen. Dans le ventre vorace de la Méditerranée. Dans l’enfer terrestre libyen.
Aujourd’hui, trois personnes sont inculpées dans l’affaire du El Hiblu 1 : un Ivoirien de 15 ans et deux Guinéens de 16 et 19 ans. Ce sont des enfants que le monde entier ignore pas mal pour l’instant, mais dont on n’hésitera pas un jour à faire un film à succès ou une série à binge-watcher si ça semble vendeur. Les chefs d’inculpation sont les suivants selon Amnesty International[1] :
– acte de terrorisme, comprenant la saisie d’un bateau (Art. 328A(1)(b), (2)(e) du Code pénal) ;
– acte de terrorisme, comprenant la destruction massive d’une propriété privée (Art.328A(1)(b), (k) du Code pénal) ;
– « activités terroristes », comprenant la saisie et la prise de contrôle illégales d’un bateau par la force ou la menace (Art.328A(4)(i) du Code pénal) ;
– arrestation, détention ou séquestration illégales de personnes et menaces (Art.86 et87(2) du Code pénal) ;
– arrestation, détention ou séquestration illégales de personnes dans le but de forcer une autre personne à commettre ou à s’abstenir de commettre un acte qui, s’il était commis volontairement, constituerait un crime (Art. 87(1)(f) du Code pénal) ;
– éloignement illégal de personnes vers un pays étranger (Art.90 du Code pénal) ;
– violence privée contre des personnes (Art. 251(1) et (2) du Code pénal) ;
– violence privée contre des propriétés (Art.251(3) du Code pénal) ;
– porter autrui à craindre qu’une violence sera exercée à son encontre ou à l’encontre de ses propriétés (Art.251B du Code pénal).
Il se peut que la répétition frénétique du mot « terrorisme » vous ait mis la puce à l’oreille ; les trois inculpés risquent la prison à perpétuité pour n’avoir pas voulu, tout comme leurs sœurs et frères de misère, retourner vers l’horreur libyenne que l’Europe sponsorise.
Bien entendu le récit de ces multi-survivant⋅es est bien différent de la version servie par l’équipage du pétrolier.[2]
Mais par-delà le détail des faits, des questions s’imposent à nous : quels choix ont fait les capitaines du El Hiblu 1 ? Que signifient leurs choix, notamment celui ultime et décisif de faire peser sur 3 ados de 16 à 19 ans la responsabilité du changement de route vers Malte ?
La responsabilité, nous y reviendrons.
Pour ce qui est de l’héroïsme et de celles et ceux qui en sont friands : où est la fascination, l’enthousiasme des fans de Black Panther ou autres fantasmagories issues des impératifs ambigus de la représentation ?
Qu’attendent les aficionados de récits héroïques pour chanter les louanges de ces « héros » grandeur nature ?
L’un des premiers lieux historiques de révolte panafricaine est le navire négrier. Régulièrement, les captif⋅ves déporté⋅es s’unissaient contre l’équipage pour essayer d’échapper à leur sort. Iels pouvaient être aussi secouru⋅es ou soutenu⋅es par des groupes venus de la côte. Les chiffres de la fréquence des révoltes sur les bateaux varient. On nous explique ici sur la base des journaux de bord qu’au 18e siècle 4,4 % des expéditions françaises de déportation auraient donné lieu à des révoltes[3]. Joseph E. Inikori a déterminé pour les expéditions anglaises que 17, 7 % des navires furent « perdus à la suite de mutinerie d’esclaves, d’attaques des côtiers ou des naufrages sur les côtes d’Afrique"[4]. Dans l’Encyclopedia of Slave Resistance and Rebellion, il est estimé qu’un bateau sur dix était concerné.
Au sujet de ces révoltes, les récits des journaux de bord font grand cas de l’identification des meneur⋅euses. Les tenants du monde hiérarchisé du navire négrier n’imaginent pas de révoltes sans chefs, sans leaders. Et ils doivent, en accord avec leur logique criminelle et prédatrice, absolument élever le niveau de terreur en réprimant ostensiblement un⋅e ou plusieurs individu⋅es dont le supplice est censé passer aux autres l’envie de se révolter. Bien entendu il ne peut être question de massacrer tou⋅tes les futures esclaves puisqu’ils sont (leurs corps) la marchandise, le profit à venir, l’objet qui produit de la valeur.
Mais cette entreprise de distinction de leader⋅euse, malgré tortures et menaces diverses, n’était pas toujours fructueuse :
« N’ayant pu connaître les chefs de la révolte, nous avons fait donner 50 coups de fouet à ceux qui nous ont paru les plus coupables », témoigne le capitaine de la flore de Honfleur.[5]
Pourquoi ? Sans doute parce que la révolte était de toute façon l’expression d’un refus unanime, collectif. Pas un⋅e des africain⋅es capturé⋅es ne souhaitait devenir esclave tout comme aucun⋅e des africain⋅es noir⋅es présent⋅es sur le El Hiblu 1 ne souhaitait retourner en Libye.
La question de l’identification du/des meneur⋅euses renvoie alors à la question de la responsabilité : qui va prendre la responsabilité de l’acte révolutionnaire ou plutôt sur qui les forces répressives vont-elles la faire peser ? Qui va-t-on tuer, sacrifier pour donner une leçon aux autres ?
Héroïser, représenter, édifier, aliéner
Je me souviens qu’en 1997 quand est sorti le film Amistad, j’étais déjà saoulée par Spielberg du fait des nombreux manquements éthiques de La liste de Schindler, notamment sur la question de la représentation de l’Histoire, du spectaculaire, etc. Avec Amistad, Spielberg réitérait l’exercice du fictionnel construit autour de l’Histoire d’exception : je ne voyais pas comment quelque chose de bon pouvait advenir de cette entreprise et les nombreuses incohérences historiques du récit me donnèrent raison.
Je me suis donc abstenue d’aller le voir – contrairement aux 630 000 spectateur.ices de France et 9 971 000 spectateur.ices des États-Unis.[6]
Il y aurait beaucoup à dire sur ce film mais je me contenterai d’analyser brièvement comment la notion du héros l’habite tout entier. Cinque est d’emblée présenté comme le leader. Le film commence sur un geste présenté comme décisif : il parvient à arracher un clou, il se libère, etc. La révolte est victorieuse mais comme les africain⋅es sont tributaires de deux survivants espagnols pour la navigation, ils se retrouvent à leur insu en route vers les États-Unis où ils sont mis aux arrêts dès leur arrivée. Le film s’éloigne alors de son esthétique « passage du milieu vu par Mapplethorpe »[7] croisé avec Au cœur des ténèbres, pour devenir un de ces films-procès chiants que le cinéma US affectionne tant. L’objet du procès est le suivant : déterminer si les africain⋅es de La Amistad sont des esclaves ou des hommes libres.
Je vous fais grâce du déroulé du récit qui mène à la libération des ex-futurs esclaves. Des informations et des développements plus en rapport avec le réel que le film de Spielberg peuvent se trouver dans l’ouvrage de Rediker par exemple.[8]
Mais attardons-nous sur quelques scènes. L’un des personnages principaux est l’avocat Roger Sherman Baldwin. À un moment, il explique à Cinque qu’il doit s’exprimer face au juge.
Quand nous irons au tribunal, je voudrais que vous parliez.
- Je ne suis pas un conseiller. Je ne parle pas pour les autres.
- Les autres disent que si. Ici, c’est vous le chef.
- Je ne le suis pas.
- Et cette histoire de lion ? Ils disent que vous seul, tout seul, Cinque, vous avez tué le plus terrible de tous les fauves. Ce n’est pas vrai ?
- (…) Il est venu vers moi. J’ai ramassé une grosse pierre et je l’ai lancée. Par je ne sais quel miracle, je l’ai touché.
- Il ne sait pas comment ça l’a tué.
- Une pierre.
- Une pierre.
- (…) Je ne suis pas un grand homme. J’ai eu de la chance, c’est tout.
- Je voudrais être d’accord avec vous, mais vous oubliez une chose. L’autre lion. L’Amistad, Cinque. L’insurrection. Ça aussi, c’était un accident ? J’en doute.[9].
Cinque aurait donc l’héroïsme dans le sang, le destin ou je ne sais quelle autre composante approximative de l’existence humaine. On note bien ici que c’est le gentil homme blanc qui valide le concept de héros pour adouber Cinque et l’encourager ainsi à accomplir sa destinée. Et de fait le film repose – entre autres procédés – sur la reconnaissance mutuelle des héros et l’inévitable fraternisation qui s’opère quand ils se rencontrent…[10] En effet, quand à la fin du film la Cour suprême déclare que les mutins de La Amistad ne sont pas des esclaves mais des individus libres et qu’ils avaient par conséquent le droit de se révolter, Cinque demande à Adams « Avec quels mots les avez-vous persuadés ? ». « Avec les vôtres, bien sûr ». Tous y vont ensuite de leurs serrages de main, accolades, etc. L’une des morales de l’histoire c’est donc que les grands hommes font la grande Histoire. Le sous-texte habituel c’est qu’il y en a toujours eu aux États-Unis pour faire honneur à l’esprit du pays. De fait, il est certain que cette idée est plus vendeuse qu’une réalité faite d’invasion, de génocides, de vols, et d’esclavage.
L’objet n’est donc pas la réussite collective des révolté⋅es de La Amistad mais celle des élites : des figures rédemptrices au comportement héroïque qui permettent à des communautés toutes entières de se libérer et se transcender, grâce à des moments très précis, des événements décisifs. Le film a d’ailleurs été largement critiqué par des historien⋅nes notamment parce qu’il fait de ce procès un tournant historique dans le rapport à l’institution esclavagiste ; ce qui est faux. Et ceci est d’autant plus problématique qu’à l’époque les enseignant⋅es dans les écoles furent massivement incité⋅es à faire usage du film pour les cours sur l’esclavage.
Nous n’avons assurément pas eu besoin de Spielberg pour intégrer cette idée qui sature nombre de récits, fictifs ou historiques. Mais, répétons-le, les bateaux qui n’ont pas connu de révoltes notables n’en ont pas moins été des lieux de résistance aussi. Et c’est un groupe qui a pris contrôle de La Amistad ; un groupe que le film de Spielberg condamne globalement au mutisme. Un groupe animé par le désir profond et irrépressible d’être libre. Mais il est bien plus sécurisant politiquement pour le monde dominant de transfuser des fantasmes d’héroïsme individuel plutôt que des désirs d’émancipation collective. Cela permet de vivre dans un monde où un film pourri comme Amistad est presque un classique, où l’on peut criminaliser de manière spectaculaire des personnes qui souhaitent uniquement ne pas retourner en Libye. Un monde où l’on peut finalement faire peser le poids d’une multitude de politiques impérialistes et de politiques migratoires criminelles sur trois adolescents exilés noirs, dans une indifférence presque générale. Je me demande sur quel héros on doit compter cette fois-ci pour les sauver.
Un monde de responsabilités
L’héroïsme est une entreprise idéologique au service du statu quo. Le concept de héros est une arnaque. Il réserve à une classe d’êtres humains le devoir d’agir, de s’exposer, se sacrifier. Il leur réserve aussi l’éventuelle glorification qui singularise, piège, isole de la communauté. Il leur réserve les couronnes de lauriers qui enferment. Ou le froid glacial des forces répressives. Parce que l’héroïsation est une entreprise particulièrement sélective.
Nous n’avons pas besoin de leader⋅euses, de héros ou d’héroïnes.
Nous avons besoin de vivre dans un monde où plus de personnes puissent agir, prendre leurs responsabilités, vis-à-vis de l’état du monde, de l’état de leur lieu de vie, vis-à-vis des êtres humains qu’iels souhaitent être, pour participer à révolutionner leurs existences.
L.B., qui fut mon homeboy, que j’appelais mon frère, s’est jeté devant les balles de DAECH le 13 novembre 2015 sauvant ainsi une de ses amies. Malgré ce que racontaient la presse ou les réseaux sociaux, j’ai toujours refusé l’idée qu’il était « mort en héros ». Il me semblait qu’il avait réagi tel qu’il était, en prenant ses responsabilités vis-à-vis de l’être humain qu’il s’était engagé à être. Ce n’était pas difficile non plus de comprendre qu’il avait été tué par les « bons » criminels selon l’opinion publique française blanche et que son héroïsation remplissait une fonction idéologique forte. Prendre ses responsabilités face à la violence d’État, être enfermé⋅es voire tué⋅es par ceux qu’on ne présente jamais comme des criminels ne fera pas de vous un héros dans l’opinion publique.
Même si votre seule audace est d’avoir voulu exister. Respirer. Nombreux⋅ses sont celles et ceux qui n’ont jamais eu le luxe de choisir leurs batailles. Qui n’ont jamais eu d’autres choix que de prendre leur responsabilités pour tenter d’offrir à leurs corps un jour de survie de plus.
Le monde est un enfer quand, par confort, on délègue à autrui nos jugements, nos capacités d’agir, de choisir. Le monde est un enfer quand on se trouve des boucs-émissaires pour éviter de regarder en face la réalité et l’histoire du territoire sur lequel on vit, des systèmes oppressifs auxquels on participe.
Nous avons tou⋅tes une responsabilité vis-à-vis des systèmes qui organisent nos vies, à plus forte raison si on en profite – occasionnellement ou régulièrement – sur le dos d’autres personnes.
Les pays riches ne le sont qu’au détriment des autres pays ; comme les villes, les quartiers, les familles, les individu⋅es. Ne pas abandonner la responsabilité de la lutte – et surtout sa charge – aux plus démuni⋅es est un devoir moral.
Les mots aussi ont un poids. Les diatribes, les insultes, les amalgames, les raccourcis, les mensonges, les silenciations, les manipulations, les opportunismes. Le monde est un enfer quand trop de gens jouent avec la violence du verbe dans le confort de l’anonymat, de la distance numérique. Quand trop jouent face caméra avec la force vénéneuse du discours. Quand d’autres se pensent au spectacle et se divertissent du sang et de la merde, des rumeurs et des calomnies. Ni les incendiaires, ni les spectateur⋅ices ne sont innocent⋅es.
Le monde est un enfer quand trop peu de gens assument leurs engagements, leurs voix, respectent la parole donnée.
Comme Nader El Hiblu n’a pas assumé l’engagement pris auprès des personnes que lui et son équipage ont recueilli en mer.
Contrairement par exemple à tous les pêcheurs tunisiens qui assument depuis des années leurs responsabilités dans une relative discrétion, en sauvant en mer des vies de personnes exilé⋅es.
Si les actes dits « héroïques » ne déclenchent que de l’admiration, de la vénération, du réconfort sous prétexte que « les héros existent dans ce monde » et qu’il y aura donc toujours d’autres gens pour se battre à notre place, c’est un sacré problème.
En 1970 Assata SHAKUR découvrait qu’un enfant, Jonathan JACKSON, était mort en tentant de faire échapper son frère George de l’enfer carcéral étasunien lors d’une prise d’otage. Jonathan avait 17 ans. Cet acte révolutionnaire renvoie Assata à ses propres responsabilités et à cette question : Et moi qu’ai-je fait pour mon peuple ?
Je n’arrivais pas à me sortir toute cette histoire de la tête. Pourquoi des hommes et des femmes adultes vivaient encore alors que Jonathan Jackson était mort ? Quelle sorte de rage ; quelle sorte d’oppression, et quelle sorte de pays avaient façonné ce jeune homme ? Je me sentais coupable d’être en vie et en bonne santé. Où était mon fusil ? Et où était mon courage ?[11]
C’est le seul sens qu’il vaille la peine de donner aux actes qui exigent plus d’énergie et d’audace, aux actes qui sortent de l’ordinaire. Ou qui sont perçus comme tels. Parce que de nombreuses prises de responsabilités du quotidien sont révolutionnaires sans être spectaculaires.
Toutes les personnes investies dans la révolte panafricaine et anti-esclavagiste du El Hiblu 1 méritent notre admiration. C’est la conscience d’une destinée collective qui a permis à toutes ces personnes de s’extirper de l’enfer – du moins de l’un des pires puisque notre planète pullule d’autres enfers. Nous ne pouvons rester indifférent⋅es au fait que le pouvoir qui est l’artisan même de l’injustice et de la terreur en Afrique, en Libye, en Méditerranée menace d’enfermer des enfants à vie en les accusant de terrorisme.
Nous n’avons pas besoin de héros, de figures médiatiques, d’icônes. Nous n’avons pas besoin de martyr⋅es non plus.
On a besoin d’avoir les moyens de prendre les responsabilités qui sont à notre hauteur, de pouvoir se donner mutuellement ces moyens, d’être entouré⋅es de personnes qui nous aident à prendre nos responsabilités en prenant les leurs. Nous avons besoin de pouvoir assumer collectivement nos aspirations révolutionnaires à la liberté. Peu m’importe qui a jeté la première brique, écrit le premier tract, refusé la première de quitter son siège. Ces actes de refus ou d’affirmation naissent du collectif, de son énergie, de son amour ; et aussi d’un tas de contingences arbitraires et systémiques. Et du hasard. Ce qui m’importe c’est que nous ne laissions pas des individu⋅es assumer seul⋅es face aux forces répressives ces actes qui participent de l’émancipation collective. Ce qui m’importe aussi c’est que nous ne nous fabriquions pas d’idoles : ni de celles et de ceux que l’Histoire officielle adoube, ni de celles et de ceux qui ont été happé⋅es par la prison ou la mort.
Les héros, les histoires édifiantes c’est du divertissement, de l’étymologie latine divertere, « détourner ». Et là il ne s’agit pas de bateaux et de vies à sauver.
[1] https://www.amnesty.org/download/Documents/EUR3312702019FRENCH.pdf
[2] Voir le document d’Amnesty.
[3] https://books.openedition.org/pur/19550?lang=fr
[4] https://www.persee.fr/doc/outre_0300-9513_1996_num_83_312_3457
[5] https://books.openedition.org/pur/19550?lang=fr
[6] Ce n’est pas beaucoup pour un réalisateur comme Spielberg.
[7] Caryl PHILLIPS, A New World Order : Essays, 2002, Vintage International.
[8] Marcus REDIKER, Les révoltés de l’Amistad. Une odyssée atlantique (1839-1842), Paris, Seuil, « L’Univers historique », 2015.
[9] Dialogue extrait du script de Amistad : “When we go to court, I need you to speak./ I’m not an advisor of any kind. I cannot speak for the others./ Cinque, the others, they say you can. They say you’re the big man here./ I am not./ What’s this I hear about a lion? They say you alone - alone, Cinque - slew the most terrifying beast anyone has ever seen. Is it not true?/ (…) As it came for me I picked up this big rock and I threw it. And by some miracle, you see, I hit it./ He don’t know how that killed it, but it did./ A rock./ A rock./ (…) I’m not a big man. Just a lucky one./ I might agree with you, Cinque, except you’re forgetting something. The other lion. The Amistad, Cinque. The insurrection. That too was an accident? I hardly think so.”
[10] Même si l’héroïsation des femmes n’est pas plus souhaitable, on sait qu’il s’agit toujours, dans l’écrasante majorité, d’histoires d’hommes.
[11] Assata SHAKUR, Assata. Une autobiographie, 2018, p.286, éditions PMN.