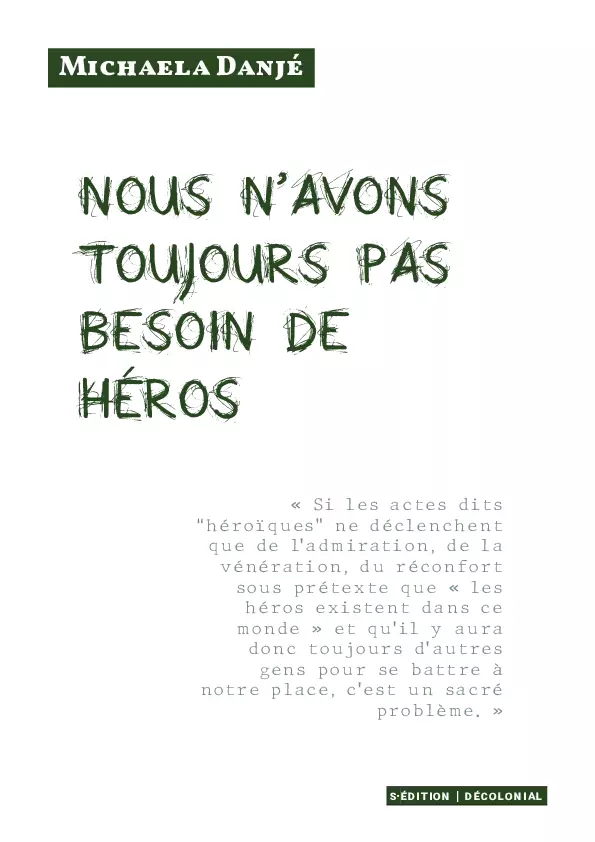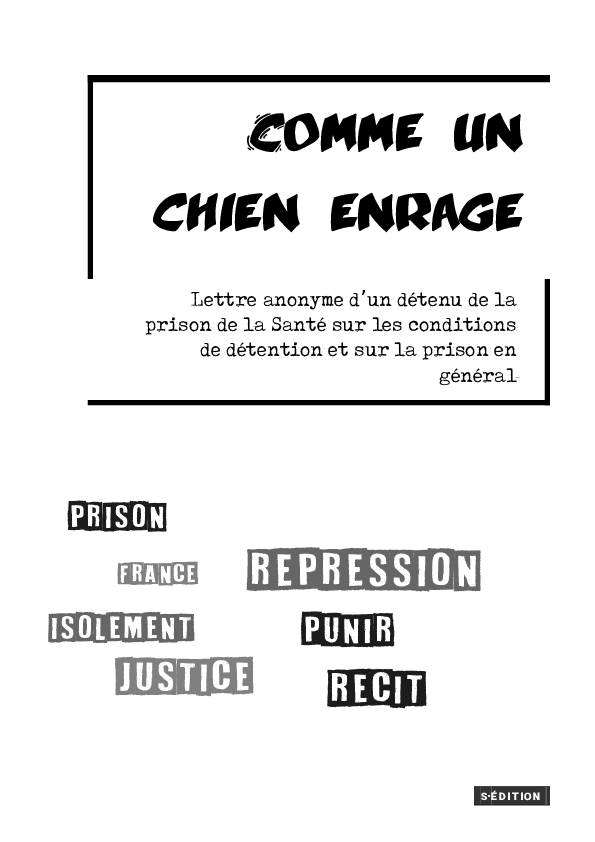Maré Almani — Qu’est-ce que le terrorisme
Temps de lecture : ~ 15 minutes
Traduit de Diavolo in corpo, n°3 (Turin), novembre 2000, extrait d’A Corps Perdu N°1. Edité en français par Tumult en 2013
Qu’est-ce que le terrorisme ?
Maré Almani
En mai 1898, le roi Umberto I, préoccupé par les nouvelles qui lui parviennent de Milan où venait d’éclater une grève générale, confiait au général Bava Beccaris le soin de réprimer la révolte. L’ordre est donné aux soldats de tirer à vue, et Bava Beccaris fait ouvrir le feu sur la ville à coups de canon. Le bilan est de 80 morts et 450 blessés. Fier du devoir accompli, le général télégraphe au roi que Milan est désormais « pacifiée ». Le chef de gouvernement, le marquis Di Rudini, fait interdire plus de cent journaux d’opposition, les Bourses du Travail, les cercles socialistes, les Sociétés mutualistes, mais aussi pas moins de 70 comités diocésains et 2500 comités paroissiaux. De plus, les Universités de Rome, Naples, Padoue et Bologne sont fermées, tandis que se déroulent des milliers d’arrestations. Umberto I envoie immédiatement un télégramme de félicitations à Bava Beccaris et le décore de la croix de l’Ordre Militaire de Savoie « pour les précieux services rendus aux institutions et à la civilisation ». Deux ans plus tard, le 29 juillet 1900, l’anarchiste Gaetano Bresci allège le roi Umberto I du poids de ses responsabilités en le tuant à Monza. Le Roi et l’anarchiste. Deux assassins aux mains tâchées de sang, c’est indéniable. Pourtant, peut-on les mettre sur le même plan ? Je ne le pense pas, pas plus qu’on ne peut considérer les motivations et les conséquences de leurs actes de la même manière.
Et donc, puisqu’ils ne peuvent être unis dans une exécration commune, lequel des deux a commis un acte de terrorisme ? Le roi qui a fait massacrer la foule, ou l’anarchiste qui a abattu le roi ?
Se demander ce qu’est le terrorisme est une de ces questions qu’il est en apparence inutile de poser, parce qu’elle est destinée à recevoir une réponse univoque. En réalité – lorsqu’elle est formulée de manière rigoureuse –, elle ne manque pas de susciter des réactions étonnantes. Les réponses sont en effet toujours différentes et contradictoires. « Le terrorisme, c’est la violence de ceux qui combattent l’Etat » diront certains ; « le terrorisme c’est la violence de l’Etat » répondront d’autres ; « mais non, le terrorisme est tout acte de violence politique, d’où qu’elle vienne », préciseront les derniers. Et ne parlons pas des débats qui s’ouvrent face aux distinctions qui peuvent être faites par la suite en la matière : par exemple, le terrorisme est uniquement la violence contre les personnes ou également contre les choses ? Doit-il nécessairement posséder une motivation d’ordre politique ou se caractérise-t-il uniquement par la panique qu’il sème ?
La multiplicité de sens assignés à ce terme est suspecte. La sensation ici n’est pas de se trouver en présence des malentendus habituels liés à l’incapacité des mots à exprimer une réalité dont la complexité dépasse les symboles qui voudraient la représenter. Au contraire, l’impression est celle de se retrouver face à un confusionnisme intéressé, à une relativisation d’interprétations créée artificiellement, dans l’intention de vider les idées de leur sens, de neutraliser la force pratique, de banaliser toute la question en réduisant à du bavardage toute réflexion qu’on pourrait mener à son propos.
Pourtant, ce mot de dix lettres doit bien avoir une origine, une histoire, dont il serait possible de déduire un sens en mesure de dissiper au moins une bonne partie des ambiguïtés que son usage génère aujourd’hui. Et c’est en effet le cas.
La première définition qui est donnée à ce terme par la plus grande partie des dictionnaires est à caractère historique : « le gouvernement de la Terreur en France ». On connaît donc avec précision l’origine du vocable. Le terrorisme correspond à la période de la Révolution Française qui va d’avril 1793 à juillet 1794, lorsque le Comité de salut public mené par Robespierre et Saint-Just a ordonné un grand nombre d’exécutions capitales. La Terreur était donc représentée par cette guillotine dont la lame a tranché la tête à des milliers de personnes qui, présume-t-on, constituaient une menace pour la sécurité du nouvel État en formation. A partir de cette base, les mêmes dictionnaires ajoutent par extension une définition plus générale du terrorisme : « toute méthode de gouvernement fondée sur la terreur ». A présent, cette première interprétation du concept de terrorisme est extrêmement claire. Tout d’abord, elle met au jour le lien étroit qu’il y a entre terrorisme et État. Le terrorisme est né avec l’Etat, est exercé par l’Etat, est justement une « méthode de gouvernement » que l’Etat emploie contre ses ennemis pour garantir sa propre conservation. « La guillotine – disait Victor Hugo – est la concrétion de la loi ». Seul l’Etat peut promulguer des lois. Et la loi, loin d’être l’expression de ce contrat social garant de la cohabitation harmonieuse entre les êtres humains, représente le fil barbelé avec lequel le pouvoir protège ses privilèges. Quiconque oserait l’outrepasser aura à passer entre les mains du bourreau. Ainsi, avant le mois d’avril 1793, de prétendus criminels de droit commun et quelques insurgés étaient déjà montés à l’échafaud.
Quoi qu’on en pense, la guillotine n’est en effet pas une invention de monsieur Guillotin. En France, cet instrument d’exécution capitale avait déjà une histoire, mais personne ne parlait encore de Terreur. Ce n’est que lorsque l’autorité de l’Etat, alors aux mains des jacobins, sera menacée par une vague révolutionnaire, ce n’est que lorsqu’il n’aura plus seulement affaire à de simples hors-la-loi ou à des insurgés isolés, mais à un énorme mouvement social capable de le renverser, ce n’est qu’à ce moment que la violence répressive se nommera Terreur.
Mais, en plus de son caractère institutionnel, une autre caractéristique distingue le terrorisme : tout un chacun peut en être victime. Au cours de la période de la Terreur, rien que dans Paris, il y aurait eu pas moins de 4 000 exécutions. Louis Blanc aurait retrouvé l’identité de 2 750 guillotinés, découvrant que seulement 650 d’entre eux appartenaient aux classes aisées. Cela signifie que la machine étatique de la guillotine ne faisait pas tant de distinctions, décapitant quiconque était estimé incommode ou suspect. Il n’y a pas que les nobles, les militaires et les prêtres qui ont perdu leur tête lors de ces journées – comme le voudrait la propagande la plus conservatrice et traditionaliste –, mais surtout de simples artisans, des paysans, des pauvres. Le terrorisme est tel parce qu’il frappe à l’aveugle, d’où le sentiment de panique collective qu’il inspire. L’usage indiscriminé de la guillotine, systématisé grâce à la simplification des procédures judiciaires permise par la loi de Prairial, crée l’effet inéluctable d’opérations à la chaîne, annulant les différences individuelles entre tous ces décapités. Cette pratique de l’amalgame a un sens politique précis : regroupant en une même séance des personnes soupçonnées de « crimes » de nature ou d’identité complètement différents, la Terreur vise à anéantir les différences individuelles pour créer un consensus populaire, et à détruire « l’abjection du moi personnel » (Robespierre), vu qu’il ne doit exister qu’une seule entité dans laquelle fondre les individus : l’Etat. Le terrorisme est donc né comme instrument institutionnel et indiscriminé. Ces deux aspects retentissent aussi dans des expressions courantes, comme par exemple « des bombardements terrorisants ». Un bombardement, en effet, non seulement se déroule lors d’une guerre menée entre États, mais sème la mort et la désolation dans toute la population. On pourrait faire le même discours concernant le terrorisme psychologique, considéré comme « une forme d’intimidation ou de chantage afin de manipuler l’opinion publique, effectuée surtout à travers les moyens de communication, par l’exagération des dangers de certaines situations ou bien en les inventant, afin d’induire les masses à des comportements déterminés au plan politique, social, économique ». On voit bien comment seul celui qui détient le pouvoir est en mesure de manipuler les grands moyens de communication et, à travers eux, les « masses », afin d’atteindre son but.
Le terrorisme est donc la violence aveugle de l’Etat, comme le montre sans ambiguïté l’origine du terme. Mais le langage n’est jamais une expression neutre. Loin d’être uniquement descriptif, le langage est avant tout un code. Le sens des mots indique toujours le côté vers lequel penche la balance de la domination. Celui qui détient le pouvoir possède aussi le sens des mots. Cela explique comment il se fait que, le temps passant, le concept de terrorisme ait recouvert un nouveau sens qui contredit complètement sa genèse historique mais correspond aux exigences de la domination. Aujourd’hui, ce concept est défini comme « une méthode de lutte politique fondée sur des violences intimidatrices (meurtres, sabotages, attentats explosifs, etc), employés généralement par des groupes révolutionnaires ou subversifs (de gauche ou de droite) ». Comme on le voit, cette interprétation, qui a commencé à se diffuser à la fin du XIXe siècle, s’oppose complètement à ce qui a été dit jusqu’à présent. Dans l’acceptation initiale du terme, c’est l’Etat qui recourt au terrorisme contre ses ennemis ; dans la seconde, ce sont ses ennemis qui emploient le terrorisme contre l’Etat. Le renversement de sens ne pourrait être plus explicite. L’utilité d’une telle opération pour la Raison d’Etat n’est que trop évidente. Mais comment naît cette mystification ? La Terreur en France a été l’œuvre d’un État né lors d’une Révolution. Pour justifier le sens actuel du concept de terrorisme, l’idéologie dominante a du intervertir les sujets et attribuer à la Révolution la responsabilité qui appartenait en réalité à l’Etat. Ainsi, on nous enseigne aujourd’hui que la Terreur est l’œuvre de la Révolution qui, en ce lointain contexte historique, s’était incarnée dans l’Etat. La Terreur serait donc synonyme de violence révolutionnaire. Un saut acrobatique de la logique qui continue à enchanter les parterres de spectateurs du monde entier, qui ne semblent pas se rendre compte de l’arnaque plus qu’évidente.
En réalité, on ne peut attribuer la Terreur à la Révolution, au peuple insurgé, parce que ce n’est que lorsque la Révolution s’est faite État que la Terreur est apparue. C’est un énorme mensonge idéologique et un faux historique grossier que de faire de la Terreur l’expression même de la violence révolutionnaire « massacrante », celle des rues, des journées sur les barricades, de la vengeance populaire. Avant le 17 avril 1793 (jour de la fondation du tribunal révolutionnaire), la violence exercée contre le pouvoir, même celle particulièrement cruelle, n’avait jamais recouvert le nom de terrorisme. Ni les sanglantes Jacqueries du XIVe siècle, ni les excès qui se sont déroulés lors de la Grande Révolution (comme par exemple la manifestation des femmes de Marseille qui portaient à la ronde, au bout d’une pique, les viscères du major De Beausset au cri de « qui veut des tripes ? ») n’ont été considérés comme des actes de terrorisme. Ce terme n’indiquait que la violence répressive de l’appareil étatique au moment où il devait se défendre – pour la première fois dans l’histoire – d’un assaut révolutionnaire. En somme, l’aspect historique du terme montre comment le terrorisme est la violence du pouvoir qui se défend de la Révolution, non pas la Révolution qui attaque le pouvoir.
Il faut dire à ce propos que la persistance de cette ambiguïté a été encouragée pendant longtemps par les révolutionnaires eux-mêmes, qui ont accepté de bon gré ce qualificatif, sans se rendre compte que ce faisant, ils aidaient la propagande de cet État qu’ils souhaitaient frapper. Et si le concept de terrorisme peut légitimement trouver sa place dans un concept autoritaire de la révolution (comme Lénine et Staline l’ont démontré en Russie), il est absolument privé de sens, pour ne pas dire aberrant, dans une perspective de libération anti-autoritaire. Ce n’est pas par hasard si ce sont justement les anarchistes qui ont en premier revu l’usage impropre de ce terme, peut-être poussés par les événements. En 1921 eut lieu le tragique attentat contre le cinéma-théâtre Diana de Milan, qui a causé la mort et des blessures à de nombreux spectateurs, bien qu’ayant comme objectif le préfet de la ville, responsable de l’incarcération de quelques anarchistes célèbres. Malgré les intentions de ses auteurs, ce fut un acte de terrorisme. Comme on peut l’imaginer, cet acte a provoqué d’âpres discussions à l’intérieur du mouvement anarchiste. Ainsi, face à la condamnation du geste par de nombreux anarchistes, si la revue Anarchismo de Pise, sans aucun doute la publication plus diffusée de l’anarchisme autonome en Italie, continuait à défendre « cette vérité anarchiste cardinale, à savoir l’impossibilité de séparer le terrorisme de l’insurrectionnalisme », elle commençait d’un autre côté à esquisser les premières réflexions critiques sur le concept de terrorisme : « pourquoi nommer et taxer de “terreur catastrophique” – qui est le propre de l’Etat – l’acte de révolte individuel ? L’Etat est terroriste, le révolutionnaire qui s’insurge, jamais ! ». Un demi-siècle plus tard, en un contexte de fortes tensions sociales, cette critique sera reprise et développée par ceux qui n’entendaient pas accepter l’accusation de terrorisme lancée par l’Etat contre ses ennemis.
Les mots ont toujours été sujets à une évolution de leur sens. Il n’est pas surprenant que le sens du terme terrorisme se soit également modifié. Il n’est toutefois pas acceptable qu’il contredise chacune de ses caractéristiques originaires, qui sont celles de l’aspect institutionnel et indiscriminé de la violence. Cette violence peut être exercée contre les personnes ou contre les choses, peut être physique ou psychologique, mais pour qu’on puisse parler de terrorisme, il faut au moins qu’une de ces deux caractéristiques demeure. Par exemple, on a justement parlé de terrorisme pour indiquer les actions menées par des escadrons de la mort de l’Etat espagnol contre des militants d’ETA. Ces actions étaient dirigées contre un objectif précis, mais il s’agissait de toute façon d’une forme de violence institutionnelle contre une menace considérée comme révolutionnaire. De même, le terrorisme peut ne pas toujours être mené par des institutions. Mais pour qu’on puisse le considérer ainsi, ses manifestations doivent alors frapper de manière indiscriminée. Une bombe dans une gare ou dans un supermarché en service, ou sur une plage surpeuplée peut à juste titre être définie comme terroriste. Même lorsque c’est le fruit du délire d’un « fou » ou lorsque cela est revendiqué par une organisation révolutionnaire, le résultat d’une telle action est de semer la panique dans la population.
Lorsqu’en revanche la violence n’est ni institutionnelle ni indiscriminée, c’est un non-sens de parler de terrorisme. Un individu en proie à une crise de folie et qui extermine sa famille n’est pas un terroriste. Pas plus qu’un révolutionnaire ou une organisation subversive qui choisit avec soin les objectifs de ses actions. Bien sûr que c’est de la violence, de la violence révolutionnaire, mais pas du terrorisme. Elle ne vise ni à défendre l’Etat ni à semer la terreur dans la population. Si, lors de telles attaques, les médias parlent de « psychose collective » ou « de nations toutes entières qui tremblent », ce n’est qu’en référence au vieux mensonge qui veut identifier un pays entier avec ses représentants, pour mieux justifier la poursuite des intérêts privés de quelques uns au nom et aux dépends des intérêts sociaux de tous les autres. Si quelqu’un devait commencer à tuer les politiciens, les industriels et les magistrats, cela ne sèmerait la terreur que parmi les politiciens, les industriels et les magistrats. Personne d’autre ne serait matériellement touché. Mais si quelqu’un posait une bombe dans un train, n’importe qui pourrait en être victime, sans exclusive : le politicien comme l’ennemi de la politique, l’industriel comme l’ouvrier, le magistrat comme le repris de justice. Dans le premier cas, nous sommes face à un exemple de violence révolutionnaire, dans le second il s’agit en revanche de terrorisme. Et malgré toutes les objections, critiques et perplexité que puissent soulever la première forme de violence, on ne peut certainement pas la comparer à la seconde.
Ceci dit, revenons au problème initial. Entre le roi qui a fait massacrer la foule et l’anarchiste qui a tiré sur le roi, qui est le terroriste ?
Qui sont les terroristes ?
Texte d’une affiche trouvée sur les murs de plusieurs villes en avril 2008.
Les conditions de vie toujours plus insupportables qui nous sont imposées reposent sur la peur. Peur de ne pas avoir de boulot et de ne pas arriver à boucler les fins de mois. Peur de la police, peur de la prison. Parce qu’au fond, la matraque et son acceptation est ce qui garantit les rapports sociaux.
Dans ce monde à l’envers, le terrorisme ce n’est pas contraindre des milliards d’êtres humains à survivre dans des conditions inacceptables, ce n’est pas empoisonner la terre. Ce n’est pas continuer une recherche scientifique et technologique qui soumet toujours plus nos vies, pénètre nos corps et modifie la nature de façon irréversible. Ce n’est pas enfermer et déporter des êtres humains parce qu’ils sont dépourvus du petit bout de papier adéquat. Ce n’est pas nous tuer et mutiler au travail pour que les patrons s’enrichissent à l’infini. Ce n’est pas même bombarder des populations entières. Tout cela, ils l’appellent économie, civilisation, démocratie, progrès, ordre public.
La politique est en réalité l’art de travestir les faits en changeant les mots. Leur « guerre au terrorisme » à l’échelle planétaire n’est qu’une arme de propagande pour légitimer toute agression militaire à l’extérieur et toute répression des rebelles à l’intérieur.
Dans un effet miroir, l’État voudrait tous nous obliger à être le reflet de sa sale gueule autoritaire. Des amitiés, des affinités et le partage d’une même idée de liberté deviennent une « association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste ». Des liens tissés dans les luttes deviennent une « mouvance anarcho-autonome ». Un fumigène devient une bombe.
Et pourtant, s’organiser n’est pas nécessairement constituer une Organisation, tout comme une grève n’est pas une prise d’otage. L’attaque contre une banque, une prison, une ANPE, une permanence électorale, un centre de rétention, le sabotage de la circulation des trains ou des machines dans une usine, ne sont pas du « terrorisme ». Un abîme sépare ceux qui s’insurgent pour se libérer, et ceux qui frappent dans le tas pour défendre, consolider ou conquérir le pouvoir, c’est-à-dire les États et leurs concurrents, les patrons, leurs mercenaires et leurs laboratoires de mort.
Dans cette guerre sociale qui se déroule au travail comme dans la rue, de jour comme de nuit, l’ennemi est tout individu qui fait obstacle à la marche radieuse du capital.
Que chacun, de la manière qu’il estime la plus adéquate, s’oppose au terrorisme d’État et au totalitarisme démocratique. Nous ne subirons pas cette déclaration de guerre en baissant la tête.
Que crève le meilleur des mondes !