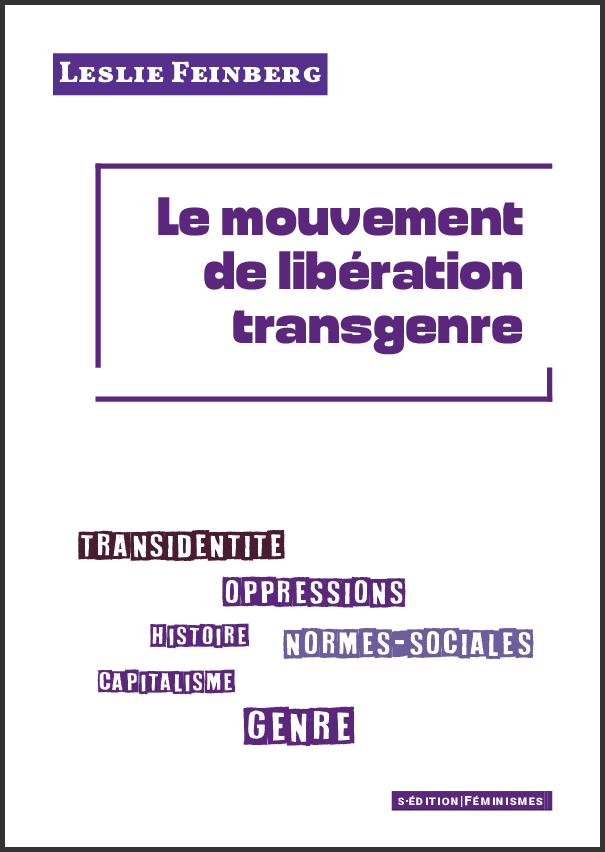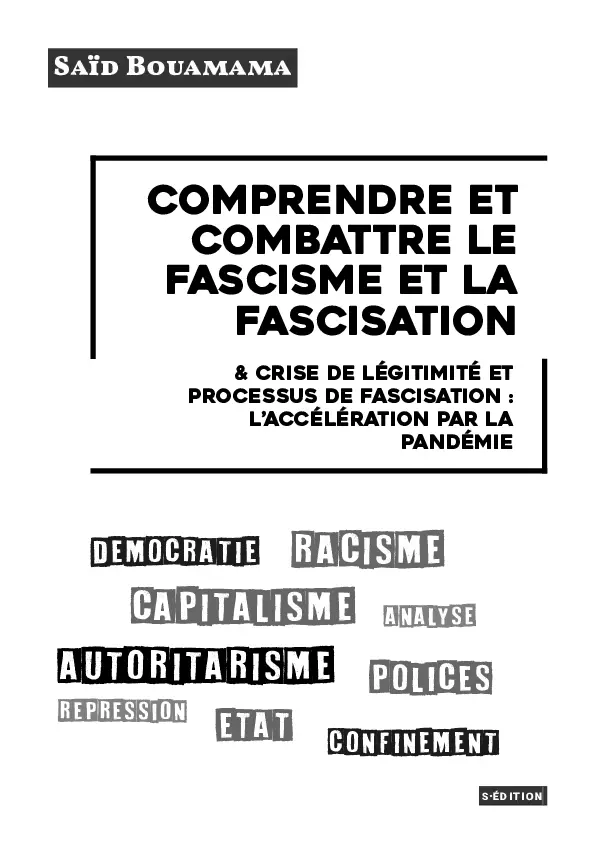Lordon — le capitalisme ne rendra pas les cles gentiment
Temps de lecture : ~ 31 minutes
Le capitalisme ne rendra pas les clés gentiment - entretien
Ce texte est la version augmentée d’un entretien de F. Lordon réalisé avec Joseph Andras pour « L’Humanité » sous le titre : « On ne demandera pas au capital d’envisager gentiment de rendre les clés » (9 novembre 2019), autour de l’ouvrage « Vivre sans ? Institutions, police, travail, argent… » (La Fabrique).
Il a été publié le 22 novembre 2019 sur le blog de Frédecic Lordon, La pompe à phynance, blog.mondediplo.net
Vous vous dites « à contresens de (votre) époque ». Vous mobilisez en effet un quatuor qui n’a plus très bonne presse à gauche : Lénine, Trotsky, dictature du prolétariat et grand soir. Quand l’idéal de « démocratie directe horizontale » s’impose avec force, pourquoi cette résurrection ?
Par enchaînement logique. Si les données variées du désastre — désastre social, humain, existentiel, écologique — sont, comme je le crois, à rapporter au capitalisme, alors l’évitement du désastre ne passe que par la sortie du capitalisme. Or je pense que les manières locales de déserter le capitalisme ne sont que des manières partielles. Car, évidemment, ces manières locales ne peuvent internaliser toute la division du travail, et elles demeurent de fait dépendantes de l’extérieur capitaliste pour une part de leur reproduction matérielle. Ce que je dis là n’enlève rien à la valeur de ces expérimentations. Du reste, je ne pense pas qu’elles-mêmes se rêvent en triomphatrices du capitalisme ! Comme expérimentations, précisément, elles nourrissent le désir collectif d’en triompher, et c’est considérable. Mais pour en triompher vraiment, il y aura nécessairement une étape d’une tout autre nature. L’étape d’une confrontation globale et décisive. On ne demandera pas au capital d’envisager gentiment de rendre les clés, quand il est manifeste qu’il épuisera jusqu’au dernier gramme de minerai, fera décharge du dernier mètre carré disponible et salopera jusqu’au dernier cours d’eau pour faire le dernier euro de profit. Ces gens ont perdu toute raison et déjà ils n’entendent plus rien. L’alarme climatique, d’ailleurs loin d’épuiser la question écologique, aidera peut-être à en venir à l’idée qu’avec le capital, maintenant, c’est lui ou nous. Mais si le problème se pose en ces termes, il faut en tirer les conséquences. Le capital est une puissance macroscopique et on n’en viendra à bout qu’en lui opposant une force de même magnitude. De là, logiquement, je vais chercher dans l’histoire les catégories homogènes à un affrontement de cette échelle. Ces noms et ces mots que vous rappelez, on sait assez de quel terrible stigmate historique ils sont marqués — et qui explique la déshérence radicale où ils sont tombés. Je tâche d’y faire analytiquement un tri et d’en conserver l’équation stratégique qu’à mon sens ils ont adéquatement circonscrite, mais sans rien oublier des abominations qui sont venues avec la « solution ». C’est évidemment ce qui explique qu’ils aient à ce point disparu du paysage idéologique et qu’à la place on trouve l’horizontalité, la démocratie directe et les communes. Or, pour tout le bien-fondé de ces idées, je pense qu’elles relèvent de fait davantage du projet de se soustraire au capitalisme que de celui de le renverser. L’équation contemporaine c’est donc : comment les tenir, car il faut les tenir, mais dans un horizon de renversement ? Ce qui suppose de retrouver les « noms » ensevelis mais de donner à ce qui y gît une forme nouvelle.
Un spectre hante votre livre : « combien ». Les masses. Mais vous reconnaissez que le néocapitalisme a « capturé » nos corps, qu’il soumet en séduisant. Le grand nombre a-t-il envie de s’extraire du cocon libéral et technologique ?
- C’est la question décisive. En réalité c’est toujours la même question
- pour tout : où en est le désir majoritaire ? Reich avait compris qu’il y
- avait eu en Allemagne, non pas juste une chape totalitaire tombée du
- haut, mais, « en bas », un désir de fascisme. On peut bien dire,
- identiquement, qu’il y a un désir de capitalisme et que c’est lui qu’il
- s’agit de vaincre. Ça n’est d’ailleurs pas seulement par la bricole
- marchande qu’il nous tient mais, plus profondément encore, par le corps
- le corps dorloté, choyé par toutes les attentions matérielles dont le capitalisme est capable. Il ne faut pas s’y tromper : la puissance d’attraction du capitalisme « par les corps » est immense. Nous sommes alors rendus aux tautologies du désir : pour sortir du capitalisme, il faut que se forme un désir de sortie du capitalisme plus grand que le désir de capitalisme. Tout dépendra des solutions qui seront proposées à cette équation. La solution « ZAD » est admirable en soi mais elle est d’une exigence qui la rend très difficilement généralisable. C’est une solution pour « virtuoses », pas pour le grand nombre. Qu’il nous faudra consentir à des réductions de nos conditions matérielles d’existence en sortant du capitalisme, la chose devra être claire et admise. Mais dans des proportions tout de même qui la rende raisonnablement praticable. Une trajectoire post-capitaliste reposant sur une hypothèse de dé-division du travail massive ne me semble pas viable. Notre problème, c’est donc de conserver la division du travail disons dans ses « ordres de grandeur » actuels — je dis ça sans préjudice de toutes les réductions que nous pourrions et devrions lui infliger —, mais en la revêtant de rapports sociaux de production entièrement neufs. Par exemple en abolissant la propriété lucrative des moyens de production pour la remplacer par une propriété d’usage, comme dit Friot. Transformation dont on voit bien qu’elle suppose ni plus ni moins qu’une révolution juridique. C’est-à-dire, puisqu’il s’agit du point de droit névralgique qui soutient tout le capitalisme, une révolution tout court.
Ce nombre serait, au lendemain de la révolution, « le seul antidote au déchaînement » capitaliste. Allende a gagné avec 36,6 % des voix et, fait rare, obtenu après deux ans de pouvoir un score de 44 % aux législatives. Cela n’a pas entravé le coup d’État…
J’allais dire que c’est l’écart entre une condition nécessaire et une condition suffisante. Mais en fait, ici vous me parlez d’un soutien manifesté sous une forme exclusivement électorale. Dont se trouve démontrée la terrible limite historique. Après tout, que des factieux s’asseyent sur le « verdict des urnes », comme on dit, ça n’est pas exactement une nouvelle. Ce dont pour ma part je parle c’est d’une mobilisation suffisamment puissante pour prendre physiquement l’espace public, et éventuellement les armes, pour défendre ce à quoi elle tient. Au Chili, en 1973, ce sont les militaires qui sont descendus dans la rue. À la fin des fins, c’est toujours la même question : qui passe à l’action ? Et avec le plus d’intensité ?
Au titan (le capital), vous assurez qu’il faut opposer un géant (les masses). Gulliver, sur l’île de Liliput, a été enchaîné par des « insectes humains » : pourquoi une fédération de communes « swiftienne » n’y arriverait-elle pas ?
Je serais tenté de dire que la fédération des communes, elle vient surtout après : elle est ce qui suit le renversement… ne serait-ce que parce que je vois mal les pouvoirs stato-capitalistes laisser prospérer avec largesse une fédération de communes qui aurait pour objectif avoué de les renverser — ça, c’est un scénario à la Bookchin, et je n’y crois pas une seconde. Quant à ce qui opère le renversement, je pense que ce sera dans les faits d’une autre nature. Laquelle, je ne sais pas. Mais ou bien ce sera coordonné, et puissamment, d’une manière ou d’une autre, ou bien ce ne sera pas. Dans l’affrontement des blocs, « nous » sommes pourtant infiniment plus nombreux que le « eux » d’en-face. Mais « ils » sont infiniment mieux coordonnés que nous. L’oligarchie est une classe consciente et organisée. Et elle a pour elle un appareil de force qui fonctionne carrément à la coordination militaire. La dissymétrie dans la capacité de coordination lui fait surmonter à l’aise la dissymétrie numérique écrasante en sa défaveur. À un moment, il faudra bien réfléchir à ça. Nul n’en tirera la conséquence que nous n’avons qu’à répliquer « leur » forme de coordination, forme militaire comprise ! Mais il faut que nous en trouvions une — ou plusieurs d’ailleurs, mais articulées a minima. Sauf miracle, la spontanéité signifie la dispersion et n’arrive à rien. Pourtant, dira-t-on, le Chili, le Liban, l’Équateur… Oui, d’accord, attendons quand même un peu pour faire les bilans. Et craignons qu’ils ne soient pas fondamentalement différents de ceux qu’on a pu tirer après les printemps arabes. Ces demi-échecs sont le fait de coordinations d’action suffisantes — pour produire « quelque chose » — mais sans véritable coordination de visée : faire quoi quand on a « réussi », quoi mettre à la place de ce qu’on renverse ? Imaginons, pour le plaisir, un acte 2 ou 3 des « gilets jaunes » qui parvient à l’Élysée, et vire Macron manu militari. Quoi après ? C’est tellement incertain que c’en est difficilement figurable. Soit les institutions, intouchées, auraient accommodé le choc, quitte à se transformer à la marge ; soit, comme toujours, ce sont des groupes déjà organisés qui auraient raflé la mise. Le problème c’est que, dans la gauche radicale, intellectuelle notamment, tout un courant de pensée s’oppose à l’idée de visée, d’orientation stratégique, comprise, disons les choses, comme « capture bolchevique ». Alors on cultive l’idée du mouvement pour le mouvement, l’idée de l’intransitivité, on dit de bien belles choses, que le but est dans le chemin et que ce qui compte, ce sont les devenirs. Je ne méconnais nullement le risque inhérent à ceux qui se présentent pour, littéralement, prendre la direction des choses. Ce n’est pas un hasard qu’il s’agisse du même mot : toute proposition de direction enveloppe une candidature à diriger. Mais je crois que notre seul choix c’est d’assumer ce risque, de trouver à le contenir en l’ayant d’abord bien réfléchi, car si on ne sait pas où l’on va… il est certain qu’on n’arrive nulle part. En fait, voilà pourquoi il faut être organisé et savoir où l’on va : parce que d’autres sont organisés et savent où ils vont.
« Rupture globale ou (…) rien », résumez-vous. Le Chiapas se situe précisément dans cet entre-deux : ni un îlot zadiste (les zapatistes ont des dizaines de milliers de partisans, une armée et un gouvernement), ni le Palais national de Mexico. Et ça tient, non ?
Je ne dirais pas ça — « entre-deux ». Dans leur périmètre, tant le Chiapas que le Rojava accomplissent une rupture globale, complète. Mais leur caractéristique commune est d’inscrire leur rupture dans une conjoncture particulière, et particulièrement « favorable », où cependant ni l’un ni l’autre ne maîtrise entièrement ses conditions externes de viabilité, lesquelles demeurent contingentes. C’est par le statu quo plus ou moins négocié avec le Mexique « environnant » que le Chiapas peut ne pas passer toute son énergie politique dans une guerre pour la survie pure et simple — comme le pouvoir bolchevique avait eu à en mener une à partir de 18. Le statut d’enclave est donc précaire et pour une très large part abandonné à une contingence externe. Que cette contingence vienne à mal tourner, et ça ne tiendra plus. Soit exactement ce qui menace de se passer au Rojava. Hors de ces circonstances miraculeusement favorables, où l’hostilité extérieure demeure modérée, une épreuve de mobilisation totale, militaire, marque la formation politique naissante d’un premier pli terrible. Et toute la question est de savoir si on en revient. Le Chiapas et le Rojava doivent plus aux circonstances extérieures qu’à leur propre principe d’avoir fait l’économie de cette épreuve.
Vous rappelez que l’écrasement de Kronstadt par les bolcheviks a marqué « un coup d’arrêt » démocratique. Mais au regard de la conception verticale et militaire qu’avait Lénine de la révolution, le ver n’était-il pas dans le fruit ?
Oui, il y était. Et c’est bien ça le problème. Le drame c’est quand ce qui nous libère du capitalisme nous laisse sur les bras un appareil formé au chaud de la convulsion révolutionnaire si elle tourne en guerre civile. Donc un appareil d’État originairement militarisé. Soit une verticalité policière, vouée au pire. Il faut bien voir la différence, abyssale, de configuration entre l’expérience russe et les expériences de type Chiapas-Rojava, et les contraintes que respectivement elles imposent, ou dont elles soulagent. Le Chiapas et le Rojava ont jusqu’à présent tiré avantage d’une hostilité « modérée » de leur environnement. Et puis ils se constituent comme des enclaves homogènes : les individus y sont d’emblée accordés autour d’une manière commune de vivre. La révolution dans un pays capitaliste développé se pose dans de tout autres coordonnées : avec la perspective inévitable d’avoir à réduire une réaction intérieure ultra-déterminée, puissante, et puissamment soutenue par un extérieur capitaliste qui veut également à tout prix voir échouer une expérience communiste. Ce sont des conditions d’hostilité qui sont sans commune mesure. La situation de 17 a imposé ses réquisits et ils étaient terribles. C’est toujours très facile de passer cent ans derrière et de dire « ah mais il aurait fallu, et il aurait fallu ne pas ». Les corps collectifs comme les corps individuels font ce qu’ils peuvent dans les situations de vie ou de mort. Comment on fait quand on se retrouve confronté à ce problème objectif, et comment on s’en tire après ? Voilà le problème que je pose — et dont je n’ai pas le commencement d’une solution. Mais je tiens au moins que si les problèmes ne sont pas convenablement posés, les « solutions » seront à coup sûr déconnantes. La genèse du Chiapas ou du Rojava est à l’opposé de ça : elle répond à un modèle de la fuite — on se tire, on vous laisse, nous on va faire notre affaire ailleurs. Du coup on se tire ensemble, entre individus qui ont le même désir, la même idée. Alors il n’y aura pas à lutter contre une réaction intérieure. C’est une donnée nouvelle, considérable ! C’est très beau ce modèle de la fuite collective. Mais à quel degré est-il généralisable ? Imaginez en France une masse assez importante qui investit une portion de territoire conséquente pour se faire un équivalent de Rojava. Et vous pensez que l’État français, centraliste, jacobin, laisserait faire une chose pareille ? Il n’a même pas toléré une ZAD. Le temps a passé, le capital s’est déplacé, il est devenu (encore plus) méchant, l’État du capital avec lui, même une possibilité comme le Larzac d’il y a quarante ans n’existe plus.
Il y a dans vos pages un souci de l’homme ordinaire — de « la gente común », diraient les zapatistes. Vous réhabilitez le quotidien quand d’autres misent tout sur l’Évènement : rompre avec l’ordre en place relèverait de la course de fond ?
Je ne récuse nullement la catégorie d’événement, en tout cas en son sens ordinaire — l’événement aux sens de Badiou ou Deleuze, c’est autre chose. Écarter l’« événement », en quelque sens que ce soit, tout en réhabilitant le « grand soir », il faut avouer que ce serait singulièrement incohérent. Non, pour emprunter son titre à Ludivine Bantigny, je dirais plutôt que, passé le grand soir, il faut penser aux petits matins — moins enthousiasmants. L’effervescence du moment insurrectionnel est par définition transitoire. L’erreur serait de prendre ses intensités particulières pour une donnée permanente. Je me méfie des formules politiques qui tablent « en régime » sur une forte mobilisation au quotidien. C’est trop demander : le désir des gens c’est de vivre leur vie. Bien sûr cette antinomie de la « politique » et de la « vie » a sa limite, et l’on pourrait dire que la ZAD, le Chiapas, ou le Rojava, c’est vivre d’une manière qui est immédiatement politique, qu’y vivre c’est intrinsèquement faire de la politique. Alors la séparation de « la politique » et de « la vie » est résorbée. Mais il faut avoir atteint ce stade de résorption pour que l’idée même de « mobilisation au quotidien » s’en trouve dissoute et que, simplement vivre, ce soit de fait être mobilisé. Pour l’heure, nous qui contemplons la perspective d’un dépassement du capitalisme, nous n’y sommes pas, en tout cas pas majoritairement. Il faut donc trouver des voies politiques révolutionnaires qui fassent avec la « gente común » comme elle se présente actuellement, sans minimiser les déplacements considérables dont elle est capable, mais sans non plus présupposer des virtuoses de la politique, ayant déjà tout résorbé, tout dépassé, capables même de performances « éthiques » bien au-delà du simple fait de « vivre politiquement » — donc sans présupposer que tout ce qu’il y a à faire est comme déjà fait. Finalement, l’une de mes préoccupations dans ce livre c’est ça : continuer de penser une politique qui ne soit réservée ni à des moments exceptionnels (« événements ») ni à des individus exceptionnels (« virtuoses »).
Un dernier point — et non des moindres. L’essayiste marxiste Andreas Malm assure que l’écologie est « la question centrale qui englobe toutes les autres ». Signez-vous des deux mains ?
Même pas d’une. Pour moi la question première, ça a toujours été « ce qu’on fait aux hommes ». « Ce qu’on fait à la Terre » est une question seconde, j’entends : qui ne fait sens que comme déclinaison de la question première — oui, à force de bousiller la Terre, ça va faire quelque chose aux hommes… Lesquels d’ailleurs ? Comme de juste, ça risque de leur faire des choses assez différenciées. Sauf à la toute fin bien sûr, quand tout aura brûlé, ou sera sous l’eau, je ne sais pas, mais ça n’est pas pour demain et entre temps les inégalités « environnementales » promettent d’être sauvages. J’avoue que le soudain éveil de conscience politique de certaines classes sociales urbaines éduquées au motif de « la planète » me fait des effets violemment contrastés. Pour « sauver la Terre » on veut bien désormais envisager de s’opposer au libre-échange international. Mais quand il s’agissait de sauver les classes ouvrières de la démolition économique, une position protectionniste était quasiment l’antichambre du fascisme. Que « la planète » puisse devenir ce puissant légitimateur là où « les classes ouvrières » ne suffisaient jamais à rien justifier, et finalement comptaient pour rien, c’est dégoûtant — et ça me semble un effet typique de la hiérarchisation des questions premières et secondes. Maintenant, on fait avec les formations passionnelles que nous offre l’histoire. Un affect « climatique » puissant est visiblement en train de se former. Toutes choses égales par ailleurs, c’est tant mieux, trouvons à en faire quelque chose. Et pour commencer, trouvons à y faire embrayer un certain travail de la conséquence. Car il y a encore loin de l’angoisse climatique à la nomination claire et distincte de sa cause : le capitalisme. Et à l’acceptation de la conséquence qui s’en suit logiquement : pour sauver la Terre afin de sauver les hommes, il faudra sortir du capitalisme. C’est peut-être une part déraisonnablement optimiste en moi, mais j’aime à croire, en tout cas sur ce sujet-là, que la logique trouvera, malgré tout, à faire son chemin.
Chili 73
Texte publié en septembre 2020, sur le blog de F. Lordon, La pompe à phynance
Jamais, nulle part, la bourgeoisie n’a rendu les clés de son propre et gracieux mouvement. Pourquoi le ferait-elle d’ailleurs ? Pourquoi laisserait-elle faire la destruction de la société capitaliste, puisque la société capitaliste est pour elle ? Aussi, sous toutes les latitudes, et à toutes les époques, la bourgeoisie a-t-elle le même visage distordu de haine, la même frénésie de faire tirer sur la fouler, que cette rombière à brushing et lunettes de soleil saisie par la caméra de Patricio Guzman dans les rues de Santiago en 1973. Et sinon toute la « bourgeoisie », catégorie sociologique mal définie et qui brasse plutôt large, du moins sa fraction la plus conséquente, consciente de soi comme classe et consciente de ses intérêts de classe — la bourgeoisie ensauvagée.
Par toutes les fibres de son être, cette bourgeoisie, toujours, partout, est versaillaise. C’est en France, en effet, en 1871, qu’elle réalise pleinement son concept et, du même mouvement, indique tout ce qu’il faut savoir de la démocratie bourgeoise. La démocratie bourgeoise est ce régime où l’on peut parler de tout à l’exception de ce qui assoit le pouvoir social de la bourgeoisie — à savoir, en dernière instance, la propriété privée des moyens de production, et la forme particulière d’enrôlement qu’elle détermine : le salariat. Quiconque entreprend de toucher à ça trouvera la bourgeoisie en travers de son chemin.
Leçon de chose
Entre 1970 et 1973, Salvador Allende s’y est risqué. Il en a résulté une leçon de chose politique d’une cruauté qui force la méditation – au moins de ceux qui auraient le projet de recommencer.
Mais quelle idée de retourner au Chili des années 70 en pleine pandémie des années 20 du siècle d’après ? Celle précisément de rappeler à quoi pourrait être confronté le simple désir qu’« après le Covid plus rien ne pourra être comme avant », même quand il voit que le mouvement naturel des choses n’y suffira pas, et qu’il faudra lui donner un coup de main — toute la question étant de savoir ce qu’il faut entendre par « coup de main »…
Si l’expérience chilienne est utile[1], c’est parce qu’elle est récente. Les formes de société qu’elle nous figure sont plus proches des nôtres que celles de la Russie de 17 ou de la Chine de la Longue Marche — partant, les comparaisons plus faciles et plus parlantes. Les problèmes auxquels elle a eu à faire face ne sont pas si différents de ceux que nous rencontrerions, aurions-nous le projet de nous en inspirer, dans les termes où elle-même se définissait alors : « l’avènement du socialisme par la voie démocratique ».
Car c’est là finalement toute la question : en matière de « socialisme » (qu’on tiendra ici pour un nom générique de la sortie du capitalisme), qu’est-il permis d’espérer de la « voie démocratique » ? Une expérience de pensée[2] figurant un gouvernement de gauche non pas du tout anticapitaliste, mais gentiment… social-démocrate (au sens historique du terme), c’est-à-dire, quand même, décidé à œuvrer pour modifier les conditions structurelles du rapport de force entre le capital et le travail, donc à s’en prendre aux agencements de la mondialisation financière et commerciale, cette expérience de pensée livre déjà ses enseignements. Quand bien même il s’en tiendrait à cette base programmatique somme toute modérée relativement à ce qu’exigent en fait les urgences environnementales et sanitaires désormais mêlées[3], ce gouvernement serait défait en rase campagne : par les forces des marchés de capitaux et leur pouvoir de mise en échec (via les taux d’intérêt) de toute politique économique qui leur disconvient, par les forces de la propagande médiatique — il n’y a que dans les normes distordues de la presse du capital qu’on qualifie d’« extrême gauche » des agendas finalement aussi tempérés, comme celui qui est envisagé ici. Et puis par les forces du sabotage patronal.
C’est probablement la mention la plus propre à renvoyer l’expérience de pensée à son statut de délire paranoïaque — comme si des choses pareilles pouvaient exister, franchement. Or, en fait, elles existent. Il est vrai que le Chili d’Allende est un cauchemar pour les anticomplotistes : une déstabilisation organisée depuis la Maison Blanche, la CIA à la manœuvre, des multinationales appelées en relais, des transferts de fonds pour soutenir la réaction chilienne. On soumettrait sur le papier un scénario pareil aux docteurs de Conspiracy Watch, ils signeraient le bon d’internement dans la minute. Malheureusement, tout est vrai, et documenté. Ces choses-là ne sont sans doute pas ordinaires, mais elles existent. Or, les procédés extra-ordinaires sont fait pour être remobilisés dans des circonstances extra-ordinaires. Extra-ordinaire, c’est probablement ainsi que l’oligarchie capitaliste qualifierait une situation politique où l’ordre capitaliste se trouverait mis directement en question. De là, probablement aussi, les moyens « adéquats » qui s’en suivraient. C’est ce qui s’est passé au Chili au début des années 70.
Y compris, donc, ceux du sabotage patronal. La grève des — patrons — camionneurs met en panne toute la distribution, la pénurie organisée ayant pour effet de faire proliférer le marché noir, et exploser les prix, dans une situation où l’inflation est déjà un problème — elle entrera dans des zones où l’on peut parler d’hyperinflation. L’embargo sous lequel l’économie chilienne se trouve placée la prive et de ses exportations de matières premières (le cuivre notamment) et de ses importations stratégiques (machines et pièces). Le FMI et la Banque mondiale lui refusent toute assistance financière. Normalement aucun projet socialiste démocratique ne tient le choc quand la population est reconduite à la faim. Et pourtant la population chilienne tient ! Enfin « la population » : la classe ouvrière. Avec en face, donc, les bourgeoises à brushing et glapissements, et puis le patronat, enfin, surtout, l’armée. Car l’appareil de force a fait son choix.
La fin de l’histoire est connue : la « démocratie », le parlement, la « loi de la majorité », tout ça finit en bombardement aérien de la Moneda. Et voilà le point de cruauté de la leçon de chose : jusqu’au dernier moment, Allende a voulu croire en la procédure « démocratique », et refusé l’option de la classe ouvrière en armes. Malheureusement, en face, on n’y croyait pas. Moyennant quoi, les armes n’ont été que d’un côté — qui a, logiquement, été vainqueur. Drame classique de la théorie des jeux : celui qui joue la coopération dans un jeu non-coopératif finit comme à la belote : capot.
On dira que c’est en fait une leçon très ancienne — on la ferait aisément remonter à la Commune, voire à 1848. Elle n’en est pas moins utile à redécouvrir, d’autant plus que la relative proximité du Chili 73 lui donne un relief de sens supplémentaire, mieux fait pour nous parler que les épisodes trop distants et trop déréalisés par l’éloignement dans le temps. Cette leçon tient que la chose que nous appelons « démocratie » n’a rien de démocratique, qu’elle a partie liée avec certains intérêts fondamentaux, et qu’elle met bas les masques dès que ces intérêts se trouvent mis en danger. À partir de quoi tous les moyens lui sont bons.
La « démocratie » est une pantomime dont le champ est très précisément circonscrit. Et d’une circonscription qui va en se rétrécissant à mesure que ces intérêts fondamentaux vont, eux, en s’étendant. Or cette extension, d’ailleurs indéfinie, est le sens même du néolibéralisme. Dont nous ne cessons de mesurer le rétrécissement corrélatif — et ses procédés, en longue période, se sont durcis à vue d’œil : depuis les confiscations des traités européens jusqu’à l’état d’urgence permanent et les éborgnements en série pendant les « gilets jaunes ».
Qu’on s’en prenne au noyau dur, et l’on voit dans l’instant ce qu’il reste de la-démocratie-on-peut-parler-de-tout. Le degré auquel, ne serait-ce que ces deux dernières années, nous nous serons entendu répéter par les violents que « la démocratie, c’est le contraire de la violence » devrait être suffisant pour nous renseigner à cet égard. Quand les pires violents vont psalmodiant que « la démocratie, c’est le débat », c’est que leur idée du « débat » est manifestement une énorme arnaque.
Philosophies de service
Comme toujours, le vrai lieu d’étonnement n’est pas tant du côté des éborgneurs que de celui des intellectuels de service après-vente. Car cette colossale ânerie de « la-démocratie-on-peut-parler-de-tout » est l’article de foi d’une corporation entière, journalistique notamment. Ainsi le journalisme à prétention intellectuelle n’aura pas cessé de démontrer son inanité intellectuelle en élisant depuis des décennies Jürgen Habermas comme son penseur de référence, celui qu’on sort du placard quand les temps donnent de la gîte et qu’il s’agit de se souvenir quoi penser. Alors Habermas nous assomme d’une pleine page dans Le Monde ou dans L’Obs pour répéter que l’Europe est notre salut et « la démocratie » notre bien le plus précieux. Sans surprise, le principal liquidateur du marxisme dans l’École de Francfort, donc de l’École de Francfort, commencé philosophe de l’agir communicationnel, est devenu le barde tout-terrain du « débat démocratique », de la « délibération », réglée comme il se doit par les normes de la « rationalité dialogique » et la « force du meilleur argument » — bref de la politique comme séminaire universitaire. Entre gens de bonne volonté, tout n’est-il pas soluble dans la discussion ?
Pas de bol, au Chili la solution était plombée. Comme on peut s’y attendre quand « les gens de bonne volonté » se trouvent à défendre ce qui leur semble être leurs intérêts existentiels fondamentaux, à plus forte raison quand les uns ont des armes et pas les autres. Habermas n’a jamais dû voir de sa vie la rombière de Santiago ou quelque de ses équivalents fonctionnels — qui, pourtant, ne manquent pas. Médème n’est pas exactement en route pour deux heures de séminaire : elle veut qu’on se décide enfin à tirer sur cette saloperie d’ouvriers communistes. Ce qui sera fait.
Mais Habermas, la politique réelle, les forces sociales réelles, leurs agendas et leurs moyens réels, ça n’est pas trop son truc. Pourquoi donc la vie politique différerait-elle de la vie tout court — c’est-à-dire de la vie universitaire ? Le prodigieux contresens nommé « la-démocratie », dressé comme saint-sacrement par la classe entière des possédants et leurs ilotes intellectuels, aura valu au Chantre tous les honneurs que réserve sa version à lui de « la vie tout court ». Quant à Allende qui, pour son malheur, y avait ajouté foi, la vie, lui l’y aura laissée. Et bon nombre de ses camarades derrière lui.
Les expériences politiques passées s’ajoutent donc aux expériences de pensée présentes pour nous permettre de mesurer ce qu’il est permis d’espérer des procédures électorales dans le capitalisme quand c’est le capitalisme qui doit être mis en cause : rien. Mais le malaxage des esprits depuis si longtemps y a incrusté la religion de « la démocratie » si profond que rien ne semble pouvoir venir à bout de son argument formel, tel qu’il résonne si familièrement : comme une discussion entre gens de bonne foi où le différend (mineur) se règle par la parole rationnelle.
Mais si la politique sous capitalisme avait jamais répondu à ce genre de définition projective, on aurait dû s’en apercevoir. Étonnamment le fait de n’avoir jamais rien observé de tel n’empêche pas certains de retourner à l’écurie de « la démocratie », et de l’investir du fol espoir que, si la discussion conduite dans les formes détermine qu’il faut en finir avec le capitalisme, eh bien nous en finirons avec le capitalisme. D’une part, il n’y a pas la moindre chance que l’ordre capitaliste tolère une organisation (constitutionnelle, électorale et médiatique) de la discussion qui puisse conduire à un tel résultat. Et d’autre part, si quelque miracle y conduisait malgré tout, on verrait de quel bois démocratique le capital se chauffe : le même qu’au Chili en 1973, le même qu’à chaque époque de l’histoire où il s’est trouvé sur la sellette.
Comme de juste, c’est là le genre de considération qui fera l’objet du plus épais déni de la part des « démocrates ». Des plus vives condamnations également. Car dans l’univers mental d’un « démocrate », il y a deux camps : les « démocrates », bien sûr, et les violents — « qui ne veulent pas du débat ». Par exemple, pendant les « gilets jaunes », les violents ne voulaient pas du « grand débat » de Macron. C’était bien la preuve qu’ils étaient des violents. Ne pas vouloir du Grand Débat, c’était bien être contre la démocratie. Puisque la démocratie c’est le débat. En bonne logique, on aurait d’ailleurs dû aller jusqu’à déduire que le Grand Débat était de la Grande Démocratie. Mais même Thomas Legrand n’a pas osé aller jusque là.
Comme tout le reste de la justification néolibérale du monde, cet argument-là est en train de partir en charpie, et n’est plus maintenu que par l’acharnement de quelques répétiteurs éditoriaux[4]. Ce que valent la « démocratie », son « débat » et ses scrutins sous la garde des institutions de la Ve République et du cirque médiatique, une part croissante de la population commence à s’en faire une idée assez juste. Qui voit aussi de mieux en mieux, entre violences sociales, violences symboliques, violences langagières et violences policières, qui sont les vrais violents dans cette société.
On peut gager que, bientôt, plus grand monde ne se laissera arrêter par ce genre d’arguties, peut-être même plus ceux qui étaient pourtant le mieux disposés à y croire — la bourgeoisie « éduquée »[5] — quand ils constateront que toutes les protestations pacifiques du monde ne dévient pas d’un iota le cours du désastre climatique et pandémique[6] — c’est-à-dire le cours du capitalisme. On peut compter, à ce moment-là, sur les derniers chiens de garde pour jeter, une fois de plus, l’opprobre sur les « violents ». Et faire oublier, s’ils l’ont jamais sue, cette phrase du « meilleur d’entre eux », le révéré, l’embaumé JFK, qui, pas tout à fait conforme au modèle du bolchevique à couteau entre les dents, n’en savait pas moins que « ceux qui rendent une révolution pacifique impossible, rendent une révolution violente inévitable ». L’histoire ne connaît pas d’autre responsables du niveau de violence que les dominants.
Conclusions provisoires
Il y a deux conclusions à ne pas tirer de tout ceci, plus une troisième qui s’en suit en les inversant — et elle à retenir.
La première conclusion déduirait que, si « la voie démocratique vers le socialisme », telle qu’Allende crut pouvoir la tenir, est impraticable, alors ne reste que l’alternative du statu quo ou du règne (peu démocratique…) des avant-gardes révolutionnaires. Comme toujours, les antinomies qui prétendent épuiser les possibles rendent inaccessibles tous les termes intermédiaires. Dont l’espace se rouvre sitôt qu’on cesse de tenir pour consistant le premier de ses termes : « démocratie ». Car la première conclusion juste qui se déduit par inversion de la première conclusion fausse, c’est que la « démocratie » n’est qu’une terrible homonymie — si, pour l’heure, l’écrasante majorité s’y laisse prendre. La « démocratie » n’a rien à voir avec la démocratie — elle n’en est que le pâle simulacre en temps ordinaires, et le parfait retournement sitôt qu’on s’approche de ses points-limites. Un à qui la chose n’avait pas échappé, c’est Brecht : « Le fascisme n’est pas le contraire de la démocratie mais son évolution par temps de crise ». C’est peu dire que ces dernières années en France, et dans beaucoup d’autres pays, donnent consistance à cette idée.
Brecht ne met pas de guillemets à « démocratie », mais on peut les mettre à sa place. Pour pouvoir aussitôt les enlever — et accéder à une idée de la démocratie sans guillemets. Car d’authentiques expériences démocratiques, qui ne s’affaissent pas dans le parlementarisme capitaliste (le vrai nom de la « démocratie »), nous en connaissons : Chiapas, Rojava, Catalogne 1936. Qu’elles existent ne nous dispense pas de nous poser la question de leurs *conditions * : conditions de formation, conditions de viabilité interne, de résistance à l’adversité externe, etc. Et encore moins de nous poser la question subsidiaire de la possible transposition, ou non, de ces conditions à notre situation propre. Mais elles existent et, même si la politique ne procède pas par décalcomanie, c’est une idée qui procure de l’agrément, de l’énergie, et un sens de l’orientation.
La deuxième conclusion erronée partirait de l’hypothèse (robuste) qu’en ce moment personne n’a envie de prendre les armes, pour en tirer qu’alors « rien » ne se passera. Ici il faut peser les arguments contradictoires. Le premier souligne que les sociétés bougent, leurs sensibilités se remanient, des choses possibles à une certaine époque cessent de l’être à une autre — par exemple un putsch de forces armées (en France aujourd’hui, ce ne serait d’ailleurs pas tant l’armée que la police), faire tirer sur la foule, etc. Il s’ensuit qu’une transition au « socialisme » (communisme), s’il est exclu qu’elle vienne de la voie parlementaire strictement, répondrait à des conditions moins tragiquement exigeantes que celle du Chili par exemple. Le deuxième argument tient au contraire que l’histoire est toujours capable de tout. On se souvient de la question lancinante de savoir comment un peuple de si haute culture que l’Allemagne avait été capable de la Shoah. Dans l’ordre de la fiction, c’est le réalisme à s’y méprendre qui rend impossible de se débarrasser du doute, ainsi du Complot contre l’Amérique de Philip Roth, où les États-Unis passent au fascisme sous la présidence d’un Charles Lindbergh aux sympathies ouvertement nazies. Qui pourrait garantir qu’en France il est inconcevable qu’on ouvre des stades ? — d’ailleurs[7]…
Comme toujours, ce sont les circonstances concrètes qui trancheront entre ces tendances opposées — au moins est-il utile de n’en dénier aucune. Avec l’espoir que les armes n’aient rien à faire dans le processus — redisons que, pour l’heure, on ne voit pas trop qui se sent de les empoigner (à bien des égards c’est tant mieux), et que cette donnée aussi fait partie de l’analyse réaliste d’ensemble. Alors quoi ? Alors la masse. La masse et ses irruptions ignorantes de l’ordre légal du capitalisme — d’autant plus réalisables qu’elle sera plus nombreuse. C’est ça la troisième conclusion.
La troisième conclusion, c’est celle qui, s’appuyant sur des expériences de pensée, certes imaginaires mais édifiantes, et sur des expériences réelles, commence par mesurer très exactement ce qu’elle peut espérer de la « voie démocratique », en fait assimilée par erreur à la voie électorale-parlementaire (interne au capitalisme). Puis qui, s’inspirant de nouveau de l’histoire, évalue ce dont l’oligarchie du capital est capable en situation de menace sérieuse. Qui, dans la période présente, ne s’abandonne pas non plus au seul pouvoir « chaotisant » du choc social (énorme) qui vient — le chaos n’a par soi aucune vertu progressiste. Enfin qui connaît son arme véritable : le nombre.
Lire aussi
Frederic Lordon, Et la ZAD sauvera le monde…, monde-diplomatique.fr, octobre 2019
Frédecic Lordon, Ils ne lacheront rien, blog.mondiplo.net, mai 2020
Renaud Lambert, « Quand les militaires fauchent l’espoir d’une nouvelle voie vers le socialisme », Le Monde diplomatique, septembre 2013.
Franck Gaudichaud, « L’Unité populaire par ceux qui l’ont faite », Le Monde diplomatique, septembre 2003.
Pierre Kalfon, « Soirs d’euphorie, matin de désespoir », Le Monde diplomatique, septembre 2003.
Serge Halimi, « Stratégie pour une reconquête », Le Monde diplomatique, septembre 2013.
[1] Pour en avoir une vue globale : Franck Gaudichaud, Chili 1970-1973. Mille jours qui ébranlèrent le monde, Presses Universitaires de Rennes, 2013.
[2] F. Lordon,* Ils ne lacheront rien,* blog.mondediplo.net
[3] Le tableau qu’en dresse Andreas Malm dans La chauve-souris et le capital (La Fabrique, 2020) est tout simplement saisissant (= totalement flippant).
[4] https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/01/07/gilets-jaunes-la-violence-ou-le-debat_5405930_3232.html
[5] https://www.monde-diplomatique.fr/2020/08/RIMBERT/62101
[6] À cet égard lire Andreas Malm, Comment saboter un pipeline, La Fabrique, 2020.