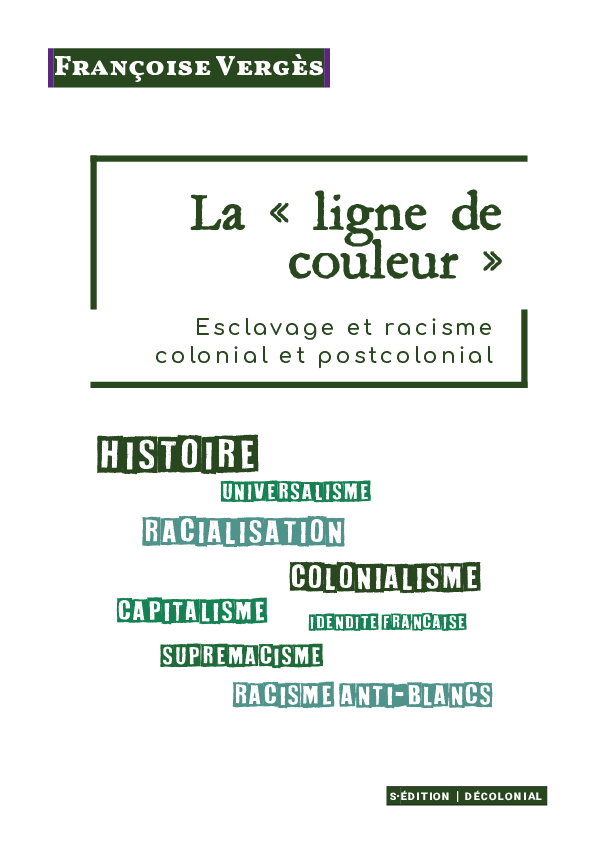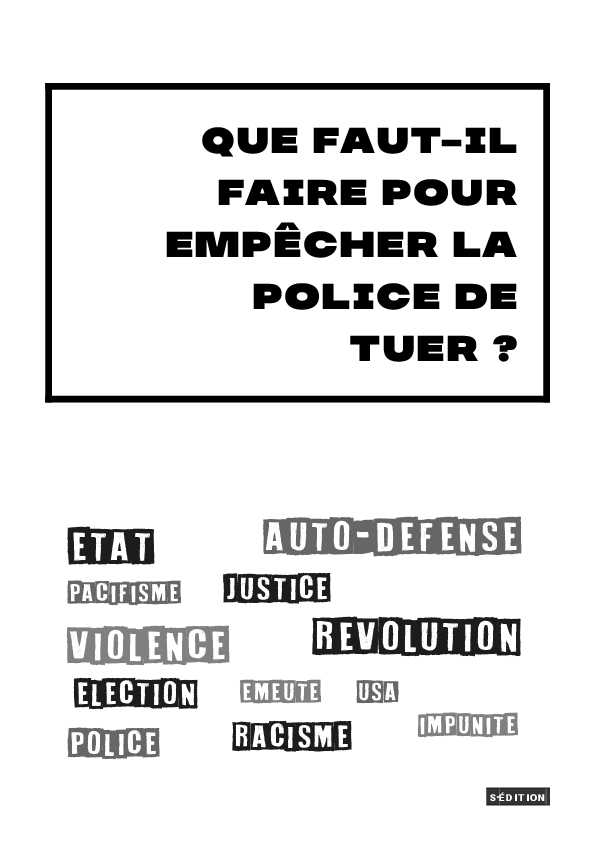Françoise Vergès — la ligne de couleur
Temps de lecture : ~ 23 minutes
Ce texte est extrait du livre* De quelle couleur sont les blancs ? , *Publié en 2013 aux éditions La découverte.
Depuis quelque temps, les anecdotes s’accumulent dans les médias ou chez les hommes politiques sur la crainte, la peur et le sentiment, ressentis par des « Blancs », de ne plus être « chez soi », un « chez soi » menacé par des personnes qui ne partageraient pas les mêmes « valeurs culturelles ». En effet, un déplacement s’est opéré : la menace ne s’adosse plus ouvertement à la couleur de la peau mais aux valeurs culturelles qui fonderaient la tradition et l’identité d’un peuple ou d’un groupe (et il faudrait peser chaque mot de cette phrase). Il y aurait donc en France des individus dont la culture est indissoluble dans le creuset républicain et qui, pour des raisons culturelles, démontreraient une inaptitude à assimiler des valeurs dites universelles et modernes. Dans cette réorganisation du champ des victimes et des discriminations, les Blancs seraient devenus des cibles ; et ils seraient en outre privés de tout recours, car le racisme ayant été construit par des antiracistes angéliques et professionnels défendant exclusivement des personnes non blanches, ils ne pourraient être entendus. D’où les protestations et les pétitions contre le « racisme anti-Blancs », à commencer par l’« Appel contre les ratonnades anti-Blancs » du 25 mars 2005, à la suite duquel Pascal Bruckner déclarait avoir déjà dénoncé dans Le Sanglot de l’homme blanc, en 1983, la culpabilisation de l’Occident : « J’y évoquais déjà, à l’époque, le racisme anti-Blancs dont je demandais qu’il soit dénoncé au même titre que les autres. Je fus, pour cet essai, mis au ban de la gauche pendant des années, y compris dans ce journal [Le Nouvel Observateur] » [Bruckner, 2005].
Le retour dans l’Hexagone d’une taxonomie associée à la colonie est intéressant à plus d’un titre. D’abord, qu’est-ce qu’un Blanc ? Quelle est l’histoire de cette couleur sociale ? Quand un individu devient-il blanc ? Et qu’est ce qui va conduire à la création d’une « ligne de couleur » entre libre et servile, civilisé et barbare, Blanc et Noir, induisant des conséquences dans les domaines juridique, social, culturel et politique ? Finalement, comment la « ligne de couleur » est-elle venue en métropole ? Comment a-t-elle pénétré les mouvements d’idées, les pratiques, les représentations ?
Encore trop souvent, on pense que l’organisation racialiste des sociétés fut mise en place avec la colonisation postesclavagiste et le développement massif des justifications idéologiques de la hiérarchie des races. Or, dès que les pays européens, et au premier chef la France, se sont lancés dans la traite des Africains puis ont développé dans leurs colonies un système d’économie esclavagiste où la main-d’œuvre servile a bientôt été exclusivement d’origine africaine, ils ont justifié cet état de fait avec un discours racialisant – les termes « racialisation » et « racialisé » étant ici compris comme désignant la mise en place d’une « ligne de couleur » où les non-Blancs sont associés à des qualités négatives et les Blancs à des qualités positives.
Comme le signalent Étienne Balibar et Immanuel Wallerstein dans Race, nation, classe [Balibar et Wallerstein, 1988], il faut reconnaître dans l’existence de la « représentation esclavagiste des populations soumises à la traite comme “races inférieures”, toujours déjà prédestinées à la servitude et incapables de civilisation autonome », « le fait que dès le début, les représentations racistes de l’histoire [ont été] en rapport avec la lutte des classes ». Une « racialisation du travail manuel » s’est mise en place, instaurant peu à peu une cartographie du travail servile qui a tracé des frontières entre les pays des hommes blancs et libres (qui ne pouvaient être esclaves, ainsi que le spécifiait pour la France l’édit de Louis X en 1315, reconnaissant au nom du « droit de nature » l’impossibilité d’être français et esclave) et les pays des hommes noirs et asservis. Une carte, nous le savons, est un acteur d’homogénéisation, elle produit un effet de « vérité » pour un peuple qui peut ainsi s’identifier à une entité territorialisée spécifique. En l’occurrence, la carte de territoires associés à des couleurs antagonistes a acquis une importance politique emblématique ; elle distinguait le territoire qui garantissait l’accès aux droits naturels de ceux où, comme l’écrivait Victor Hugo, des peuples dans la nuit attendaient les lumières de l’Europe.
Avant de revenir sur ce point, j’aimerais suggérer quelques remarques sur la peau et la peur. La peau car elle a été au centre de cette cartographie de la couleur, la peur parce qu’elle permet d’instrumentaliser la notion de race pour former une réponse à une crise politique et économique, une crise où le racisme apporte des moments de certitude. Se croire victime de « racisme anti-Blancs » rassure, cela permet de ne pas se poser de question sur le passé esclavagiste et colonial, la géopolitique des inégalités ou sur les politiques répressives contre les peuples en Europe, ni même de se souvenir des moments de solidarité. La peau est pour les êtres humains la surface sur laquelle sensations et perceptions sont les plus fortes. Sa « couleur » est une évidence visible. Bien qu’il n’y ait pas à proprement parler de peau « noire » ou « blanche » ou « jaune » mais des nuances infinies, des particularités qui font de tous les êtres humains des personnes « de couleur », la couleur de la peau est vécue de manière très intime. Une simple perception visuelle réduite à un mot (blanc, noir, jaune…) devient souvent le seul indice d’une identité sociale et culturelle. C’est le « Ciel, un Noir ! » lancé par une petite fille ayant croisé Frantz Fanon qui déclencha chez ce dernier une analyse éclairante sur l’expérience vécue du Noir [Fanon, 1952]. Les dénominations « Noir » ou « Blanc » « fonctionnent comme des “deux en un” : elles disent à la fois la teinte de la peau de la personne et son identité, laissant dans le même temps entendre que chaque identité va simplement avec une apparence précise » [Belliard, 2012, p. 75]. Or la peur qu’inspira la couleur de peau noire fut un sentiment puissant dans la colonie. Très rapidement, les unions sexuelles entre Blancs et Noirs y furent interdites. Mais ces mesures touchèrent aussi la France où, dès 1694, l’arrivée des Noirs fut réglementée et, en 1738, le mariage entre Blancs et Noirs y fut interdit. Un édit de 1716 refusa aux Noirs la liberté associée au sol français : « Les esclaves nègres de l’un ou l’autre sexe, qui seront conduits en France par leurs maîtres, ou qui y seront envoyés par eux, ne pourront prétendre avoir acquis la liberté sous prétexte de leur arrivée dans le royaume. » Une série de règles et de décrets contrôlèrent désormais l’entrée des Noirs en France, puis une « Police des Noirs », créée en 1777, interdit l’entrée des Noirs, libres ou esclaves, sur le sol de France ; ceux d’entre eux qui avaient été capturés furent enfermés dans des dépôts ouverts dans les grandes villes [Niort, 2002]. Ceux qui obtinrent l’entrée sur le sol français eurent interdiction de se marier et furent dans l’obligation de se déclarer à la police… Aux colonies, la peur des révoltes d’esclaves et de leur vengeance fit régner un climat très conservateur et conformiste, nourrissant le repli et l’agressivité. Un des piliers de l’ordre colonial esclavagiste fut la peur de l’homme noir ; la femme noire était objet de mépris et de viol. Dans La Prochaine Fois le feu, James Baldwin, un des analystes les plus incisifs des relations entre Blancs et Noirs, revient sur le rôle joué par l’homme noir dans la peur de l’homme blanc : « L’homme noir a eu comme fonction d’être une étoile fixe, un axe immobile pour le monde de l’homme blanc, et maintenant que l’homme noir refuse de remplir cette fonction, le ciel et la terre (du monde blanc) sont ébranlés » [Baldwin, 1964, p. 16-17]. La peau et la peur jouèrent donc un rôle central dans l’élaboration du monde blanc.
Le discours du « racisme anti-Blancs » réapparaît à des moments précis où peur, frustration, ressentiment, colère, sentiment de déclassement, perte de narcissisme se mêlent. Il se présente comme un recours pour reconstruire une communauté nationale imaginée et unie de manière fantasmatique autour de valeurs culturelles présentées comme traversant les siècles sans jamais être affectées. Pour contrecarrer ce récit imaginaire, il faut retracer la relation entre la dimension raciale de la colonisation et la dimension coloniale de la race, et leur lien avec la construction de la Nation, tout en évitant d’écrire une histoire linéaire de ces relations. La période esclavagiste, impérialiste puis postcoloniale de la société française n’entraîna pas les mêmes formes d’expression de la « blanchité ». Cette dernière, qui ne fut pas imposée sans résistance, n’était pas non plus hégémonique. Mais Aimé Césaire, James Baldwin et Frantz Fanon l’ont démontré : pas de couleur blanche sans couleur noire – « le Blanc n’existe pas. Pas plus que le Nègre », rappelait Fanon. La déconstruction du discours du « racisme anti-Blancs » induit donc de revenir à sa généalogie, de briser la relation antagoniste créée dans les colonies entre Blancs et Noirs, ce pilier inamovible qui rassurait la société coloniale.
Cependant, nous n’en sommes plus à l’heure glorieuse des colonies. Après les indépendances des colonies françaises, ceux qui tiennent le discours de l’homme blanc ne sont plus les pionniers héroïques bravant les sauvages de l’épopée impérialiste, mais les membres d’un pays qui a perdu ses colonies et connu des défaites militaires et politiques. Or ce sont des personnes venues de ces colonies perdues qui, en vivant désormais en France, en étant devenues ses citoyens, rappellent chaque jour par leur présence à la fois un passé glorifié et un présent étriqué. L’indépendance des colonies n’a pas eu l’« effet de réalité » qui aurait conduit à une décolonisation de la société française. Le discours sur le « racisme anti-Blancs » émerge donc dans un contexte de nécessaire mais difficile révision du récit de la conquête coloniale, de décolonisation de la société française, mais aussi de fragilisation des classes laborieuses, de paupérisation généralisée, où la vieille et solide formule « diviser pour régner » fait de nouveau entendre sa voix.
La société française fut, tout au long de son histoire moderne, pénétrée par un discours racialisé. Blanche, elle l’est devenue par paliers, par glissements, et blanches sont devenues la liberté, l’égalité et la fraternité. En 2012, répondant à la décision du MRAP de faire référence dans son texte d’orientation au « racisme anti-Blancs », le journaliste Alain Gresh rappelait que cette notion, traditionnellement portée par l’extrême droite, avait, depuis les années 1980, contaminé le discours de la droite et même d’une certaine gauche [Gresh, 2012, p. 5-6]. Pour le sociologue Saïd Bouamama, « la thèse du racisme anti-Blancs est le fruit de plusieurs décennies de construction sociale, politique et médiatique de l’islam et des musulmans comme religion et population dangereuses pour la République, l’identité nationale, la laïcité, l’émancipation féminine, etc. » [Bouamama, 2012, p. 7]. Le but du « racisme anti-Blancs », ajoutait-il, est de « réimposer par la peur et par l’injonction le retour au silence des personnes qui ont pris la parole ». Bouamama citait Frantz Fanon, pour qui le racisme « est une production et une nécessité du monde colonial ». Si l’auteur ne niait pas la réalité d’une certaine hostilité envers les Blancs, c’était, écrivait-il, du côté de la « dégradation des rapports sociaux dans les quartiers populaires sous le coup de la paupérisation et de la précarisation pour tous, auxquelles s’ajoute, lorsqu’on est issu de l’immigration, la discrimination raciste systémique » qu’il fallait regarder. De mon côté, je propose de revenir à l’esclavage colonial pour analyser comment se sont articulées dès ce moment-là les notions sociales et culturelles de « Blanc » et de « Noir ».
L’esclavage colonial ou l’organisation à l’échelle mondiale d’une main-d’œuvre racialisée
L’esclavage fut la matrice du monde colonial du xix e siècle. Il fut un laboratoire d’expérimentation des régimes d’exclusion racialisée, où furent mises en place une organisation d’une main-d’œuvre marchandisée, sexualisée et privée de droits, une géopolitique des inégalités et une idéologie du rattrapage (culturel, social, économique et politique) qui posait une norme à atteindre et plaçait tout groupe ou individu qui ne serait pas blanc, bourgeois et masculin en position de désirer atteindre cette norme. Cette « économie » s’est imposée de manière tout à fait remarquable. La réflexion d’Étienne Balibar sur les classes dangereuses qui « devaient être exclues par la force et par le droit de la “capacité” politique et cantonnées dans les marges de la cité ; aussi longtemps en somme qu’il importait de leur dénier la citoyenneté en montrant qu’il leur manquait constitutionnellement les qualités de l’humanité achevée ou de l’humanité normale » pourrait s’appliquer aux non-Blancs. Cette « économie » a su faire adopter par les classes populaires européennes l’idéologie d’un nationalisme ethnicisé. Elles sont devenues blanches par assimilation à une norme sociale et culturelle ayant organisé une « ligne de couleur ».
L’idéologie du rattrapage a construit une norme désirable et associée à des valeurs positives – modernité, beauté, esprit, vision de l’avenir. Ces valeurs universelles seraient nées sur un territoire, l’Europe (en réalité, dès le xviii e siècle, c’est une toute petite partie du continent qui est devenue l’« Europe » autour de l’axe Allemagne-France-Angleterre. Les terres de l’Est étaient perçues comme « barbares », celles du Nord et du Sud ignorées). Il n’était pas concevable que quiconque veuille les rejeter, sinon par incapacité à abandonner une « tradition », une culture et des valeurs qui, si elles étaient respectables car témoignant de la « diversité » du monde, n’en étaient pas moins des obstacles à la pleine jouissance de la liberté individuelle. Cette économie symbolique a eu des traductions politiques. Pour devenir citoyen avec des droits sociaux et civiques accordés aux membres d’une nation, il fallait se montrer méritant et être prêt à renoncer à des expressions culturelles et sociales qui, pour survivre, devaient appartenir au monde du folklore et de la marchandise. Les savoirs et langues populaires furent alors réinventés sous la forme de la diversité de régions fondues dans la Nation. Ce mécanisme expérimenté aux colonies – marginalisation ou effacement de langues, de cultures, de croyances… – fut appliqué aux régions françaises (Bretagne, Alsace…). Un phénomène similaire d’assimilation aux valeurs d’une classe sociale bourgeoise et masculine fut déployé pour séduire la classe ouvrière, ou certains mouvements sociaux comme les mouvements féministes.
De très nombreuses études ont été consacrées à ce phénomène d’unification de la nation française autour de principes universalistes, mais peu ont souligné un de ses aspects : la racialisation de la nation française. En effet, un des éléments « attractifs » de cette politique d’assimilation fut d’associer le statut de « Français » à la couleur de peau blanche. Pour que la couleur blanche construise une unité « spontanée » d’intérêt entre des personnes dont les cultures, les idées et les objectifs pouvaient diverger, il fallait qu’une autre couleur agisse, ainsi que le faisait remarquer Baldwin, comme un référent solide, fixe, éternel. La couleur noire opérait comme l’axe autour duquel le monde blanc s’organisait. Elle occupait tout l’espace, faisant de la couleur blanche une couleur universelle, qu’il était inutile de signaler puisqu’elle était « naturelle », appartenant à l’ordre du monde.
Avec l’esclavage, fait remarquer le juriste Jean-François Niort, un « système ségrégationniste se met donc en place au xviii e siècle, sur la base d’un critère de couleur, et vise à instituer et maintenir une sorte d’intermédiaire entre le colon blanc et l’esclave » [Niort, 2002]. Aucun individu de couleur n’était totalement libre, sa liberté était toujours fragile, soumise à des réaménagements et au bon vouloir de celui qui le possédait, susceptible de lui imposer sa volonté et son désir à tout moment. La couleur de la peau et le nom patronymique qui lui étaient attachés devenaient des signes qui indiquaient statut et place dans la société. Il serait naïf de penser que la France allait pouvoir se protéger de ces règles et pratiques. Le vocabulaire esclavagiste s’est invité dans la société française dès le xviii e siècle ; les dictionnaires de langue française ont fait des termes « Noir », « Nègre » et « esclave » des synonymes. Et la couleur « blanche » s’est insérée dans la société, mais comme une matière invisible. Dans l’Hexagone, des lois, des règles, des pratiques, des discours, ont pénétré les consciences et fini par poser des équivalences entre « Blanc » et « civilisé », « Blanc » et « citoyen », « Blanc » et « liberté ». Des pratiques fortement racialisées ont renforcé l’existence d’une « ligne de couleur », les « Blancs » d’un côté, les « non-Blancs » de l’autre, ces derniers finissant par être eux-mêmes répartis sur une échelle selon des critères racialistes (les Noirs se retrouvant en bas de cette échelle).
L’esclavage colonial a conduit à séparer le Blanc du Noir et, dans un va-et-vient entre colonie et métropole, entre différentes métropoles, de colonie à colonie, la « ligne de couleur » a émergé et s’est développée. Un autre phénomène a renforcé cette « ligne de couleur » : la séparation territorialisée entre consommation/pays des hommes blancs et libres et production/pays des hommes noirs et esclaves (une territorialisation qui exigeait que les formes d’exploitation et de répression dans la métropole soient ignorées). En effet, le réseau tissé par la traite négrière et l’esclavage entre production de biens destinés à la traite en France et produits coloniaux, entre produits coloniaux et nouveaux arts de vivre, nouvelles formes de civilité, a enserré la société française dans une dépendance dont elle n’est pas sortie. Tabac, sucre, café, coton, indigo (comme tant d’autres produits des colonies esclavagistes) ont d’abord été des produits de consommation associés à l’aristocratie, au rang et au prestige. Mais le tabac (associé à la virilité) est entré dans la consommation de masse, comme le café et le sucre (peu à peu associé à des caractéristiques de la féminité comme la douceur). C’est pourtant ce dernier qui, comme aucun autre produit auparavant, a façonné la « ligne de couleur » en géographie, dans l’environnement et sur le marché du travail. Les besoins européens en sucre ont exigé les esclaves. Sa production s’est appuyée sur la déportation de femmes et d’hommes réduits à des objets de propriété privée. Au xix e siècle, la consommation de sucre en France, était de 2 kg par personne et par an avant l’abolition de l’esclavage (en 1848) [Abbott, 2009]. Dans cette économie de consommation de plus en plus massive, les intérêts des ouvriers consommateurs étaient opposés à ceux des peuples réduits en esclavage ou colonisés. En 1792, le début de l’insurrection des esclaves de Saint-Domingue (la plus riche des colonies françaises qui fournissait plus de la moitié du sucre consommé en Europe) a entraîné une spéculation sur le sucre ; les prix ont flambé et des émeutes populaires ont éclaté contre la cherté de ce produit. Ceux qui manifestaient se battaient pour que leur accès à ce bien soit préservé, mais peu se souciaient des conditions dans lesquelles il était produit.
Ce réseau construit par l’économie prédatrice, qui divisait producteurs et consommateurs, ces derniers exigeant d’avoir accès à moindre prix aux produits dont ils étaient devenus dépendants, a justifié la « ligne de couleur » au niveau mondial. Il a agi pour construire le consentement à l’exploitation brutale aux colonies. C’est tardivement que ce lien fut remis en cause : au xix e siècle, les féministes anglaises ont compris qu’il fallait porter un coup à la production esclavagiste du sucre et que les arguments moraux ne suffisaient pas. Elles furent les premières à intervenir concrètement sur ce lien en inventant l’arme du boycott et en faisant du porte-à-porte pour faire baisser sa consommation. En écrivant qu’« il fallait pour piédestal à l’esclavage dissimulé en Europe l’esclavage sans phrase dans le nouveau monde » [Marx, 1969, p. 201], Karl Marx abordait une partie de la question. Il sous-estimait la spécificité de l’esclavage de plantation et faisait l’erreur des féministes, progressistes et révolutionnaires européens, qui posaient une équivalence entre une personne (femme, ouvrier, marginal…) à laquelle des droits étaient niés et le statut d’esclave racialisé aux colonies. Équivalence qui a provoqué des ruptures entre les mouvements féministes et ouvriers et les mouvements pour l’égalité aux colonies. Dans le mouvement féministe français – la même chose se produisit aux États-Unis –, le droit de vote accordé aux hommes affranchis fut vécu comme une insulte à leur qualité de femmes blanches. Ainsi, au lieu d’exiger l’extension des droits civiques, la féministe Hubertine Auclert protesta contre un droit donné à des barbares et des ignorants, alors que des femmes civilisées ne l’avaient toujours pas [Auclert, 1849].
Les impérialismes, le marché du travail et la « ligne de couleur »
À la fin du xix e siècle et de l’esclavage colonial, les bouleversements économiques et politiques en Europe, les nouvelles politiques de colonisation, les nouvelles découvertes technologiques, et les besoins en matière première et en main-d’œuvre servile qu’elles imposaient, entraînèrent une nouvelle organisation des flux de la main-d’œuvre racialisée à l’échelle mondiale. Le paysage social et culturel s’en trouva bouleversé. Des millions de Chinois et d’Indiens furent déplacés à travers le monde pour travailler dans les colonies françaises et anglaises de l’océan Indien, de l’Afrique, des Amériques et des Caraïbes, où ils subirent des conditions de vie et de travail très dures, proches de l’esclavage [Lake et Reynolds, 2008]. Les bouleversements produits par les conquêtes impérialistes (famines, déplacements de populations, nouvelles régulations du foncier, d’accès à la terre, du droit du commerce…) entraînèrent des migrations : musulmans du Gujerat ou hindous des autres États de l’Inde vers les colonies françaises de l’océan Indien – Madagascar et La Réunion – ou anglaises – Maurice, Afrique du Sud, Kenya. Enfin, 50 millions d’Européens partirent construire des « pays peuplés d’hommes blancs », comme l’Australie, l’Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande ou les États-Unis. Face à ces mouvements massifs, à cette réorganisation de la main-d’œuvre à l’échelle mondiale, de nouvelles formes de racialisation se firent jour. De nouveaux régimes de contrôle aux frontières, de nouvelles représentations de l’immigré désirable ou indésirable, de peuples civilisés et de peuples barbares, et une conception de la souveraineté nationale s’appuyant sur un discours de régénération et de purification reconfigurèrent la « ligne de couleur ». Chaque empire mit en place ses propres politiques mais, comme au temps de l’esclavage colonial, il y eut des circulations entre colonies et entre empires. Ces derniers surmontèrent leurs rivalités pour faciliter les déplacements de main-d’œuvre. En ce qui concerne l’Empire français, un exemple suffit : l’accord signé avec l’Empire britannique pour « engager » des travailleurs dans le sous-continent indien afin de remplacer les affranchis dans les plantations de canne à sucre de ses colonies – Guyane, Guadeloupe, Martinique et La Réunion. Entre 1830 et 1933 (date du dernier convoi d’engagés à La Réunion), des milliers de femmes et d’hommes du sous-continent indien, mais aussi du Mozambique, de Madagascar ou de Chine, furent dispersés dans toutes les colonies françaises du Pacifique, de l’océan Indien et des Caraïbes. D’anciens bateaux négriers furent aménagés pour ce transport qui s’effectua dans des conditions effroyables, avec un taux de mortalité élevé et de nombreux viols de femmes. Beaucoup d’engagés avaient signé sans comprendre ce qui les attendait, certains furent emmenés contre leur gré. Arrivés aux colonies, ils furent dépouillés de leurs biens et leurs conditions de vie et de travail y furent proches de celles des esclaves. La hiérarchie racialisée des droits se renouvela ; les droits des ouvriers de la métropole ne furent pas accordés à ceux des colonies, où s’appliqua une stricte hiérarchie de couleur et de statut. Les nouveaux régimes d’exclusion avaient pour but de « protéger » les ouvriers de la nation et de les gagner progressivement aux politiques impérialistes. Le syndicalisme fut alors traversé par l’idéologie impérialiste et, selon l’historien Jonathan Hyslop, une « classe ouvrière impériale » naquit, dont l’idéologie fut celle d’un « syndicalisme blanc » [cité in Lake et Reynolds, 2008]. Ces politiques, qu’elles aient été le fait des États ou de mouvements sociaux, étaient défensives, en réaction à « la mobilité géographique et à la mobilisation des peuples colonisés et de couleur » [W.E.B. Du Bois, cité in Lake et Reynolds, 2008]. Dans son remarquable ouvrage, Memories of Empire vol I. The White Man’s World, Bill Schwarz part lui aussi de ce constat : les sociétés coloniales ayant été traversées par la race, leurs métropoles l’ont inévitablement été aussi [Schwarz, 2011, p. 9]. Nier la racialisation de la société française, ou insister sur le fait que les discriminations ont aussi touché des groupes dits « blancs » (émigrés italiens, polonais, espagnols…), contribue à marginaliser le rôle de la colonie dans la fabrication de l’identité française et l’existence de sa couleur fantasmée.
Un discours a cependant fini par s’imposer dans les consciences, qui a fait de la France un pays se vivant comme ouvert et accueillant aux non-Blancs, tout en mettant en œuvre des politiques racialistes. L’historien William B. Cohen a clairement formulé le paradoxe : « L’aisance apparente avec laquelle Noirs et Blancs se mêlaient socialement à Paris donnait l’impression que la société française était égalitaire et exempte de tout racisme. Les Français proclamaient depuis la Révolution des théories égalitaires dont ils croyaient sincèrement avoir respecté l’esprit dans leur propre comportement. De leur côté, les étrangers témoins de la façon dont, à Paris, on acceptait les Noirs dans les années 1920 et dans les années 1930 corroborèrent l’idée qu’en France les préjugés de couleur n’existaient pas. Il n’en reste pas moins que les Français n’avaient pratiqué de politique égalitaire ni dans leurs colonies des Antilles ni, après 1850, dans leurs possessions africaines. Semblables aux autres Européens, ils avaient entretenu pendant des siècles un jugement défavorable à l’égard des peuples noirs » [Cohen, 1981, p. 395 ; voir aussi Mbokolo, s. d.]. Ce paradoxe entre politiques racialistes et perception de soi comme Français étranger au racisme, entre contenu d’un récit national universel et réalités sociales, économiques et culturelles discriminatoires, a une longue histoire qui, je l’ai indiqué rapidement, trouve son origine dans l’esclavagisme. Les solidarités produites par ce paradoxe contiennent leurs propres limites, clairement énoncées par Aimé Césaire dans sa lettre de démission au Parti communiste français où il interpellait toute la gauche pour la mettre en garde contre son paternalisme et son fraternalisme [Césaire, 1956]. Pour que ces solidarités soient à la hauteur de leur projet – créer des mouvements au-delà des appartenances culturelles et nationales – une décolonisation du récit national apparaît nécessaire. D’un point de vue concret, n’oublions pas que l’inégalité entre métropole et anciennes colonies a perduré même après que ces dernières sont devenues des départements français en 1946 (le taux du salaire minimum et des allocations atteignit la parité seulement à la fin des années 1990).
La fin des empires coloniaux, les nouvelles émergences, les nouvelles formes de mondialisation n’ont pas mis fin à l’organisation racialisée et sexuée du monde du travail, ni à la présence de la « ligne de couleur » qui traverse le monde de la consommation et celui de la production. Cependant, malgré cette cartographie de la couleur, des solidarités transnationales et transcontinentales ont vu le jour, l’antiesclavagisme et l’anticolonialisme en sont des témoignages. L’exploitation n’a pas toujours eu une couleur. Cette couleur est fragile. Il faut la réinvestir régulièrement et la nourrir de fantasmes, de représentations, de discours qui désignent le coupable de ses propres angoisses, de ses propres peurs, un coupable qui permet de les incarner.
En France, la coupure entre territoire où le racisme n’aurait jamais existé – la métropole – et territoire où il aurait existé – la colonie – est le résultat d’un effort conscient pour faire de la métropole une terre d’égalité, de liberté et de fraternité qui a eu besoin pour se construire d’externaliser son côté sombre, de le « déporter » aux colonies. En projetant sur les « non-Blancs » la menace dont ils se sentaient les cibles, les « Blancs » ont cherché à se distinguer de ceux dont ils étaient le plus proches par leur situation sociale. Or une grande partie de l’histoire de la France s’est déroulée « outre-mer ». L’amnésie collective ou le désir illusoire de séparer l’histoire nationale de cette « autre » histoire, longue de plusieurs siècles, a conduit depuis l’« invention de la décolonisation », en 1962, à réécrire le récit national en se limitant au domaine hexagonal [Shepard, 2008]. Dans cette réinvention, dans cette reconstruction fantasmatique, le « racisme anti-Blancs » est une tentative dérisoire de retrouver un monde, largement fantasmé, où vivaient des hommes blancs libres et égaux et où régnaient l’ordre et l’harmonie. Or c’est en retrouvant l’histoire des luttes et des solidarités transcontinentales, des histoires croisées entre peuples, que ces récits et cette peur disparaîtront peu à peu.