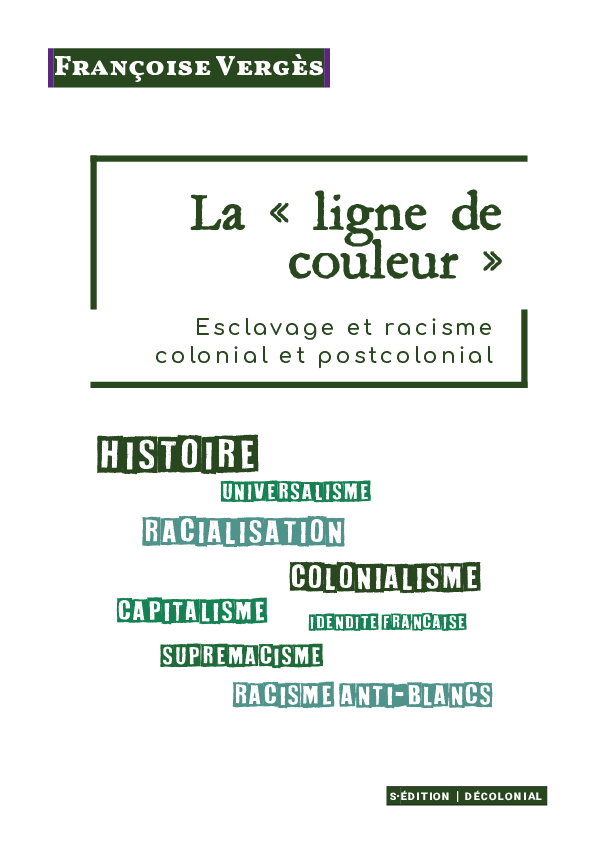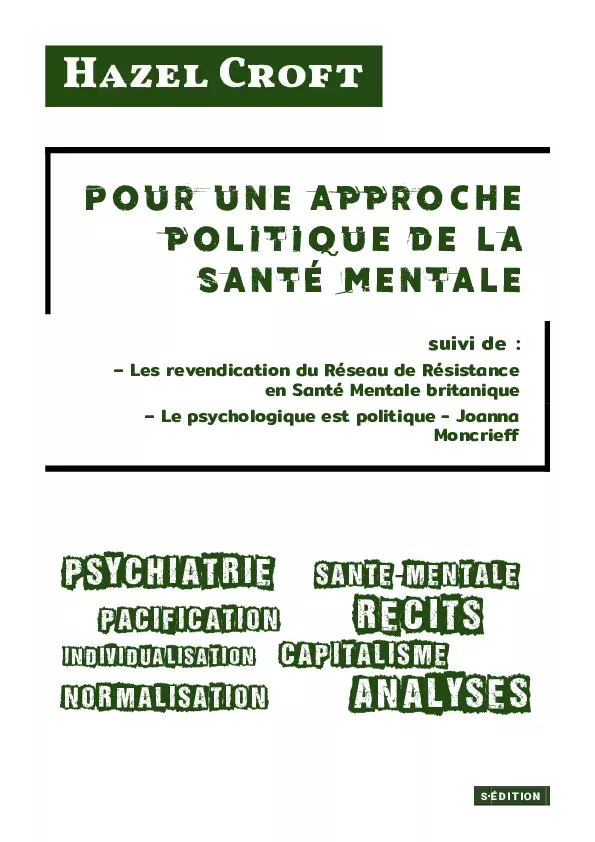Françoise Vergès — définir un camp : un féminisme décolonial
Temps de lecture : ~ 70 minutes
Ce texte constitue la premiere du livre Un féminisme décolonial, publié en 2019 aux éditions la Fabrique.
Le retournement qui fait du féminisme longtemps décrié par des idéologies de droite un de leurs fers de lance mérite d’être analysé. Qu’est-ce qui se joue dans ce déploiement idéologique ? Comment s’est opéré ce glissement ? Comment sommes-nous passées d’un féminisme ambivalent ou indifférent à la question raciale et coloniale dans le monde de langue française à un féminisme blanc et impérialiste ? De quoi le fémonationalisme est-il le nom ? Comment le féminisme est-il devenu, dans une convergence notable, un des piliers de plusieurs idéologies qui, à première vue, s’opposent – l’idéologie libérale, l’idéologie nationaliste-xénophobe, l’idéologie d’extrême droite ? Comment les droits des femmes sont-ils devenus une des cartes maîtresses de l’État et de l’impérialisme, un des derniers recours du néolibéralisme, et le fer de lance de la mission civilisatrice féministe blanche et bourgeoise ? Ce féminisme et les courants nationalistes xénophobes ne proclament pas une communauté d’objectifs mais partagent des points de convergence et ce sont ces derniers qui nous intéressent ici [1].
Cet ouvrage se situe dans la continuité des ouvrages critiques des féministes du Sud global et de leurs alliées au Nord sur le genre, le féminisme, les luttes de femmes et la critique d’un féminisme que j’appelle civilisationnel parce qu’il a entrepris la mission d’imposer au nom d’une idéologie des droits des femmes une pensée unique qui contribue à la perpétuation d’une domination de classe, de genre et de race. J’y défends un féminisme décolonial ayant pour objectif la destruction du racisme, du capitalisme et de l’impérialisme, programme auquel j’essaierai de donner une dimension concrète.
« Le féminisme va bien au-delà de l’égalité de genre et il dépasse largement la question du genre [2] », rappelle Angela Davis. Il dépasse aussi la catégorie « femmes » fondée sur un déterminisme biologique et redonne à la notion de droits des femmes une dimension de politique radicale : prendre en compte les défis posés à une humanité menacée de disparition. Je me positionne contre une temporalité qui décrit la libération seulement en termes de « victoire » unilatérale sur la réaction. Une telle perspective fait montre d’une « immense condescendance de la postérité [3] » à l’égard des vaincu•e•s. Cette écriture de l’histoire fait du récit des luttes des opprimé•e•s celui de défaites successives et impose une linéarité où tout recul est vécu comme une preuve que le combat a été mal mené (ce qui est bien sûr possible) et non comme mettant au jour la détermination des forces réactionnaires et impérialistes à écraser toute dissidence. C’est ce que les chants de lutte – negro spirituals, chants révolutionnaires, gospels, chants des esclaves, des colonisé•e•s – racontent : la longue route vers la liberté, une lutte sans trêve, la révolution comme travail quotidien. C’est dans cette temporalité que je situe le féminisme de politique décoloniale.
Se réclamer encore du féminisme
Le terme de « féministe » n’est pas toujours facile à porter. Les trahisons du féminisme occidental constituent un repoussoir, au même titre que son âpre désir d’intégrer le monde capitaliste et d’avoir sa place dans le monde des hommes prédateurs, que son obsession autour de la sexualité des hommes racisés et de la victimisation des femmes racisées. Pourquoi se dire féministe, pourquoi défendre le féminisme, quand ces termes sont tellement galvaudés que même l’extrême droite peut se les approprier ? Que faire quand, alors qu’il y a dix ans les mots « féministe » et « féminisme » portaient encore un potentiel radical et étaient jetés comme des insultes, ils font désormais partie de l’arsenal de la droite néolibérale modernisatrice ? Quand, en France, une ministre peut organiser une « Université du féminisme » où le public majoritairement féminin et se disant féministe hue une jeune femme voilée mais laisse un homme leur faire la leçon pendant 25 mn (des protestations sont sagement apparues sur Twitter [4]) ? De quel féminisme est-il question quand il devient une entreprise de pacification ? Si féminisme et féministes sont au service du capital, de l’État et de l’Empire, est-il encore possible de leur redonner le souffle d’un mouvement qui porte les objectifs de justice sociale, de dignité, de respect, de politiques de la vie contre les politiques de la mort ? Mais ne faut-il pas aussi défendre le féminisme devant les assauts de forces fascisantes ? Quand le viol et le meurtre sont devenus des armes maîtresses pour discipliner les femmes ? Quand même être une femme blonde, mère de famille, mariée à un homme, professeure à l’université, conforme à toutes les normes de la respectabilité de la classe moyenne blanche aux États-Unis, ne protège pas contre un déchaînement de haine comme on a pu le voir avec l’audition de Christine Blasey Ford lors des débats sur la nomination de Brett Kavanaugh à la Cour suprême ? Ou que des gouvernements à travers le monde font du féminisme une idéologie antinationale, étrangère à « la culture de la nation », pour mieux réprimer les femmes ? Longtemps je ne me suis pas dite féministe, je me disais militante anticoloniale et antiraciste dans les mouvements de libération des femmes. J’ai été amenée à me dire féministe, d’une part en raison de l’émergence d’un féminisme de politique décolonial large, transnational, pluriel, d’autre part du fait de la captation des luttes de femmes par le féminisme civilisationnel.
Une trajectoire anticoloniale
La biographie n’explique pas tout, et assez souvent d’ailleurs pas grand-chose, mais je me dois dans un livre sur le féminisme de dire quelque chose de ma propre trajectoire – non qu’elle soit exemplaire, mais parce que les luttes des femmes y ont joué un grand rôle. J’ai été pendant plusieurs années militante dans des groupes du MLF ; ces luttes ont toujours été liées à des projets de libération plus générale – en l’occurrence, dans mon expérience, la libération du colonialisme français post-1962. Le socle sur lequel se sont bâtis mon intérêt, ma curiosité et mon engagement pour les luttes émancipatrices réside dans l’éducation politique et culturelle dont j’ai bénéficié à l’île de La Réunion. Pour la petite fille que j’étais, élevée dans un contexte où l’école, les médias, les activités culturelles étaient toutes soumises à l’ordre colonial français post-1962, cette expérience fut exceptionnellement transnationale. Longtemps, je ne me suis pas dite militante féministe, mais « militante de la libération des femmes ». J’ai eu le privilège de grandir dans une famille de communistes féministes et anticolonialistes, d’être entourée de militant•e•s de toute origine, genre et classe sociale qui m’ont éclairée sur ce que sont la lutte et la solidarité, la joie et la gaîté associées à la lutte collective. À la forme d’idéalisme qui ne supportait pas la défaite et qui était la mienne adolescente, la réponse de mes parents me ramenait sur terre : « Ce sont des brutes, des fascistes, des crapules, il ne faut rien en attendre. Ils ne respectent aucun droit, en premier le droit à notre existence. » Rien de défaitiste dans ces remarques, mais plutôt une leçon sur une autre temporalité des luttes : les images de la prise du Palais d’hiver, de l’entrée des troupes de Castro à La Havane, des troupes de l’ALN dans Alger étaient de formidables images à même de mobiliser l’imagination, mais à s’y arrêter on risquait de vivre des lendemains qui déchantent. Demain la lutte continuerait. J’ai aussi appris très tôt que si l’État veut écraser un mouvement, il a recours à tous les moyens, à toutes les ressources qui sont à sa disposition d’une part pour réprimer, d’autre part pour diviser les opprimé•e•s. D’une main il frappe, de l’autre il cherche à assimiler. La peur est une de ses armes favorites pour produire conformisme et consentement. J’ai rapidement compris le prix à payer pour se permettre d’échapper à l’injonction : « Ne te fais pas remarquer, ne proteste pas trop, et tu n’auras pas d’ennui. » L’ordonnance Debré en 1960 en a fait la démonstration : en frappant d’exil treize militants anticolonialistes, dont des dirigeants syndicaux, le message était clair, toute voix dissidente serait punie [5]. L’historien réunionnais Prosper Ève a parlé de L’Île à peur pour analyser comment l’esclavagisme, le postesclavagisme puis le postcolonial ont, jusqu’aux années 1960, diffusé la peur comme technique de discipline [6]. La peur n’est certes pas exclusive au dispositif colonial, mais rappelons que l’esclavage colonial était fondé sur la constante menace de la torture et de la mort d’un être humain transformé légalement en objet, et du spectacle public de sa mise à mort. J’ai également appris qu’il faut utiliser les lois de l’État contre lui mais sans illusion ni idéalisme, comme l’avaient compris les femmes esclaves qui se battaient pour faire reconnaître par la loi le statut de libre qu’elles transmettaient à leurs enfants [7], ou encore les colonisé•e•s qui retournaient contre l’État colonial ses propres lois (liberté de la presse, liberté d’association, droit de vote…). Cette stratégie n’était jamais la seule, elle s’accompagnait toujours d’une critique de l’État et de ses institutions. Les luttes se jouent sur de multiples terrains et pour des objectifs visant différentes temporalités. L’existence d’un vaste monde où résistances et refus de la soumission s’opposent à un ordre mondial injuste a fait partie de la compréhension du monde qui m’a été transmise. Je n’ai donc pas découvert en arrivant en France ou en allant à l’université que capitalisme, racisme, sexisme et impérialisme sont des compagnons de route et je n’ai pas rencontré le féminisme anticolonial et antiraciste en lisant Simone de Beauvoir : il a fait partie de mon environnement dès la petite enfance.
La fausse innocence du féminisme blanc
À la suite de Frantz Fanon, qui écrivait : « l’Europe est littéralement la création du Tiers-Monde » car elle s’est construite sur le pillage des richesses du monde et que dès lors « la richesse des pays impérialistes est aussi notre richesse » [8], je peux dire que la France est littéralement une création de son empire colonial, et le Nord une création du Sud. Je reste donc étonnée par l’entêtement à oublier l’esclavage, le colonialisme et les « outre-mer » dans l’analyse de la France actuelle et de la politique des gouvernements successifs depuis les années 1950. Plus encore que l’empire colonial, les « outre-mer » ne font pas partie de l’histoire contemporaine : aucun texte sur les questions politiques, qu’elles soient abordées de manière philosophique, économique, ou sociologique, ne s’intéresse à ces survivances de l’empire colonial français. Il y a là quelque chose qui relève d’une volonté d’effacer ces peuples et leurs pays de l’analyse des conflits, des contradictions et des résistances. Quel est le but d’un tel refoulement, si ce n’est de maintenir l’idée que tout cela – esclavage, colonialisme, impérialisme – est certes arrivé mais toujours à l’extérieur de ce qui constitue la France ? On minore ainsi les liens entre capitalisme et racisme, entre sexisme et racisme, et on préserve une innocence française. Ainsi, le féminisme français se pare de retenue face à l’héritage colonial et esclavagiste. C’est à croire que, dès lors que les femmes seraient victimes de la domination masculine, elles n’auraient aucune responsabilité à l’égard des politiques menées par l’État français.
Le féminisme comme lutte pour le droit d’exister
Se dire féministe décoloniale, défendre les féminismes de politique décoloniale aujourd’hui, ce n’est pas seulement arracher le mot « féminisme » aux mains avides de la réaction, en peine d’idéologies, mais c’est aussi affirmer notre fidélité aux luttes des femmes du Sud global qui nous ont précédées. C’est reconnaître leurs sacrifices, honorer leurs vies dans toutes leurs complexités, les risques qu’elles ont pris, les hésitations et découragements qu’elles ont connus, c’est recevoir leurs héritages. D’autre part, c’est reconnaître que l’offensive contre les femmes désormais justifiée et revendiquée publiquement par des dirigeants d’État n’est pas tout simplement l’expression d’une domination masculiniste décomplexée, mais une manifestation de la violence destructrice engendrée par le capitalisme. Le féminisme décolonial, c’est dépatriarcaliser les luttes révolutionnaires. En d’autres termes, les féminismes de politique décoloniale contribuent à la lutte entreprise depuis des siècles par une partie de l’humanité pour affirmer son droit à l’existence.
Les féminismes de politique décoloniale [9]
Un des faits marquants de ce début du xxie siècle, et qui s’affirme depuis plusieurs années, est le mouvement de féminismes de politique décoloniale dans le monde. Ce courant a développé une multitude de pratiques, d’expériences et de théories ; les plus encourageants et originaux sont des mouvements de terrain qui abordent les questions de manière transversale et intersectionnelle. Ce mouvement provoque sans surprise une réaction violente des hétéropatriarches, de féministes du Nord et de gouvernements. C’est dans le Sud global que ce mouvement s’est développé, réactivant la mémoire des luttes féministes précédentes, jamais perdues parce que jamais abandonnées, malgré de terribles assauts à son encontre. Rejointes par des féministes en Espagne, en France, ou aux États-Unis, les mouvements qui le composent déclarent la guerre au racisme et au sexisme, au capitalisme et à l’impérialisme lors d’immenses manifestations en Argentine, en Inde, au Mexique, en Palestine. Ses militantes dénoncent le viol et le féminicide, et lient ce combat aux luttes contre les politiques de dépossession, contre la colonisation, l’extractivisme et la destruction systématique du vivant. Ce n’est ni une « nouvelle vague » ni une « nouvelle génération », selon les formules favorites qui masquent les vies multiples des mouvements des femmes, mais une nouvelle étape dans le processus de décolonisation, dont nous savons qu’il est un long processus historique. Ces deux formules – vague et génération – contribuent à effacer le long travail souterrain qui permet à des traditions oubliées de renaître et occultent le fait même que ces courants aient été ensevelis ; cette métaphore confie en outre une responsabilité historique à un phénomène mécanique (« vague ») ou démographique (« génération »). Les féminismes de politique décoloniale rejettent ces formules qui segmentent car ils s’appuient sur la longue histoire des luttes de leurs aînées, femmes autochtones pendant la colonisation, femmes réduites en esclavage, femmes noires, femmes dans les luttes de libération nationale et de l’internationalisme subalterne féministe dans les années 1950-1970, et femmes racisées qui luttent quotidiennement aujourd’hui.
Les mouvements féministes de politique décoloniale font face, avec les autres mouvements décoloniaux et tous les mouvements d’émancipation, à une période d’accélération du capitalisme qui régule désormais le fonctionnement des démocraties. Ils doivent trouver des alternatives à l’absolutisme économique, à la fabrication infinie de marchandises. Nos luttes constituent une menace pour les régimes autoritaires qui accompagnent l’absolutisme économique du capitalisme. Elles menacent aussi la domination masculiniste, effrayée de devoir renoncer à son pouvoir – et qui, partout, montre sa proximité avec les forces fascisantes. Elles ébranlent également le féminisme civilisationnel qui, ayant fait des droits des femmes une idéologie de l’assimilation et de l’intégration à l’ordre néolibéral, réduit les aspirations révolutionnaires des femmes à la demande de partage 50/50 des privilèges accordés aux hommes blancs par la suprématie blanche. Complices actives de l’ordre capitaliste racial, les féministes civilisationnelles n’hésitent pas à apporter leur soutien à des politiques d’intervention impérialistes, à des politiques islamophobes ou encore négrophobes.
Les enjeux sont énormes et le danger terrible. Il s’agit de s’opposer au nationalisme autoritaire et au néofascisme, pour qui les féministes racisées sont des ennemies à abattre. Et la démocratie occidentale ne prétendra plus nous protéger lorsque les intérêts du capitalisme seront réellement menacés. L’absolutisme capitaliste voit d’un bon œil tous les régimes qui lui permettent d’imposer ses règles et ses méthodes, lui ouvre les espaces qui ne sont pas encore colonisés, lui accorde l’accès à la propriété de l’eau, de l’air, de la terre.
- La montée des réactionnaires de tous poils montre bel et bien une chose
- un féminisme qui ne se bat que pour l’égalité de genre, qui refuse de voir combien l’intégration laisse les femmes racisées à la merci de la brutalité, de la violence, du viol et du meurtre, en est finalement complice. Telle est la leçon à tirer de l’élection à la présidence du Brésil, en octobre 2018, d’un homme blanc soutenu par les grands propriétaires terriens, le monde des affaires et les Églises évangéliques, un homme qui a ouvertement déclaré sa misogynie, son homophobie, sa négrophobie, son mépris des peuples autochtones, sa volonté de vendre le Brésil au plus offrant, de piétiner les lois sociales pour les classes les plus pauvres et celles de protection de la nature, de revenir sur les accords signés avec les peuples amérindiens, et tout cela quelques mois après l’assassinat de l’élue queer et noire Marielle Franco. Une simple approche en termes d’égalité de genre montre ses limites dès lors que des partis de droite autoritaire et d’extrême droite élisent des femmes à leur tête ou les choisissent comme égéries – Sarah Palin, Marine Le Pen, Giorgia Meloni…
Critique des épistémicides
Dans le magnifique film de Fernando Solanas, L’Heure des brasiers (1968), la phrase suivante apparaît à l’écran : « Le prix que nous payons pour être humanisé•e•s » (The price we pay to be humanized). En effet, le prix à payer a été lourd et continue à être lourd. Le système contre lequel nous luttons a renvoyé à l’inexistence des savoirs scientifiques, des esthétiques et des catégories entières d’êtres humains. Ce monde européen n’a jamais réussi à être hégémonique mais il s’est approprié sans hésitation et sans honte savoirs, esthétiques, techniques et philosophies de peuples qu’il asservissait et dont il niait la civilisation. Notre combat se situe résolument contre la politique du vol justifié, légitimée et pratiquée sous les auspices encore vivaces d’une mission civilisatrice. Sans nier les complexités et contradictions des siècles de colonialisme européen, ou ce qui a échappé à ses techniques de surveillance, sans occulter non plus les techniques d’emprunt ou de détournement utilisées par les colonisé•e•s, une connaissance approfondie des échanges (culturels, techniques et scientifiques) Sud-Sud manque encore, en grande partie à cause des politiques de financement de la recherche. C’est une lutte pour la justice épistémique, autrement dit celle qui réclame l’égalité entre les savoirs et conteste l’ordre du savoir imposé par l’Occident. Les féminismes de politique décoloniale s’inscrivent dans le long mouvement de réappropriation scientifique et philosophique qui révise le récit européen du monde. Ils contestent l’économie-idéologie du manque, cette idéologie occidentale-patriarcale qui a fait des femmes, des Noir•e•s, des peuples autochtones, des peuples d’Asie et d’Afrique des êtres inférieurs marqués par l’absence de raison, de beauté, ou d’un esprit naturellement apte à la découverte scientifique et technique. Cette idéologie a fourni son fondement aux politiques de développement qui disent en substance : « Vous êtes sous-développés mais vous pouvez être développés si vous adoptez nos technologies, nos manières de résoudre les problèmes sociaux et économiques. Vous devez imiter nos démocraties, le meilleur des systèmes, car vous ne savez pas ce qu’est la liberté, le respect des lois, la séparation des pouvoirs. » Cette idéologie nourrit le féminisme civilisationnel qui, à son tour, dit en substance : « Vous n’avez pas la liberté, vous ne connaissez pas vos droits. Nous allons vous aider à atteindre le niveau de développement adéquat. » Le travail de redécouverte et de valorisation des savoirs, des philosophies, des littératures, des imaginaires ne commence pas avec nous mais une de nos missions est de faire l’effort de les connaître et de les diffuser. Les militantes féministes savent combien la transmission des luttes est susceptible d’être rompue ; elles font souvent face à l’ignorance des luttes et des résistances, entendent souvent « nos parents ont baissé la tête, ils se sont laissé faire ». L’histoire des luttes féministes est pleine de trous, d’approximations, de généralités. Les féminismes de politique décoloniale et des universitaires féministes racisées ont compris la nécessité de développer leurs propres outils de transmission et de savoir : à travers des blogs, des films, des expositions, des festivals, des rencontres, des ouvrages, des pièces de théâtre, de la danse, des chants, de la musique, elles font circuler des récits, des textes, traduisent, publient, filment, font connaître des figures historiques, des mouvements. C’est un mouvement à accentuer, notamment en faisant l’effort de traduire des textes féministes venant du continent africain, d’Europe, des Caraïbes, d’Amérique du Sud et d’Asie en plusieurs langues.
Qu’est-ce que la colonialité ?
Parmi les axes de lutte d’un féminisme décolonial, il faut tout d’abord souligner le combat contre la violence policière et la militarisation accélérée de la société, sous-tendue par une idée de la protection confiant à l’armée, à la justice de classe/raciale et à la police le soin de l’accomplir. Cela implique de rejeter le féminisme carcéral et punitif qui se satisfait d’une approche judiciaire des violences, sans interroger la mort des femmes et des hommes racisé•e•s puisque « naturelle », considérée comme un fait de culture, un accident, une triste occurrence dans nos démocraties. Il faut s’efforcer de dénoncer la violence systémique contre les femmes et les transgenres, mais sans opposer les victimes les unes aux autres ; analyser la production des corps racisés sans oublier la violence qui vise les transgenres et les travailleur•se•s du sexe ; dénationaliser et décoloniser le récit du féminisme blanc bourgeois sans occulter les réseaux féministes antiracistes internationalistes ; être attentif aux politiques d’appropriation culturelle, et se méfier de l’attrait des institutions de pouvoir pour la « diversité ». Nous ne devons pas sous-estimer la rapidité avec laquelle le capital se montre capable d’absorber des notions pour en faire des slogans vidés de leur contenu : pourquoi le capital ne serait-il pas capable d’incorporer l’idée de décolonisation, de décolonialité ? Le capital est colonisateur, la colonie lui est consubstantielle, et pour comprendre comment elle perdure il faut se libérer d’une approche qui voit exclusivement dans la colonie la forme que lui a donnée l’Europe au xixe siècle et ne pas confondre colonisation et colonialisme. La distinction que fait Peter Ekeh est ici utile : la colonisation est un événement/période, le colonialisme un processus/mouvement, un mouvement social total dont la perpétuation s’explique par la persistance des formations sociales issues de ces séquences [10]. Les féministes décoloniales étudient la manière dont le complexe racisme/sexisme/ethnicisme imprègne toutes les relations de domination, alors même que des régimes qui étaient associées à ce phénomène ont disparu. La notion de colonialité est extrêmement importante pour analyser la France contemporaine à l’heure où tant et tant, même à gauche, continuent de croire que c’en est fini du colonialisme. Selon ce récit, la décolonisation aurait tout simplement mis un point final au colonialisme. Or, outre que la république continue d’avoir la mainmise sur des territoires sous dépendance, les institutions de pouvoir restent structurées par le racisme. Pour les féminismes de politique décoloniale en France, l’analyse de la colonialité républicaine française reste centrale. C’est une colonialité qui a en héritage le partage du monde que l’Europe a tracé au xvie siècle et qu’elle n’a eu de cesse de réaffirmer en utilisant le glaive, la plume, la foi, le fouet, la torture, la menace, la loi, le texte, la peinture puis la photographie et le cinéma. C’est une colonialité qui institue une politique de vies jetables, humans as waste. On ne saurait toutefois limiter notre propos à l’espace-temps du récit européen. L’histoire des décolonisations est aussi celle de la longue durée des luttes ayant bousculé l’ordre du monde. Dès le xvie siècle, les peuples ont combattu la colonisation occidentale (les luttes des peuples autochtones et des Africain•e•s réduit•e•s en esclavage, la Révolution haïtienne). D’autre part, effacer les transferts et itinéraires Sud-Sud des libérations, occulter les expériences internationalistes des forces anticoloniales, donne à penser que la décolonisation n’aurait été qu’une indépendance dans la loi, et même un leurre. L’ignorance de la circulation Sud-Sud de personnes, d’idées et de pratiques émancipatrices préserve l’hégémonie de l’axe Nord-Sud ; or les échanges Sud-Sud ont été cruciaux pour la diffusion de rêves de libération. Ces relectures en termes d’espace-temps sont essentielles pour stimuler l’imagination des féminismes de politique décoloniale.
Contre l’eurocentrisme
Pour donner toute l’ampleur nécessaire à notre critique, il faut aller jusqu’à dire que le féminisme civilisationnel naît avec la colonie, dans la mesure où les féministes européennes élaborent un discours sur leur oppression en se comparant aux esclaves. La métaphore de l’esclavage est puissante, car les femmes ne sont-elles pas la propriété de leur père et de leur mari ? Ne sont-elles pas soumises aux lois sexistes de l’Église et de l’État ? Le féminisme de l’Europe des Lumières ne reconnaît pas les femmes qui participent à la Révolution haïtienne (laquelle sera célébrée par les poètes romantiques) ni les femmes esclaves qui se révoltent, marronnent, résistent. La question ici n’est pas d’émettre un jugement rétrospectif mais de se demander pourquoi, au regard de cet aveuglement, de cette indifférence, il n’y a toujours pas eu de retour critique sur la généalogie du féminisme européen. Réécrire l’histoire du féminisme en partant de la colonie représente un enjeu central pour le féminisme décolonial. On ne peut se contenter d’envisager la colonie comme un enjeu annexe de l’histoire. Il s’agit de considérer que, sans la colonie, nous n’aurions pas une France aux institutions structurellement racistes. Pour les femmes racisées au Nord et dans le Sud global, toutes les facettes de leurs vies, les risques auxquels elles s’exposent, le prix qu’elles paient du fait de la misogynie, du sexisme et du patriarcat sont encore à étudier et à visibiliser. Lutter contre le fémi-impérialisme, c’est faire resurgir du silence les vies des femmes « anonymes », refuser le processus de pacification et analyser pourquoi et comment les droits des femmes sont devenus une arme idéologique au service du néolibéralisme (qui peut tout à fait soutenir ailleurs un régime misogyne, homophobe et raciste). Quand les droits des femmes se résument à la défense de la liberté – « être libre de, avoir le droit de… » – sans questionner le contenu de cette liberté, sans s’interroger sur la généalogie de cette notion dans la modernité européenne, on est en droit de se demander si tous ces droits ne sont pas octroyés parce que d’autres femmes ne sont pas libres. Le récit du féminisme civilisationnel reste contenu dans l’espace de la modernité européenne et ne prend jamais en compte le fait qu’il se fonde sur le déni du rôle de l’esclavage et du colonialisme dans sa propre formation. La solution n’est pas de donner une place, forcément marginale, aux femmes esclaves, colonisées ou aux femmes racisées et des outre-mer. Ce qui est à l’ordre du jour, c’est la façon dont la division du monde qu’esclavage et colonialisme opèrent dès le xvie siècle (entre une humanité qui a le droit de vivre et celle qui peut mourir) traverse les féminismes occidentaux. Si le féminisme reste fondé sur la division entre femmes et hommes (une division qui précède l’esclavage), mais qu’il n’analyse pas comment esclavage, colonialisme et impérialisme agissent sur cette division – ni comment l’Europe impose sa conception de la division femmes/hommes aux peuples qu’elle colonise ou comment ceux-ci créent d’autres divisions –, ce féminisme est alors raciste. L’Europe demeure son centre, toutes ses analyses partent de cette partie du monde : les racines coloniales du fascisme sont oubliées ; le capitalisme racial n’est pas une catégorie d’analyse ; les femmes esclaves et colonisées ne sont pas perçues comme constituant le miroir négatif des femmes européennes. Rares ont été les féministes européennes qui ont été résolument antiracistes et anticolonialistes. Il y a eu évidemment des exceptions, des journalistes, des avocates, des militantes qui ont proclamé leur solidarité avec les colonisé•e•s, mais cela n’a pas constitué le fondement du féminisme français – pourtant redevable des luttes antiracistes. Même le soutien aux nationalistes algérien•ne•s qui a été si important pour des féministes françaises n’a pas entraîné une analyse du « choc en retour » dont parle admirablement Aimé Césaire dans Discours sur le colonialisme : la colonisation travaille à déciviliser le colonisateur. Parler de féminisme civilisationnel, ou blanc bourgeois, a, dans cette perspective, un sens bien précis. Il n’est pas « blanc » tout bêtement parce que des femmes blanches l’adoptent mais parce qu’il se réclame d’une partie du monde, l’Europe, celle qui s’est construite sur un partage racisé du monde. Il est bourgeois parce qu’il n’attaque pas le capitalisme racial. On est en droit de poser cette question : comment et pourquoi le féminisme aurait-il échappé à ce que des siècles de domination et de suprématie blanches ont diffusé ? Comme on confond trop souvent racisme et extrême droite, pogroms et ghettos en Europe, on ne mesure pas à quel point le racisme s’est aussi répandu et propagé sans bruit et sans fureur, à travers la naturalisation de l’état de servitude racisée et l’idée que des civilisations auraient été incompatibles avec le progrès et les droits des femmes. Sauver les femmes racisées de « l’obscurantisme » reste un des grands principes des féministes civilisationnelles. Elles en ont fait une politique visant les femmes des colonies et, dans leur pays, les femmes racisées et les femmes des classes populaires. On ne peut nier que pour certaines ces actions trouvent leur fondement dans une volonté de bien faire, qu’elles sont animées par de bons sentiments et le souhait d’améliorer la situation des femmes, ni que des colonisé•e•s ont su tirer avantage de ces actions ; mais il y a une différence entre aide et critique radicale du colonialisme et du capitalisme, entre aide et combat contre l’exploitation et l’injustice. Ou, pour citer la militante autochtone australienne Lilla Watson : « Si vous êtes venus pour m’aider, vous perdez votre temps. Mais si vous êtes venus parce que votre libération est liée à la mienne, alors travaillons ensemble [11]. »
Pour une pédagogie décoloniale critique
Les théories et pratiques forgées au sein des luttes antiracistes, anticapitalistes et anticoloniales constituent des sources inestimables. Les féminismes de politique décoloniale apportent aux luttes qui partagent l’objectif de réhumaniser le monde leur bibliothèque de savoirs, leur expérience de pratiques, leurs théories antiracistes et antisexistes associées sans relâche aux luttes anticapitalistes et anti-impérialistes. Une féministe ne peut prétendre posséder « la » théorie et « la » méthode, elle cherche à être transversale. Elle se pose la question de ce qu’elle ne voit pas, elle cherche à déconstruire l’étau de l’éducation scolaire qui lui a appris à ne plus voir, ne plus sentir, à étouffer ses sens, à ne plus savoir lire, à être divisée à l’intérieur d’elle-même et à être séparée du monde. Elle doit réapprendre à entendre, voir, sentir pour pouvoir penser. Elle sait que la lutte est collective, elle sait que la détermination des ennemi•e•s à abattre les luttes de libération ne doit pas être sous-estimée, qu’ils utiliseront toutes les armes à leur disposition, la censure, la diffamation, la menace, l’emprisonnement, la torture, le meurtre. Elle sait aussi que la lutte est porteuse de difficultés, de tensions, de frustrations mais également de joie et de gaîté, de découvertes et d’élargissement du monde.
- C’est un féminisme qui fait une analyse multidimensionnelle de
- l’oppression et refuse de découper race, sexualité et classe en
- catégories qui s’excluraient mutuellement. La multidimensionnalité,
- notion proposée par Darren Lenard Hutchinson, répond aux limites de la
- notion d’intersectionnalité, afin de mieux comprendre comment le «
- pouvoir raciste et hétéronormatif crée non seulement des exclusions
- précises à l’intersection des dominations, mais façonne toutes les
- propositions sociales et les subjectivités, y compris parmi ceux qui
- sont privilégiés [12] ». Cette notion fait écho au « féminisme de la
- totalité », une analyse qui entend prendre en compte la totalité des
- rapports sociaux [13]. Je partage l’importance donnée à l’État et
- j’adhère à un féminisme qui pense ensemble patriarcat, État et capital,
- justice reproductive, justice environnementale et critique de
- l’industrie pharmaceutique, droit des migrant•e•s, des réfugié•e•s et
- fin du féminicide, lutte contre l’Anthropocène-Capitalocène racial et
- criminalisation de la solidarité. Il ne s’agit pas de relier des
- éléments de manière systématique et finalement abstraite, mais de faire
- l’effort de voir si des liens existent et lesquels. Une approche
- multidimensionnelle permet d’éviter une hiérarchisation des luttes
- fondée sur une échelle de l’urgence dont le cadre reste souvent dicté
- par des préjugés. Tenir plusieurs fils à la fois pour surmonter la
- segmentation induite par l’idéologie et « saisir comment s’articulent
- historiquement production et reproduction sociale [14] », voilà
- l’enjeu. C’est cette approche qui m’a guidée dans mon analyse des
- milliers d’avortements et stérilisations sans consentement perpétrés
- annuellement à l’île de La Réunion dans les années 1970, car si je
- m’étais arrêtée à l’explication qui rendait pour seuls responsables de
- ce crime les médecins blancs et français qui y procédaient, je l’aurais
- réduite à une histoire de cupidité chez quelques hommes blancs alors
- qu’une étude de la totalité des éléments a mis en lumière une politique
- étatique française nataliste en France et antinataliste pour les femmes
- racisées et pauvres dans ses départements « d’outre-mer », politique qui
- s’inscrivait dans une reconfiguration globale des politiques
- occidentales de contrôle des naissances dans un contexte de luttes de
- libération nationale et de Guerre froide [15]. De même, dans une
- présentation [16] de pédagogie décoloniale critique, j’utilise un
- fruit familier, la banane, pour éclairer un certain nombre d’analogies
- et d’affinités électives : sa dispersion de la Nouvelle-Guinée au reste
- du monde, banane et esclavage, banane et impérialisme US (banana
- republics), banane et agrobusiness (pesticides, insecticides – le
- scandale du chlordécone aux Antilles), banane et conditions de travail
- (régime plantationnaire, violence sexuelle, répression), banane et
- environnement (monoculture, eau polluée, terres polluées), banane et
- sexualité, banane et musique, banane et spectacle (Josephine Baker),
- banane et branding (Banana Republic), banane et racisme (à partir de
- quand banane et négrophobie sont-elle associées ?), banane et science
- (recherche de la banane « parfaite »), banane et consommation (faire
- entrer la banane dans les foyers, suggérer des recettes), banane et
- rituels aux ancêtres, banane et art contemporain. La méthode est simple
- partir d’un élément pour mettre au jour un écosystème politique, économique, culturel et social afin d’éviter la segmentation que la méthode occidentale des sciences sociales a imposée. Les analyses les plus éclairantes et productives ont d’ailleurs été ces dernières décennies celles qui ont tiré le plus grand nombre de fils pour mettre en lumière les réseaux d’oppression concrets et subjectifs qui tissent la toile de l’exploitation et des discriminations.
Le féminisme décolonial comme imaginaire utopique
Dans le contexte d’un capitalisme à la puissance destructrice redoublée, d’un racisme et d’un sexisme meurtriers, cet ouvrage affirme que oui, le féminisme que j’appelle féminisme de politique décoloniale est à défendre, développer, affirmer et mettre en pratique. Le féminisme de marronnage offre au féminisme décolonial un ancrage historique dans les luttes de résistance à la traite et à l’esclavage. J’appelle ici marronnage et marron•ne•s toutes les initiatives, toutes les actions, tous les gestes, les chants, les rituels qui la nuit ou le jour, cachés ou visibles, représentent une promesse radicale. Le marronnage affirmait la possibilité d’un futur quand ce dernier était forclos par la loi, l’Église, l’État, la culture qui proclamaient qu’il n’y avait pas d’alternative à l’esclavage, que celui-ci était aussi naturel que le jour et la nuit, que l’exclusion des Noir•e•s de l’humanité était chose naturelle. Les marron•ne•s firent apparaître l’aspect fictif de cette naturalisation et en brisant les codes elles/ils ont opéré une rupture radicale qui a déchiré le voile du mensonge. Elles/ils ont dessiné des territoires souverains au cœur même du système esclavagiste et ont proclamé leur liberté. Leurs rêves, leurs espoirs, leurs utopies, comme les raisons de leurs défaites, demeurent des espaces où puiser une pensée de l’action. Dès lors, il est une utopie, au sens de promesse radicale, qui est un terrain contre le capitalisme proclamant lui aussi qu’il n’y a pas d’alternative à son économie et à son idéologie, qu’il est aussi naturel que le jour et la nuit, et promettant même des solutions technologiques et scientifiques qui transformeront ses ruines en espaces de bonheur. Contre ces idéologies, le marronnage comme politique de la désobéissance affirme qu’il existe la possibilité d’une « futurité » (futurity), pour emprunter la notion aux féministes noires américaines. En s’affirmant marron, le féminisme s’ancre dans cette remise en question de la naturalisation de l’oppression, en se disant décolonial, il combat la colonialité du pouvoir. Mais s’inscrire dans le champ du féminisme est-il la réponse adaptée à la montée d’une fascisation politique, à la prédation capitaliste et à la destruction des conditions écologiques nécessaires aux êtres vivants, aux politiques de dépossession, de colonisation, d’effacement et de marchandisation, à la criminalisation et à la prison comme réponses à l’augmentation de la pauvreté ? Cela a-t-il un sens de disputer du terrain au féminisme civilisationnel, appelé aussi mainstream ou blanc bourgeois, qui pense corriger les injustices en partageant les postes entre femmes et hommes sur la base d’un 50/50 sans questionner l’organisation sociale, économique et culturelle et qui entend faire du genre, de la sexualité, de la classe, des origines, de la religion, une affaire entièrement privée ou une marchandise ? Combattre le fémonationisme et le fémi-impérialisme (j’en développe les contenus plus loin) sont aussi des arguments pour défendre le féminisme décolonial. Mais cela ne suffit pas. L’argument essentialiste d’une nature féminine qui serait plus à même de respecter la vie et de désirer une société juste et égalitaire ne tient pas, les femmes ne constituent ni spontanément ni en elles-mêmes une catégorie politique. Ce qui justifie une réappropriation du terme « féminisme », de ses théories et pratiques s’ancre dans la conscience d’une expérience profonde, concrète, quotidienne d’une oppression produite par la matrice État, patriarcat et capital, qui fabrique la catégorie « femmes » pour légitimer des politiques de reproduction et d’assignation toutes deux racialisées.
Les féminismes de politique décoloniale n’ont pas pour but d’améliorer le système existant mais de combattre toutes les formes d’oppression : la justice pour les femmes signifie la justice pour tous. Il n’entretient pas des espérances naïves, ne se nourrit pas du ressentiment ni de l’amertume ; nous savons que le chemin est long et parsemé d’embûches mais nous gardons en mémoire le courage et la résilience des femmes racisées à travers l’histoire. Il ne s’agit donc pas d’une nouvelle vague du féminisme, mais de la poursuite des luttes d’émancipation des femmes du Sud global.
Les féminismes de politique décoloniale puisent dans les théories et pratiques que des femmes ont forgées sur le temps long au sein des luttes antiracistes, anticapitalistes et anticoloniales – participant à élargir les théories de libération et d’émancipation à travers le monde. Il s’agit de combattre fermement la violence policière et la militarisation accélérée de la société comme la conception de la sécurité qui confie à l’armée, à la justice de classe/raciale et à la police le soin de l’assurer. Cela consiste en un rejet du féminisme carcéral et punitif.
Dans cette cartographie des luttes des femmes du Sud, l’esclavage colonial garde à mes yeux un rôle fondateur. Il constitue la « matrice de la race », pour reprendre l’expression si juste de la philosophe Elsa Dorlin, et relie l’histoire de l’accumulation des richesses, de l’économie plantationnaire et du viol (fondement d’une politique de la reproduction dans la colonie) à l’histoire de la destruction systématique des liens sociaux et familiaux et au nœud race/classe/genre/sexualité. La temporalité esclavage/abolition renvoie l’esclavage colonial à un passé historique et, dès lors, ignore comment ses stratégies de racialisation et de sexualisation continuent à porter leurs ombres sur notre temps. L’immense apport de l’afro-féminisme (Brésil, États-Unis) sur l’importance de l’esclavage colonial dans la formation du monde moderne et l’invention du monde blanc, de son rôle dans l’interdiction des liens familiaux, n’a pourtant toujours pas affecté les analyses du féminisme blanc bourgeois. Des féministes en Occident ont certes analysé comment se construit la « bonne maternité », la « bonne mère » et le « bon père » de la famille hétéronormée, mais sans jamais prendre en compte le « choc en retour » de l’esclavage et du colonialisme. On sait que sous l’esclavage on pouvait à tout moment arracher les enfants à leurs mères, qu’elles n’étaient pas autorisées à les défendre, que les femmes noires étaient à la disposition des enfants de leurs propriétaires comme nourrices, que leurs enfants étaient à la disposition des enfants du maître comme compagnes ou compagnons de jeux, que petites filles et femmes noires étaient exploitées sexuellement, et que tous ces rôles étaient soumis aux caprices du maître, de son épouse et de ses enfants. Les hommes étaient privés du rôle social de père et de compagnon. Cette destruction de liens familiaux qui était établie par la loi continue à porter son ombre sur les politiques familiales visant les minorités racisées et les peuples autochtones.
Femmes blanches et femmes du Sud global
On le sait, les femmes blanches n’aiment pas qu’on leur dise qu’elles sont blanches. Être blanc a été construit comme étant si ordinaire, si dénué de caractéristiques, si normal, si dépourvu de sens que, comme le signale Gloria Wekker dans White Innocence. Paradoxes of Colonialism and Race [17], il est pratiquement impossible de faire reconnaître à une Blanche qu’elle est blanche. Vous le lui dites, et elle est bouleversée, agressive, horrifiée, pratiquement en larmes. Elle trouve votre remarque « raciste ». Pour Fatima El Tayeb, dire que la pensée européenne moderne a donné naissance à la race représente une violation insupportable de ce qui est cher aux Européen•ne•s, l’idée d’un continent « color-blind », dépourvu de l’idéologie dévastatrice qu’il a exporté à travers le monde entier [18]. Le sentiment d’être innocente est au cœur de cette incapacité à se voir comme blanche et donc de se protéger de toute responsabilité dans l’ordre du monde actuel. Et il ne pourrait dès lors y avoir de féminisme blanc (puisqu’il n’y a pas de Blanches), mais un féminisme universel. L’idéologie des droits des femmes que le féminisme civilisationnel promeut ne saurait être raciste puisqu’elle émane d’un continent exempt de tout racisme. Avant de poursuivre, il convient de répéter – puisque toute référence à l’existence de la blancheur entraîne une accusation de « racisme à l’envers » – qu’il ne s’agit pas de couleur de peau, ni de tout racialiser, mais de faire admettre que la longue histoire de la racialisation en Europe (à travers l’antisémitisme, l’invention de la « race noire », de la « race asiatique », ou de « l’Orient ») n’a pas été sans conséquences sur la conception de l’humain, de la sexualité, des droits naturels, de la beauté et de la laideur… Admettre être blanche, c’est-à-dire admettre que des privilèges ont été historiquement accordés à cette couleur – privilèges qui peuvent être aussi banals que de pouvoir entrer dans un magasin sans être automatiquement soupçonnée de vouloir y voler, de ne pas avoir à s’entendre dire systématiquement que l’appartement que l’on souhaite est déjà loué, d’être naturellement prise pour l’avocate et non son assistante, pour le médecin et non l’aide-soignante, pour l’actrice et non la femme de ménage… –, serait déjà faire un grand pas. Il est admis que des femmes blanches ont su être réellement solidaires des luttes de l’antiracisme politique. Mais les femmes blanches doivent aussi comprendre la fatigue ressentie quand il faut toujours les éduquer sur leur propre histoire. Pourtant, une large bibliothèque sur ces thèmes est disponible. Qu’est-ce qui les retient ? Pourquoi attendent-elles d’être éduquées ? Certaines disent que nous oublions la classe, que le racisme a été inventé pour diviser la classe ouvrière, que nous favorisons paradoxalement l’extrême droite en parlant de « race ». C’est toujours aux racisées d’expliquer, de justifier, d’accumuler les faits, les chiffres alors que faits et chiffres, ni sens moral, ne changent quoi que ce soit au rapport de force. Reni Edo Lodge exprime un sentiment familier et légitime quand elle explique : « Pourquoi je ne veux plus parler de race avec les Blancs ». Prétendre que le débat sur le racisme peut se dérouler comme si les deux parties étaient à égalité est illusoire, écrit-elle, et ce n’est pas à celles et ceux qui n’ont jamais été victimes de racisme d’imposer le cadre de la discussion [19].
La femme blanche a littéralement été une production de la colonie. Dans La Matrice de la race, la philosophe Elsa Dorlin explique comment, aux Amériques, les premiers naturalistes ont pris modèle sur la différence sexuelle pour élaborer le concept de « race » : les Indiens aux Caraïbes ou les esclaves déportés seraient des populations au tempérament pathogène, efféminé et faible. On passe, écrit Dorlin, de la définition d’un « tempérament de sexe » à celle d’un « tempérament de race ». Le modèle féminin de la « mère », blanche, saine et maternelle, opposé aux figures d’une féminité « dégénérée » – la sorcière, l’esclave africaine –, donne corps à la Nation, conclut la philosophe [20]. Les femmes européennes n’échappent pas à la division épistémologique qui s’opère au xvie siècle et réduit à la « non-existence » une somme considérable de connaissances [21]. À leurs yeux, les femmes du Sud sont privées de savoirs, d’une réelle conception de la liberté, de ce qui fait famille ou de ce qui constitue être « une femme » (qui ne serait pas nécessairement lié au genre ou au sexe définis à la naissance). Se percevant comme victimes des hommes (et de fait elles sont restées mineures dans la loi pendant des siècles), elles ne voient pas que leur désir d’égalité avec ces hommes repose sur l’exclusion de femmes et d’hommes racisé•e•s et que la conception européenne du monde, de la modernité dans laquelle elles s’inscrivent, renvoie femmes et hommes qui n’appartiennent ni à leur classe ni à leur race à une inégalité de fait et de droit. En faisant de leur expérience, souvent celle de femmes de la classe bourgeoise, un universel, elles contribuent à la division du monde en deux : civilisés/barbares, femmes/hommes, Blancs/Noirs, et la conception binaire du genre devient un universel. Maria Lugones a ainsi parlé de « colonialité du genre » : l’expérience historique des femmes colonisées n’est pas seulement celle d’une minoration raciale, écrit-elle, mais aussi celle d’une assignation sexuelle. Les femmes colonisées sont réinventées comme « femmes » à partir des normes, des critères et des pratiques discriminatoires expérimentés dans l’Europe médiévale [22]. Les femmes racialisées ont dès lors fait face à un double assujettissement : celui des colonisateurs et celui des hommes colonisés. La philosophe féministe nigériane Oyèrónkẹ Oyěwùmí remet elle aussi en question l’universalisme des formulations euro-modernes du genre. Elle y voit la manifestation de l’hégémonie du biologisme occidental et de la domination de l’idéologie euro-nord américaine dans la théorie féministe [23].
Le féminisme et le refoulé de l’esclavage
En établissant une analogie entre leur situation et celle des esclaves, les féministes européennes dénoncent une situation de dépendance, un statut de mineure à vie mais elles enlèvent à l’esclavage des éléments essentiels qui font de cette analogie une usurpation : capture, déportation, vente, trafic, torture, déni des liens sociaux et familiaux, viol, épuisement, racisme, sexisme et mort encadrent la vie des femmes esclaves. Ce n’est pas nier la brutalité de la domination masculine en Europe que de faire cette distinction avec l’esclavage. Le siècle des Lumières, celui de la publication de textes féministes historiques pour le continent européen, est aussi celui du pic de la traite transatlantique (70 000 à 90 000 Africain•e•s déporté•e•s par an, alors que jusqu’au xviie siècle, le chiffre est de 30 000 à 40 000 par an). Les féministes françaises antiesclavagistes (peu nombreuses) du xviiie siècle s’appuient sur une vision sentimentaliste, sur une littérature de la pitié, pour dénoncer le crime esclavagiste [24]. Une des œuvres les plus célèbres de ce genre, la pièce d’Olympe de Gouges Zamore et Mirza, donne à une Blanche le rôle principal : c’est elle qui permet l’émancipation des Noir•e•s de l’esclavage. Appelée, après les corrections exigées en 1785 par la Comédie-Française, L’Esclavage des Nègres, ou l’Heureux Naufrage, la pièce conte l’histoire de deux jeunes esclaves marrons en fuite et réfugiés sur une île déserte. Zamore, qui a tué un commandeur, est recherché. Il sauve de la noyade un jeune couple de Français, dont Sophie, fille du gouverneur Saint-Frémont. Cette dernière aide alors Zamore et Mirza à échapper à leur statut de servitude et le gouverneur affranchit les esclaves de sa plantation à la fin de la pièce. Sans la femme blanche, pas de liberté. Signalons que même cette tentative timide par son ton et son contenu fit malgré tout scandale. La pièce fut jugée subversive, car l’auteure laissait entrevoir « une liberté générale [qui] rendrait les hommes nègres aussi essentiels que les blancs » et qu’ils seraient un jour « les cultivateurs libres de leurs contrées, comme les laboureurs en Europe, [qu’] ils ne quitter[aient] point leurs champs pour aller chez les nations étrangères [25] ». Ce récit où l’intervention des Blancs change le destin des esclaves noir•e•s, où les Noir•e•s méritant la liberté doivent présenter des qualités de douceur, de sacrifice et de soumission, a été hégémonique. Les textes qui le mirent en question ont consisté en des témoignages directs d’anciens captifs et d’anciens esclaves. Dans Paul et Virginie, un des ouvrages les plus lus au xviiie siècle, Bernardin de Saint-Pierre adoucit la nature des relations entre blancs et Noirs. Un des épisodes les plus stupéfiants du roman met en scène une jeune femme esclave qui, s’étant enfuie car maltraitée par son maître, se présente un dimanche matin devant la maison de Virginie. Cette dernière la recueille et lui donne à manger avant de la persuader de retourner chez son maître pour lui demander pardon de s’être enfuie. La jeune esclave est ramenée par la douce Virginie à son maître qui, évidemment, la punit. La niaiserie de Virginie n’est que le fruit de son innocence entêtée à refuser de voir le racisme. Elle fait de l’esclavage une simple relation individuelle où la violence peut être réparée par le pardon du maître. Les témoignages qu’ont pu laisser des femmes esclaves contredit absolument cette niaiserie aux conséquences brutales mais que la femme blanche refuse de voir. Au xixe siècle, la plupart des féministes, à quelques rares exceptions comme Louise Michel ou Flora Tristan, soutiennent l’empire colonial dans lequel elles voient un levier pour sortir les femmes colonisées des fers du sexisme de leurs sociétés. Elles ne renient pas la mission civilisatrice mais veulent s’assurer que son versant féminin sera respecté. Elles créent des écoles pour les filles, encouragent les métiers de service et de domesticité, protestent contre des abus, mais n’attaquent jamais la colonisation elle-même. Elles en acceptent la structure et les institutions, trouvant dans la colonie la possibilité de déployer principes et valeurs de leur féminisme, celui qui adhère à l’ordre républicain colonial. Face à l’hostilité de colons, elles subliment leurs actions. L’étude des journaux de voyageuses, des rapports de féministes peut dès lors faire oublier que la conquête coloniale est la base de leur action, que c’est grâce aux armées coloniales que des routes de voyage sont ouvertes et que des lieux où des Européennes peuvent vivre sont construits.
Dans le récit hégémonique des luttes pour les droits des femmes, un oubli met particulièrement au jour le refus de considérer les privilèges que donne la blanchité. Ce récit met en scène des femmes privées de droits qui les obtiennent progressivement, jusqu’à bénéficier de celui qui est l’emblème des démocraties européennes, le droit de vote. Or, si sur une longue période les femmes blanches n’ont effectivement pas pu jouir de nombreux droits civiques associés, elles ont eu celui de posséder des êtres humains ; elles ont possédé des esclaves et des plantations puis, à la suite de l’abolition de l’esclavage, ont été à la tête de plantations coloniales où sévissait le travail forcé [26]. L’accès à la propriété d’êtres humains ne leur était pas refusé et ce droit leur a été accordé parce qu’elles étaient blanches. Une des plus grandes esclavagistes à l’île de La Réunion fut une femme, Madame Desbassyns, qui n’avait ni le droit de vote, ni de passer le baccalauréat, ni d’être avocat, ni médecin ou professeur à l’université, mais avait celui de posséder des êtres humains, classés comme « meubles » dans son patrimoine. Aussi longtemps que l’histoire des droits des femmes sera écrite sans tenir compte de ce privilège, elle sera mensongère.
Ignorant la place des femmes esclaves, marronnes, travailleuses engagées et colonisées dans les luttes pour la liberté et l’égalité raciale, le féminisme blanc établit le seul cadre des luttes de femmes. Cette lutte s’apparente à l’égalité avec les hommes blancs bourgeois et n’a de place qu’en France. La surdité, l’aveuglement à l’égard des ressorts réels des « droits des femmes », à l’égard du rôle du colonialisme et de l’impérialisme dans leur conception ne pouvaient que nourrir une idéologie féministe ouvertement nationaliste, inégalitaire et islamophobe où le terme « français » en vient à recouvrir non pas un espace de langue comme outil commun, mais l’espace du national/impérial.
De quel genre est-il alors question sous l’esclavage ? Les femmes réduites en esclavage sont noires et femmes mais dans les plantations, tous les êtres humains esclavagisés sont des bêtes de somme. Aux yeux des esclavagistes, les femmes noires sont des objets sexuels et non des êtres dont le genre demanderait qu’elles soient traitées avec douceur et respect. Esclaves, elles ont le statut légal d’objets, donc n’appartenant pas à la pleine humanité. Autrement dit, le genre n’existe pas en soi, il est une catégorie historique et culturelle, qui évolue dans le temps et ne peut être conçu de la même manière dans la métropole et la colonie, ni d’une colonie à l’autre ou à l’intérieur d’une colonie. Pour les femmes racisées, affirmer ce qui constitue pour elles être femme a été un terrain de lutte. Les femmes, je l’ai dit, ne constituent pas une classe politique en soi.
L’exceptionnalisme français : la République de l’innocence
En France, où la doctrine républicaine se heurte aux impensés du passé colonial et aux défis du présent postcolonial, le féminisme est venu à la rescousse en identifiant féminisme à république. Peu importe que les femmes n’aient obtenu les droits les plus élémentaires que très tardivement sous la république, cette dernière sera dite de nature ouverte aux différences. S’efface dans ce récit le fait que ces droits ont été obtenus au prix de luttes. Est aussi oublié que, alors que les femmes françaises obtiennent le droit de vote en 1944, ce droit sera durement entravé dans les départements dits d’outre-mer et ce jusqu’aux années 1980. Toutes les femmes qui vivent dans l’espace de la République française ne bénéficient pas automatiquement des droits accordés aux femmes françaises blanches. Ce ne sont pas seulement les femmes bourgeoises qui sont racistes. En 1976, le bulletin de femmes militantes révolutionnaires en usine signale le racisme anti-Arabe d’ouvrières de Renault-Flins mais l’explique « en partie par l’attitude réactionnaire des Arabes [sic] vis-à-vis des femmes [mais qui viennent aussi] des préjugés intoxiqués par la bourgeoisie et qui choquent leurs principes : ils sont les premiers logés par les mairies. Ils ne veulent pas sortir de leur taudis, ils sont sales, s’ils retournaient dans leur pays il y aurait moins de chômage en France [27] ».
Aujourd’hui encore, l’accès aux soins prénataux et postnataux n’est pas également distribué ; les femmes racisées sont plus facilement privées de l’accès aux soins et elles sont plus souvent victimes de l’indifférence des services médicaux – sinon de maltraitance. La mort en mai 2017 de Naomi Musenga, une jeune femme de 27 ans dont les appels aux services d’urgence non seulement sont restés sans réponse mais ont été l’objet de moqueries, a remis en lumière ces discriminations racistes. Aucune institution ne semble échapper au racisme structurel : ni l’école, ni le tribunal, ni la prison, ni l’hôpital, ni l’armée, ni l’art, ni la culture ou la police. Si le débat sur le racisme structurel en France est si difficile, c’est aussi à cause d’une passion pour les principes abstraits plutôt que pour l’étude des réalités. Malgré les rapports, même ceux émanant d’organismes gouvernementaux prouvant les discriminations racistes/sexistes, l’aveuglement persiste.
- Un autre frein à la déracialisation de la société française est le
- narcissisme entretenu à propos de sa singularité, de son
- exceptionnalisme. La langue française est même présentée au xxie siècle
- comme un vecteur de la mission civilisatrice (féministe) car elle
- porterait en elle l’idée de l’égalité femmes/hommes. C’est un tel
- raisonnement qui justifie la priorité donnée aux jeunes femmes
- africaines dans l’obtention des bourses d’études gouvernementales
- [28]. La langue n’est pourtant pas neutre et le racisme s’y est
- insinué. L’histoire des mots qui commencent par « N » au féminin et au
- masculin, et qui sont des insultes racistes, est ici éclairante. À la
- fin du xviiie siècle, « N » a entièrement pris le sens d’« esclave noir
- », et N et noir sont utilisés de manière indifférenciée. Une question
- légitime se pose alors : par quel miracle le vocabulaire du féminisme
- aurait-il été préservé du racisme ? Prenons l’exemple d’Hubertine
- Auclert, une des grandes figures du féminisme républicain français du
- xixe siècle, connue pour sa lutte infatigable pour l’obtention du droit
- de vote des femmes, contre le code Napoléon qui avait fait de la femme
- une mineure et une personne soumise à son mari, et contre la peine de
- mort. Secrétaire du journal L’Avenir des femmes, elle fait sienne la
- formule de Victor Hugo, « Les femmes : celles que j’appelle des esclaves
- », étudie le rôle des femmes dans les révolutions et dénonce «
- l’esclavage des femmes [29] ». Laurence Klejman et Florence Rochefort,
- auteures d’un ouvrage sur le féminisme français en 1989, résument ainsi
- son combat : « Elle puise toute sa formation politique dans le féminisme
- et, impatiente, elle se révolte contre ses aînés qui se contentent d’une
- revendication de principe ou carrément refusent la prise en compte du
- vote des femmes en raison du danger que représenterait cette réforme
- pour le régime. Elle choisit la provocation comme tactique. Astucieuse,
- imaginative, elle affirme d’emblée une identité politique par divers
- actes de désobéissance civile : l’inscription sur les listes
- électorales, la grève de l’impôt, le refus du recensement au prétexte
- que si les Françaises ne votent pas, elles ne doivent pas non plus payer
- ou être comptées [30]. » En 1881, elle fonde son propre journal, La
- Citoyenne, où elle démontre que les principes de la république sont
- bafoués, considère le 14 juillet comme une fête de la masculinité et le
- Code Napoléon comme une survivance de la monarchie. Pour Auclert, une
- ligne de partage existe, la ligne de couleur. Dans son texte « Les
- femmes sont les nègres [sic] », elle proteste contre le fait que le
- droit de vote ait été accordé aux hommes noirs dans les colonies après
- l’abolition de l’esclavage en 1848 : « Le pas donné aux nègres sauvages,
- sur les blanches cultivées de la métropole, est une injure faite à la
- race blanche. » Le droit de vote se colore sous la plume de la féministe
- « Alors que les nègres votent, pourquoi les blanches ne votent-elles pas ? » « En nos possessions lointaines », poursuit-elle, « on fait voter un grand nombre de noirs, qui ne sont intéressés ni à nos idées, ni à nos affaires ; cependant que l’on refuse aux femmes éclairées de la métropole le bulletin de vote, qui les empêcherait d’être broyées dans l’engrenage social. » La coloration du droit de vote révèle la force du préjugé raciste chez cette féministe : « Cette mise en parallèle de “nègres” à moitié sauvages, sans charges ni obligations, votant, et de femmes civilisées, contribuables et point électeurs, démontre surabondamment, que les hommes ne conservent leur omnipotence en face des femmes, qu’afin d’exploiter ces déshéritées. » Il faut donc « empêcher les Français de traiter en nègres les Françaises [31] ». Opposer obscurantisme et lumières, c’est reprendre la vieille opposition entre civilisations, mais c’est surtout, tout simplement, accepter la racialisation du féminisme. L’universel est bien difficile à tenir. Les femmes dans le colonialisme français
Frantz Fanon décrit par ces mots le rôle que le colonialisme du xxe siècle donne aux femmes : « À un premier niveau, il y a une reprise pure et simple de la fameuse formule : “Ayons les femmes, le reste suivra”. » Il poursuit :
L’administration coloniale peut alors définir une doctrine politique précise : « Si nous voulons frapper la société algérienne dans sa contexture, dans ses facultés de résistance, il nous faut d’abord conquérir les femmes ; il faut que nous allions les chercher derrière le voile où elles se dissimulent et dans les maisons où l’homme les cache ». C’est la situation de la femme indigène qui sera alors prise comme thème d’action. L’administration dominante veut défendre solennellement la femme humiliée, mise à l’écart, cloîtrée… On décrit les possibilités immenses de la femme, malheureusement transformée par l’homme algérien en objet inerte, démonétisé, voire déshumanisé. Le comportement de l’Algérien est dénoncé très fermement et assimilé à des survivances moyenâgeuses et barbares. Avec une science infinie, la mise en place d’un réquisitoire type contre l’Algérien sadique et vampire dans son attitude avec les femmes, est entreprise et menée à bien. L’occupant amasse autour de la vie familiale de l’Algérien tout un ensemble de jugements, d’appréciations, de considérants, multiplie les anecdotes et les exemples édifiants, tentant ainsi d’enfermer l’Algérien dans un cercle de culpabilité [32].
Cette idéologie nourrit le féminisme civilisationnel du xxie siècle – représentations négrophobes et orientalistes, idées préconçues sur « la » famille orientale ou africaine, sur la mère et le père dans ces familles. La réalité sociale n’a pas de place dans cette idéologie, car il faudrait alors analyser la catastrophe humaine et économique que les politiques républicaines ont engendrée dans les colonies [33]. Les tentatives de dévoilement des femmes algériennes par l’armée française, la représentation des combattantes algériennes comme victimes (soit de l’armée, soit de leurs frères combattants, mais jamais comme êtres faisant librement un choix), l’indifférence à la manière dont la colonialité républicaine opprime les femmes des outre-mer et les femmes racisées en France, le refus de dénoncer le capitalisme, la foi dans la modernité européenne constituent le terrain sur lequel le féminisme civilisationnel s’est développé et a obtenu l’attention des puissants.
La peur qu’a provoquée la participation des femmes dans les mouvements de libération nationale entraîne une mobilisation d’institutions internationales, de fondations et d’idéologues qui forgent des discours et développent des pratiques, jusqu’au recours à la répression. C’est ainsi que se sont diffusées les notions de développement et de women’s empowerment, ainsi que le discours sur « les droits des femmes ». Ce dernier, qui émerge comme technique féministe de discipline à la fin des années 1980, et est contemporain du discours sur la « fin de l’histoire » et la « fin des idéologies », va être propulsé par plusieurs événements au cours de la fin du xxe siècle et le début du xxie.
Le féminisme développementaliste
Dès les années 1970, des institutions internationales et des fondations nord-américaines s’agitent pour canaliser et orienter les mouvements féministes. C’est une décennie qui voit entrer des centaines de millions de femmes dans le monde du travail salarié. Les transformations du capitalisme sont une occasion décisive pour provoquer une explosion de bas salaires et la précarité, notamment par la féminisation à l’échelle mondiale des emplois sous-qualifiés dans les zones d’ouverture économique et dans l’économie informelle. Durant cette décennie, les progrès observés dans la féminisation des emplois vont de concert avec une augmentation très claire des inégalités dans le monde. Le conflit entre une approche révolutionnaire de la libération des femmes et une approche antidiscrimination qui vise des réformes dans la loi et l’intégration des femmes dans le capitalisme gagne alors en intensité. La première ne rejette pas la lutte pour des réformes mais dénonce l’argument qui fait de l’entrée des femmes dans le monde du travail salarié une opportunité de gain en autonomie individuelle et prône l’organisation collective sur le lieu de travail. Pour la seconde, l’indépendance se mesure en capacité d’accès à la consommation et à l’autonomie individuelle (l’image de la femme corporate, la mode des vestes à épaulettes qui l’accompagne…). Finalement, la décennie 1970 est aussi celle du déploiement mondial des politiques antinatalistes qui visent les femmes du tiers-monde. Les États-Unis prennent le leadership en la matière en soutenant financièrement des politiques de contrôle des naissances chez leurs communautés racisées et en Amérique du Sud. Dans un document longtemps resté confidentiel, l’agence de sécurité nationale (National Security) expose clairement les raisons de cette politique – trop de jeunes voudront émigrer, menaçant ainsi la sécurité du monde libre – qu’elle conseille de confier à l’agence fédérale [34]. En France, stérilisation et avortements dans les départements « d’outre-mer » sont encouragés par le gouvernement [35].
Ce ne sont pourtant pas les États-Unis, ni son gouvernement, ni son mouvement féministe mainstream qui portent la question des droits des femmes sur le plan international mais l’Union soviétique et les pays du tiers-monde qui proposent au début des années 1970 que les Nations unies organisent une « décennie de la femme ». Celle-ci, lancée en 1975, a pour but d’« assurer aux femmes l’accès à la propriété privée et le contrôle de leurs biens, ainsi que l’amélioration des droits des femmes en matière d’héritage, de garde d’enfants et de nationalité », d’affirmer que « le droit des femmes est partie intégrante des droits humains », de « promouvoir l’égalité des sexes et de mettre fin à la violence à l’égard des femmes [36] ». Mais ces objectifs bien modestes vont bientôt être écartés au profit d’une promotion de l’entrée des femmes dans l’ordre néolibéral. Pourtant, les gouvernements des USA se méfient au départ de cette initiative – c’est toujours le contrôle des naissances dans le tiers-monde qui les mobilisent. Ce n’est qu’en 1979, sous le président Carter, que le gouvernement étasunien annonce que « l’objectif principal de la politique étrangère des États-Unis est de faire avancer dans le monde le statut et la condition des femmes [37] ». En France, la création d’un secrétariat d’État chargé des Droits des femmes en 1974 signale que l’institutionnalisation du féminisme est devenue un objectif. Les droits des femmes doivent peu à peu être vidés de leur portée politique. Les choses ne se passent cependant pas exactement comme prévu lors des quatre grandes rencontres de cette décennie – Mexico (1975), Copenhague (1980), Nairobi (1985) et Pékin (1995) [38]. Les gouvernements encouragent la collecte d’informations sur les femmes dans le monde – c’est le début d’un formidable mouvement d’accumulation de chiffres, de rapports, de constitution d’expertes en droits des femmes. À Copenhague, face aux féministes occidentales qui insistent sur la dénonciation de la clitoridectomie, l’infibulation des organes génitaux et d’autres violations des droits humains, des féministes des pays arabes et de l’Afrique subsaharienne dénoncent les qualificatifs « coutumes de sauvages » ou « cultures arriérées » comme dénotant leur volonté d’occidentaliser les luttes de femmes. À Nairobi, la question de la Palestine fait apparaître ouvertement une opposition entre un féminisme décolonial et un féminisme qui ne veut pas se confronter à la colonialité, mais la question des discriminations finit par occuper le devant de la scène. À Pékin, c’est le retour à l’ordre. Le forum alternatif où se pressent des milliers de femmes est situé loin du centre-ville, ses équipements sont en outre totalement inadéquats, alors que pour la rencontre officielle tout est mis en place pour en faire une assemblée de dignitaires. Les négociations gouvernementales se tiennent à huis clos [39]. La machine du féminisme civilisationnel se construit alors que dans le monde la situation des femmes empire. Dans le discours de clôture de cette rencontre de Pékin, Hillary Clinton déclare que les droits des femmes sont des droits humains, mais ils sont envisagés selon le plus pur récit occidental. Tandis que les mouvements d’indépendance mettaient l’accent sur la fin de l’exploitation des ressources du Sud, dénonçaient une organisation de l’information dominée par l’Occident et défendaient leur conception de la santé, de l’éducation, des droits des femmes, ces voix sont marginalisées au profit d’un discours qui ne remet pas en cause les structures du capitalisme et fait des femmes un sujet social homogène. Durant toutes ces années, les pays du tiers-monde, qui tentaient de donner aux droits des femmes un contenu décolonial, subissent de plein fouet les conséquences des programmes d’ajustement structurel. Le Fonds monétaire international et la Banque mondiale se saisissent des droits des femmes et, à la fin des années 1970, la formule women’s empowerment (capacité d’agir des femmes) est adoptée par le monde politique de la droite à la gauche, des ONG aux féministes du Nord. Pour la Banque mondiale, la capacité d’agir des femmes est le corrélat des politiques de développement et d’une politique de réduction du taux de naissance [40]. Pour les pays de l’OTAN, les droits des femmes sont assimilés à leurs valeurs nationales et intérêts nationaux [41].
Le féminisme civilisationnel des années 1980 hérite de ces cadres idéologiques, il a en fait contribué à les mettre en place, à leur donner un contenu. Les programmes d’ajustement structurel promettant développement et autonomie ont pris un visage féminin. Très vite, alors, cet alibi est mobilisé lors des campagnes impérialistes.
Si le féminisme comme mission civilisatrice n’est pas nouveau – il a servi le colonialisme –, il dispose désormais de moyens de diffusion exceptionnels : assemblées internationales, soutien d’États occidentaux et postcoloniaux, de médias féminins, de revues d’économie, d’institutions gouvernementales et internationales, subventions et soutien de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international, de fondations et d’ONG. Les institutions internationales d’aide au développement font des femmes le socle du développement dans le Sud global et bientôt affirment qu’elles sont meilleures gestionnaires que les hommes de l’argent qui leur est confié [42], qu’elles savent épargner et qu’elles respectent mieux les contraintes des programmes. Elles sont de bonnes clientes, ce sont donc les femmes qui vont changer le monde. Les femmes du Sud deviennent d’année en année les dépositaires de centaines de projets de développement – ateliers, coopératives où production de produits locaux, tissages, artisanat et couture sont valorisés. Les femmes du Nord sont encouragées à soutenir leurs « sœurs » du Sud en achetant leurs produits ou en ouvrant des boutiques pour les vendre, en se lançant dans l’organisation de programmes afin de renforcer leur autonomie, leur empowerment, ou de leur apprendre la gestion… On ne peut nier que des femmes du Sud en profitent, peuvent envoyer leurs enfants à l’école, s’extraire de la misère mais il arrive aussi que ces projets n’entraînent aucun retour, renforcent le narcissisme des femmes blanches si heureuses d’« aider » tant que cela ne bouleverse pas leurs propres vies. Pour la féministe Jules Falquet, « l’empowerment des femmes » est mis en place pour répondre à la féminisation de la pauvreté, autrement dit pour parfaire des politiques de pacification et de mise au pas [43]. Pour illustrer cette emprise du vocabulaire des ONG, je me souviens qu’en mars 2018, dans le nord-est de l’Inde, j’ai assisté à une réunion d’une centaine de femmes des tribus du Nagaland, région occupée par l’armée indienne. Ces femmes sont confrontées à la violence de l’armée et des trafiquants, aux viols, à de fort taux d’alcoolisme et de suicide chez les jeunes hommes ; elles tiennent à bout de bras leurs communautés. Pour parler de leurs actions, elles emploient cependant systématiquement le vocabulaire des ONG : empowerment, capacity building, leadership, governance [44]. Elles avaient en quelque sorte perdu leurs voix et étaient devenues dépositaires de la langue ONG. C’est à partir de la critique féministe de l’idéologie du soin que j’ai entrevu comment suggérer une critique de cette « langue ». Je leur ai fait remarquer que les ONG les condamnaient à nettoyer et à réparer sans fin les morceaux des vies brisées de leurs communautés mais sans demander des comptes aux vrais responsables. Pourquoi ne passerions-nous pas un peu de temps à comprendre qui avait cassé, et comment avaient été abîmées ces sociétés ? Qui était responsable du désespoir des jeunes ? Qui étaient responsables des viols, des arrestations arbitraires ? Ces femmes avaient les réponses à toutes ces questions mais leurs analyses étaient recouvertes par le discours dépolitisant des ONG qui, certes, devaient faire face à la censure gouvernementale, mais qui la perpétuaient en l’acceptant. En adoptant une théorie du genre qui masque les rapports de force et les choix politiques, les ONG se sont adaptés à la voie étroite que le gouvernement indien impose dans cette région. Encore une fois, il n’est pas question de faire une critique facile de ces politiques mais de continuer à étudier comment non seulement elles dépolitisent mais même contribuent parfois à de nouvelles oppressions. Il faut ajouter à une panoplie extrêmement diverse des techniques de pacification comme le girl’s power (les femmes demeurent des girls) des séries télévisées, des films… Plusieurs de ces séries, films ou articles ne sont pas sans qualité (j’en regarde volontiers) et je ne conteste pas qu’ils puissent représenter d’importants contre-modèles pour des petites filles, des jeunes femmes et des femmes, mais la diffusion massive par de nouveaux médias d’histoires individuelles perpétuent l’illusion que chacune peut accomplir son rêve si elle n’a pas peur de contester certaines normes. Ce sont des récits qui s’appuient souvent sur une psychologisation des discriminations. La lutte est rarement collective, la cruauté et la brutalité structurelles du pouvoir sont rarement montrées de manière explicite. Les héroïnes ont affaire à des individus qui outrepassent leur pouvoir mais ce qui fait structure, ce qui repose sur des mécanismes de domination et d’exploitation élaborés de longue date ayant à leur disposition police, armée, tribunal, État, est à peine effleuré. Ce qu’il faut de courage, d’effort quotidien et d’organisation collective pour faire plier ces structures n’est pas mis en lumière.
Les décennies 1970-1990 voient donc se développer des offensives dont le but est de contrer et d’affaiblir les féminismes de politique décoloniale. Le féminisme doit devenir raisonnable, ne plus être assimilé aux « pétroleuses », « hystériques », « anti-hommes », « gouines » et « mal baisées » des années 1970. L’ancrage en Europe du « vrai » féminisme et des droits des femmes est réaffirmé à plusieurs reprises, et l’hostilité aux musulman•e•s et aux migrant•e•s offre à ce féminisme l’occasion de manifester son adhésion aux valeurs européennes.
Notes
[1] Je résume plus bas l’analyse de Sara Farris sur ces points de convergence qu’elle a explorés dans In the Name of Women’s Rights. The Rise of Femonationalism, Durham, Duke University Press, 2017.
[2] Ibid., p. 124.
[3] E.P. Thompson, La formation de la classe ouvrière anglaise, Paris, Le Seuil, 2017.
[4] L’Université du féminisme organisée par Marlène Schiappa, secrétaire d’État chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes dans le gouvernement sous Emmanuel Macron, s’est tenue à Paris les 13 et 14 septembre 2018. Elle déclarait : « Notre volonté, c’était de mettre en avant la pluralité des mouvements féministes parce que le mouvement n’a jamais été monolithique, il a toujours été traversé par différents courants. Et d’avoir ce lieu de débats avec trois mots d’ordre : réflexions, opinions et actions. Le but de la grande cause du quinquennat du président Emmanuel Macron, c’est faire en sorte que ces débats traversent la société » ; des thèmes tels que « Voile et Féminisme », « Me too et après ? », « Peut-on être féministe et mère au foyer » ou « Comment atteindre l’égalité homme-femme au travail » étaient en débat. Laura Cha, porte-parole de l’association Lallab, a été huée lors de son intervention.
[5] Le 15 octobre 1960, une ordonnance dont l’objectif est de réprimer toute contestation en Algérie (qui était découpée en « départements français »), et qui a pour but d’éloigner par l’exil les fonctionnaires qui pourraient « troubler l’ordre public », est appliquée dans les départements d’outre-mer, Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion.
[6] Prosper Ève, L’île à peur. La peur redoutée ou récupérée des origines à nos jours, Saint-André de La Réunion, Océan Éditions, 1992.
- [7] Sous l’esclavage, le statut d’un enfant était transmis par la mère
- si la mère était esclave, l’enfant était esclave, si elle était libre, l’enfant était libre. Mais cette règle était loin d’être respectée par la majorité des propriétaires d’esclaves qui la contestaient par tous les moyens, en mentant, en falsifiant des papiers, en ne reconnaissant pas des émancipations. Les cas de femmes esclaves allant au tribunal et se battant contre l’arbitraire ne sont pas rares.
[8] Frantz Fanon, Les damnés de la terre, Paris, La Découverte, 2002, p. 99.
[9] J’utilise soit « un mouvement » soit « des mouvements » ou « les mouvements » pour ne pas dire « le mouvement » et ainsi signaler une pluralité de féminismes, la possibilité de formes alternatives de ces alternatives féministes, qui sont cependant tous, pour ceux qui m’intéressent, résolument antiracistes, anticapitalistes et anti-impérialistes.
[10] Cité par Sabelo J. Ndlovu-Gatsheni, Epistemic Freedom in Africa. Deprovincialisation and Decolonization, Londres, Routledge, 2018, p. 64. Le texte de Peter Ekeh date de 1983.
[11] La citation serait tirée du discours de Lilla Watson à la Conférence des Nations unies pour la « décennie des femmes » à Nairobi, en 1985. Mais Watson préfère dire que c’est le fruit [1] Je résume plus bas l’analyse de Sara Farris sur ces points de convergence qu’elle a explorés dans In the Name of Women’s Rights. The Rise of Femonationalism, Durham, Duke University Press, 2017.
[12] Michael Stambolis-Ruhstorfer, « La multidimensionnalité comme outil de lutte pour une justice raciale et sexuelle complète », in Hourya Bentouhami et Mathias Möschel, eds, Critical Race Theory. Une introduction aux grands textes fondateurs, Paris, Dalloz, 2017, pp. 309-318, p. 310.
[13] Félix Boggio Éwanjé-Épée, Stella Magliani-Belkacem, Morgane Merteuil et Frédéric Monferrand « Programme pour un féminisme de la totalité », in Titti Bhattacharya et al., Pour un féminisme de la totalité, Paris, Éditions Amsterdam, 2017, pp. 13-31, p. 18.
[14] Ibid., p. 23.
[15] Françoise Vergès, Le ventre des femmes. Capitalisme, racialisation, féminisme, Paris, Albin Michel, 2017.
[16] Présentation faite lors de conférences et d’ateliers dans des pays du Sud autour des pédagogies décoloniales. Voir l’article tiré de cette présentation : Françoise Vergès, « Bananes, esclavage et capitalisme racial », Le Journal des Laboratoires d’Aubervilliers, Cahier C, 19, 2018-2019, pp. 9-11
[17] Gloria Wekker, White Innocence. Paradoxes of Colonialism and Race, Durham, Duke University Press, 2016.
[18] Fatima El Tayeb, European Others, Durham, Duke University Press, 2011, p. xv.
[19] Reni Eddo-Lodge, Why I’m no Longer Talking to White People About Race, Londres, Bloomsbury Publishing, 2017.
[20] Elsa Dorlin, La matrice de la race. Généalogie sexuelle et coloniale de la Nation française, Paris, La Découverte, 2008.
[21] Voir à ce sujet : Boaventura de Sousa Santos, Épistémologies du Sud. Mouvements citoyens et polémique sur la science, II, Paris, Desclée de Brouwer, 2016.
[22] Maria Lugones, « Heterosexualism and the colonial modern gender system », Hypatia, 2007, 22:1, pp. 186-219, et « Colonialidad y género », Tabula Rasa, no 9, julio-dicembre, Bogotà, Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, 2008, pp. 73-101. Voir en français la présentation de cette théorie à travers la traduction par Jules Falquet du texte : « Les racines féministes et lesbiennes autonomes de la proposition décoloniale d’Abya Yala », Contretemps, avril 2017, en deux parties.
[23] Oyèrónk? Oyěwùmí, The Invention of Women. Making an African Sense of Western Gender Discourses, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1997.
[24] Sur la politique de la pitié et l’abolitionnisme français, voir Françoise Vergès, Abolir l’esclavage, une utopie coloniale. Les ambiguïtés d’une politique humanitaire, Paris : Albin Michel, 2001
[25] http://lesabolitions.culture.fr/medias/mouvements/lumieres/documents/cite-bvolympe-de-gouges.pdf
[26] Souvenons-nous du film Indochine (Régis Wargnier, 1992) : dans l’Indochine des années 1930, Éliane Devries dirige avec son père Emile une plantation d’arbres à caoutchouc. Elle a adopté Camille, une princesse annamite orpheline. Toutes les deux tombent amoureuses d’un jeune officier de la marine française, le reste est à l’avenant, la nostalgie coloniale accompagnant une version édulcorée de la lutte anticoloniale.
[27] Fanny Gallot, « Le “travail femme” quotidien de “Révo”, puis de l’OCT dans les entreprises (1973-1979) », in Ludivine Bantigny, Fanny Bugnon et Fanny Gallot, éd., « Prolétaires de tous les pays, qui lave vos chaussettes ? » Le genre de l’engagement dans les années 1968, Rennes, PUR, pp. 109-122, p. 119.
[28] Le gouvernement français actuel, tout en recourant à des arguments coloniaux sur le taux de natalité des Africaines qui serait responsable de la pauvreté du continent, leur promet l’accès à la modernité grâce à leur adoption de la langue française. Emmanuel Macron, le 8 juillet 2017, en parlant de l’Afrique : « Quand des pays ont encore aujourd’hui sept à huit enfants par femme, vous pouvez décider d’y dépenser des milliards d’euros, vous ne stabiliserez rien. »
[29] Édith Taïeb, « Hubertine Auclert : “de la République dans le ménage” à la “vraie” République ». Auclert était une féministe républicaine civilisationnelle. Dans son ouvrage Les femmes arabes en Algérie (Paris, Société d’éditions littéraires, 1900), elle prônait l’assimilation coloniale contre un colonialisme de mépris et la cruauté des fonctionnaires. Elle affirmait que les « Arabes » souhaitaient l’assimilation et que le rêve des musulmanes était d’être comme les femmes françaises (p. 24). Ce texte orientaliste rassemble les éléments du féminisme civilisationnel colonial : un peu d’ethnographie et de sociologie touristisque, des clichés sur le caractère « résigné » des Arabes, la polygamie et le « mariage arabe » qui est un « viol d’enfant » (p. 42). Pour Auclert, les femmes françaises qui étaient par leur condition proches des Arabes étaient ainsi les mieux placées pour les étudier.
[30] www.senat.fr/colloque_femmes_pouvoir. La présentation de Laurence Klejman et Florence Rochefort n’aborde pas l’attitude des féministes envers le racisme et le colonialisme, poursuivant une tradition dominante dans la recherche française : faire l’impasse sur le rôle de la colonie dans le champ du politique. Laurence Klejman et Florence Rochefort, « Le féminisme, une utopie républicaine, 1860-1914 », colloque « Femmes et pouvoirs, xixe-xxe siècle », Sénat, 2018.
[31] Hubertine Auclert, Le vote des femmes, chapitre « Les femmes sont les nègres », Paris, V. Giard & E. Brière éditeurs, 1908, pp. 196-198.
[32] Frantz Fanon, « L’Algérie se dévoile », in Œuvres, L’An V de la Révolution algérienne, op. cit., p. 275
[33] En 1945, devant l’Assemblée constituante, Aimé Césaire fera un tableau très critique des siècles de colonisation française : pas d’écoles, taux de mortalité élevée, économie aux mains de quelques-uns… En 1954, en Algérie, 10 % de la population, dont une grande majorité de colons, détient 90 % des richesses du pays ; pour 200 000 enfants européens, on compte 11 400 écoles, alors que 1 250 000 enfants arabes et berbères se partagent 699 établissements. À la veille de l’indépendance, dans les années 1950, seulement 4 % des filles scolarisables vont à l’école (10 % pour l’ensemble des enfants algériens et 97 % pour les enfants européens) alors qu’un « plan de scolarisation » a été lancé par le décret du 27 novembre 1944. Les quelques centres de formation ouverts notamment à l’occasion du Centenaire, en 1930, confinent les filles et les jeunes filles aux tâches ménagères (cuisine, repassage) ou artisanales (tissage de tapis, broderies…) et leurs effectifs sont symboliques. Voir : Feriel Lalami, « L’enjeu du statut des femmes durant la période coloniale en Algérie », Nouvelles Questions féministes, 2008/3 (vol. 27), pp. 16-27. DOI : 10.3917/nqf.273.0016.
[34] National Security Memorandum, Implications of Worldwide Population Growth for U.S Security and Overseas Interests, 10 décembre 1974, déclassifié en mars 1989.
[35] Françoise Vergès, Le ventre des femmes, op. cit.
[36] http://www.un.org/fr/sections/issues-depth/women/
[37] Télégramme du Département d’État à tous les postes diplomatiques et consulaires. Sur les politiques internationales des années 1970 sur le féminisme, voir : Karen Garner, « Global Gender Policies in the Nineties », Journal of Women’s History, 2012, vol. 24, no 4 ; Susan Watkins, « Which Feminisms ? », New Left Review, janvier-février 2018, no 109, pp. 5-72.
[38] Les travaux de Jules Falquet sur la décennie de la femme, sur les politiques internationales sur le genre et sur les conséquences des politiques de développement pour les femmes du Sud sont très éclairants ; voir : « Penser la mondialisation dans une perspective féministe », Travail, Genre, Société, 2011:1, pp. 81-98 ; De gré ou de force. Les femmes dans la mondialisation, Paris, La Dispute, 2008 ; « L’ONU, alliée des femmes ? Une analyse féministe du système des organisations internationales », Multitudes, 11 janvier 2003, pp. 179-191
[39] Voir : Jules Falquet, « L’ONU, alliée des femmes ? Une analyse féministe du système des organisations internationales », Multitudes, 2003/1 (no 11), pp. 179-191 » ; Greta Hofman Nemiroff, « Maintenant que les clameurs se sont tues, le jeu en valait-il la chandelle ? », in Recherches féministes, 1995, 8(2), pp. 159-170
[40] Parmi les très nombreux ouvrages consacrés à la réorganisation du travail féminin racisé dans les années 1970 et depuis, voir : Ester Boserup, Women’s Role in Economic Development, New York, St Martin’s Press, 1970 ; Jules Falquet, Pax Neoliberalia. Perspectives féministes sur la (réorganisation de) la violence, Donnemarie-Dontilly, éditions iXe, 2016 ; Laurent Fraisse, Isabelle Guérin et Madeleine Hersent, Femmes, économie et développement. De la résistance à la justice sociale, Paris, IRD/éditions Ères, 2011 ; Rhacel Salazar Parrenas, Servants of Globalization. Women, Migration and Domestic Work, Stanford, Stanford University Press, 2001 ; Pun Ngia, Made in China. Women Factory Workers in a Global Workforce, Durham, Duke University Press, 2005 ; « Gender Alternatives in African Development : Theories Metods and Evidence », Codesria, 2005, http://www.codesria.org/spip.php?article362&lang=en ; Sur la littérature d’emporwement, voir Melinda Gates, The Moment of Lift : How Empowering Women Changes the World, New York, Flatiron Books, 2019.
[41] Voir : OTAN/CPEA. Femmes, paix et sécurité. Politique et plan d’action 2018. Organisation du traité nord-atlantique, 11 juillet 2018, L’OTAN indique même la mise en place « du côté militaire, un conseiller pour les questions de genre à l’État-major militaire international et un comité consultatif d’experts (Comité OTAN sur la dimension de genre), chargés de promouvoir l’intégration de la dimension de genre dans la conception, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des politiques, des programmes et des opérations militaires » ; « l’OTAN doit devenir un protecteur majeur des droits des femmes », tribune de Genève, 12 décembre 2017.
[42] Les grandes institutions internationales ont toutes adopté des politiques qui privilégient les femmes et insistent sur l’égalité de genre. La Banque mondiale et le Fonds monétaire international ont largement diffusé l’argument de la plus grande responsabilité des femmes dans les années 1980-1990 pour le mettre au service de leurs politiques de développement et de micro-crédit, marginalisant les politiques qui ont mis les hommes au chômage, qui ont brisé des liens communautaires, renforcé la violence systémique et l’individualisme, et fait reposer sur les femmes la charge de prendre soin de la société. L’article « Empowering Women Is Smart Economics » d’Ana Revenga et Sudhir Shetty est très éclairant à ce sujet, qui démontre au FMI tous les bénéfices que l’entrée des femmes dans l’entreprise et le travail apporte à l’économie capitaliste (in Finance & Development, mars 2012). En 2014, le rapport du FMI Gender at work : A Companion to the World Development Report on Jobs décrivait les obstacles à l’entrée des femmes sur le marché du travail et les discriminations salariales dont elles sont victimes en insistant sur l’inégalité de genre. En 2018, Kristalina Georgieva, directrice générale de la Banque mondiale, déclarait : « Aucune économie ne peut atteindre son plein potentiel économique sans la participation pleine et entière des hommes et des femmes » et, la même année, l’Institut de la Francophonie pour le développement durable, organe subsidiaire de l’OIF, soulignait le rôle essentiel des femmes dans le développement.
[43] Jules Falquet, « Genre et développement : une analyse critique des politiques des institutions internationales depuis la Conférence de Pékin », in Fenneke Reysoo et Christine Verschuur, On m’appelle à régner. Mondialisation, pouvoirs et rapports de genre, Genève, IUE, 2003, pp. 59-90.
[44] Ces mots perdent en français de leur pouvoir d’évocation : dans empowerment, il y a power, pouvoir mais sans sujet individuel ; capacity building fait appel à la psychologie, aux méthodes du self help, à la confiance en soi comme levier de changement ; governance est une notion des institutions internationales comme le FMI pour marginaliser la perte de pouvoir des gouvernements dans le Sud et faire d’un « bon gouvernement », pas corrompu, acceptant les lois de la démocratie occidentale, la solution aux inégalités. d’une réflexion collective des groupes militants aborigènes du Queensland dans les années 1970.
[12] Michael Stambolis-Ruhstorfer, « La multidimensionnalité comme outil de lutte pour une justice raciale et sexuelle complète », in Hourya Bentouhami et Mathias Möschel, eds, Critical Race Theory. Une introduction aux grands textes fondateurs, Paris, Dalloz, 2017, pp. 309-318, p. 310.