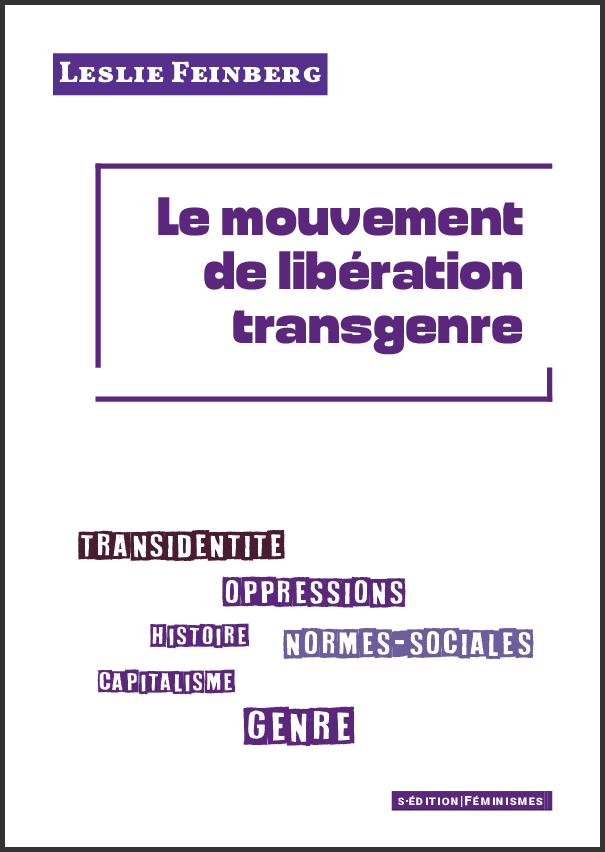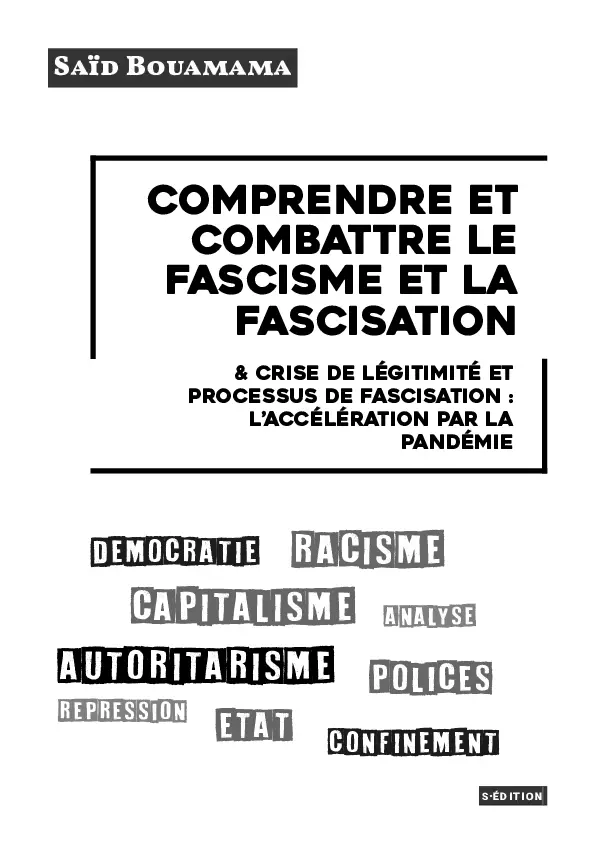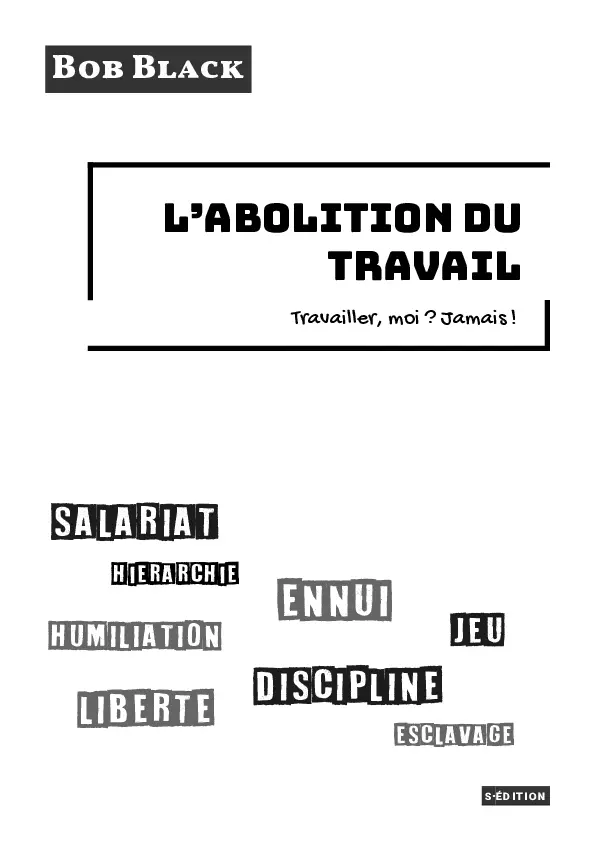Adrienne Rich — les arts du possible
Temps de lecture : ~ 38 minutes
Texte publié en 1997 dans The Massachusetts Review , * *sous le titre *Arts of the possible. *
J’apprécie grandement l’occasion qui m’est offerte de rassembler, pour vous les présenter, quelques questions qui m’ont préoccupée ces deux dernières années. En fait, je dois avouer que cela fait plus de dix-huit mois que je garde un dossier étiqueté « Conférence Troy », dans lequel je n’ai cessé de glisser des notes, les unes manuscrites, les autres dactylographiées, rédigées dans divers états d’intense réflexion, d’inquiétude et d’espoir. Lorsqu’en janvier dernier j’ai répandu le contenu de ce dossier sur la table de la cuisine, ses éléments ne se sont pas ajustés d’eux-mêmes selon le schéma d’une conférence, comme les tas de pois, de haricots et de grains se sont triés tout seuls pour Psyché selon le mythe grec. Mais ils m’ont remis en mémoire à quel point certaines réalités, certaines situations de crise m’avaient obsédée pendant toute une période, tels d’incontournables visiteurs.
La tâche de Psyché consistait à séparer les lentilles des grains de millet, les légumineuses des céréales. Je vois la mienne plutôt comme un travail de mise en relation.
Je vais d’abord vous exposer rapidement quelques-unes de mes préoccupations, puis je tenterai de montrer comment, à mon avis, elles sont liées aux principaux thèmes de cette conférence : l’art, les humanités et l’éducation publique – ainsi qu’avec les conditions auxquelles nous sommes confronté·es, nous toutes et tous et en particulier les jeunes qui s’efforcent de donner un sens à leur vie à notre époque.
Je commence par le remaniement de notre projet national, autrefois apparemment consensuel : une république démocratique avec une classe moyenne vaste et en expansion, et l’égalité des chances présentée comme le grand espoir. Au cours des deux dernières décennies peut·etre moins – nous sommes devenus une Société pyramidale, avec à son sommet un petit nombre d’individus avides de tout dévorer et acquérir, puis une classe moyenne dépérissante et dans l’insécurité, et enfin un nombre croissant de citoyens et de travailleurs mal lotis et considérés comme des rebuts – et pour terminer, une Société caractérisée par le taux d’incarcération le plus élevé du monde. Nous oscillons dangereusement au-dessus de l’énorme gouffre entre la propagande nationale et le mode de vie de la plupart des gens : une dissonance cognitive et émotionnelle, une sorte de dépression publique, dont les symptômes vont de l’extrême engagement militant à une intense angoisse, et à la violence individuelle et de groupe.
Parallèlement à cette crise dans notre propre pays, j’ai pensé à l’autopromotion autocongratulatrice du capitalisme en tant qu’ordre global et transnational, au-dessus des gouvernements et réduisant à néant le sens du libre choix électoral des citoyens, c’est-à-dire de la démocratie représentative. J’ai notamment remarqué les dévoiements du langage utilisé pour gérer notre perception de tout cela. Là où la démocratie devient « la libre entreprise », les droits des individus l’intérêt propre du capital, il n’y a pas à s’étonner que l’ensemble des régulations sociales requises pour rendre possible l’égalité démocratique soit renvoyé comme un gigantesque bric-à-brac désuet, connu comme « le trop d’État ». Dans le vocabulaire volé aux politiques de libération, aucun mot n’a été aussi prostitué que celui de liberté.
J’ai été frappée par le présupposé qui se dégage sans cesse des médias, du discours universitaire et des programmes des partis progressistes aussi bien que conservateurs, à savoir que les questions soulevées par le marxisme, le socialisme et le communisme doivent inexorablement être identifiées avec leur usage et abus par certains régimes autoritaires et répressifs du XX siècle : ce pourquoi elles sont vouées à être des non-questions. Que parce que le marxisme, le socialisme, le communisme ont servi de déguisements à certains systèmes rétrogrades, cruels et sans scrupules, ils n’auront jamais d’autre existence que celle de masques pour ces systèmes. Que le capitalisme américain constitue la force libératrice du futur doté de la mission transnationale de réprimer toute tentative pour maintenir vivantes ces questions. Que le capitalisme n’a pas à rendre compte de sa violence et de son amoralité, Que les partis communistes ou socialistes de par le monde, y compris ceux de l’Inde et de l’Afrique du Sud, sont dans la simple reproduction des communismes pervertis de l’Europe de l’Est et de la Chine.
Selon ce présupposé, ou ce dogme, le capitalisme se représente lui-même comme une loi de l’histoire, ou plutôt, une loi au-delà de l’histoire sous laquelle gît à présent l’histoire, vouée à la rouille comme le Titanic. Ou bien le capitalisme se présente comme obéissance à la loi de la nature, la prédisposition « naturelle » et suprême de l’homme à un type d’activité compétitif, agressif, possessif, Là où le capitalisme invoque la liberté, cela signifie la liberté du capital, Où donc, dans le discours publie dominant, ce monologue autoréférentiel est-il mis en question ?
Ce monologue peut bien se prétendre transnational, il n’en demeure pas moins que ses racines se trouvent en Europe occidentale et aux États-Unis, et aux États-Unis nous avons nos propres manières de le formuler. Nous répétons encore une vieille rhétorique débilitante, invoquant le climat « de liberté » et les ressources vierges qui attendaient les premiers Européens arrivés sur le continent, l’esprit de liberté qui accompagne l’individualisme et le laisser-faire qui permettait aux nouveaux venus sans le sou d’acquérir des terres et de faire fortune. Généralement, nous ne rapportons pas les chances économiques ouvertes aux individus en Amérique, la prospérité et le pouvoir global du pays, au génocide de millions d’Indiens, à la confiscation et à la contamination des terres indiennes et de leurs ressources naturelles, à la répression qui sévit encore aujourd’hui à l’égard du mode de vie indien et des autorités indiennes ; on ne les rapporte pas davantage à la traite transatlantique des esclaves, qui a assuré la richesse de l’Europe en introduisant une force de travail captive dans les deux Amériques et dans les Caraïbes, et qui a donné sa place au « Nouveau Monde » dans l’économie internationale.
Sans doute avons-nous appris que l’ère de l’esclavage moderne est terminée, que c’est « de l’histoire », que le génocide perpétré contre les peuples tribaux et l’expropriation de leurs terres qu’ils tenaient par fidei commis de leurs ancêtres sont dépassés et s’en sont allés avec les derniers convois de chariots bâchés. Mais ces sortes d’institutions et de politiques ne meurent pas – elles changent – et nous les vivons encore : elles sont les pivots de l’ordre économique qui à pris pour nom d’emprunt celui de « démocratie ». Notre passé se poursuit dans notre présent et travaille à devenir notre futur.
Ces préoccupations m’engagent en tant que citoyenne ; je ressens chaque jour dans mes relations avec mes concitoyens les effets d’un système fondé sur l’accumulation des richesses – la valeur à l’aune de laquelle toutes les autres valeurs doivent se justifier. Nous ressentons tous ces effets. de manière tacite, tandis que nous poursuivons Îles allées et venues de nos vies individuelles, fragments que nous sommes d’un peuple encore mal défini.
Mais ce sont également mes préoccupations en tant que poète, en tant que praticienne d’un art ancien et rigoureusement éprouvé. Dans une société qui souffre d’un mal aussi extrême, Je crois que ce sont celles de tout·e écrivain·e et de tout·e artiste : le dommage non dit qui affecte les relations humaines, le blocage de toute recherche, le mépris voilé avec lequel on nous présente à nous-mêmes et aux autres, dans la majorité des représentations, une malnutrition qui s’étend du corps jusqu’à l’imagination elle-même. Le capital vulgarise et réduit des relations complexes à une banale iconographie. Il y à le langage de la haine, mais il y à aussi un langage plus généralement accepté du mépris et du mépris de soi – par exemple l’expression « baby boomers » infantilise et rabaisse toute une génération. Selon les intérêts du marché, les distinctions s’effacent et les subtilités s’évanouissent.
Cette dévalorisation du langage, cet aplatissement des images, ont pour effet une sorte d’incapacité massive à s’exprimer, même chez les personnes cultivées. Le langage lui-même sombre dans la superficialité. Toute chose, en fait, tend à devenir une chose jusqu’à ce qu’on ne puisse plus en parler qu’en termes de chose, de bien de consommation toujours voué à l’obsolescence. Quelle que soit notre génération, nous sommes marqués comme « consommateurs » – mais qu’advient-il alors de l’énergie humaine que nous avons déployée, et des vrais besoins que nous ressentons comme distincts de la poursuite de la consommation”? Qu’en est-il de la faim qu’aucun bien de consommation ne peut satisfaire parce que ce n’est pas la faim de quelque chose qu’on trouve dans les rayons d’un magasin ? Ou bien de la faim contrainte de consommer les repas mis au rebut dans les poubelles d’un restaurant fast-food ?
Tout artiste se confronte à la nécessité d’explorer, par différents moyens, les relations humaines – que l’on peut percevoir où non comme politiques. Mais il y a aussi, et toujours, les questions changeantes du medium lui-même, le savoir faire et ses exigences.
L’étude du silence m’a longtemps habitée. La matrice de l’œuvre d’un poète ne consiste pas seulement dans ce qu’il y a là qui doit être perçu et travaillé, mais aussi dans ce qui manque, desaparecido, rendu indicible, donc impensable. C’est par ces invisibles trous dans le réel que la poésie fait son chemin – c’est certainement vrai pour les femmes et pour les autres sujets marginalisés et pour les peuples dépossédés de leur pouvoir et colonisés, mais aussi, en dernière analyse, pour tous ceux qui pratiquent un art quel qu’il soit, à son niveau le plus profond. L’impulsion créatrice voit le jour – souvent de façon terriblement angoissante – dans un tunnel de silence, Tout poème authentique est la rupture d’un silence antérieur, et la première queson à adresser à un poème est : Quelle sorte de voix est en train de briser le silence, et quelle sorte de silence est en train d’être brisé ?
Et pourtant je dois dire ici que le silence n’est pas toujours nécessairement oppressif, ni nécessairement la négation ou l’extinction d’une réalité. Il peut se révéler fertile, il peut baigner l’imagination, il peut, comme dans les grands espaces ouverts – je pense à ces plaines qui s’étendent loin sous les plateaux Hopi de l’Arizona – constituer l’auréole d’une manière de vivre, une condition de la vision. De tels silences vivants sont de plus en plus mis en danger dans le monde par le commerce et l’appropriation, Même dans nos conversations, ici, en Amérique du Nord, nous qui déballons si avidement nos préoccupations les plus intimes devant des étrangers, nous redoutons l’espace d’imagination que le silence pourrait ouvrir entre deux personnes ou au sein d’un groupe. La télévision, bien sûr, a en horreur cette sorte de silence.
Mais le silence que moi j’ai en horreur est le silence de mort, celui qui est comme un angle sourd dans un auditorium, un téléphone hors service, un silence où le langage aurait dû s’exercer et s’en est trouvé empêché. Je parle du silence des cellules d’isolement dans les prisons de haute sécurité, de l’évidence mise à mal, d’un langage qu’il est interdit de prononcer, d’un vocabulaire déclaré défunt, de questions qu’on n’a pas le droit de poser. Je pense aussi aux sonorités mortes, bruits dépourvus de sens, à l’exil verbal, lorsqu’une langue riche et active est remplacée par un discours banal et inoffensif, ou lorsque les mots du courage cèdent la place aux fanfaronnades de la fausse transgression, crûment agressive, mais finalement impuissante.
Jamais ce silence du déplacement n’a été aussi assourdissant et aussi omniprésent, C’est au sein d’un tel déplacement que le langage poétique vit et accomplit son labeur ; et également la capacité visionnaire de l’avenir en politique.
J’ai réfléchi — moins dans la nostalgie que dans une perspective critique – à propos du début des années 70, lorsque le Mouvement de Libération des Femmes émergeant déployait sa vitalité par toutes sortes de voies : organisant, théorisant, fondant des institutions, s’exerçant dans la communication, les arts, la recherche, le journalisme. Pour la plupart des femmes engagées dans ce mouvement, pendant un temps au moins, il y eut un sentiment inoubliable d’advenir à la vie, de quelque chose de neuf, aussi le sentiment d’être reliées. On pouvait sentir le pouvoir d’une critique sociale, d’une politique qui semblait capable d’éclairer un terrain qui était auparavant le lieu de la mystification et des Faux semblants. En germe depuis plus d’un siècle dans la continuité d’autres mouvements pour la justice – l’organisation des travailleurs, contre le lynchage, pour les droits civiques, l’anti-impérialisme, l’antimilitarisme, le socialisme – cet élan politique appelait tous ces mouvements à rendre des comptes pour leur perpétuation des vieilles blessures de la misogynie, des vieilles divisions sexuées du pouvoir.
Une certaine souplesse des possibilités et des moyens économiques à cette époque, associée à l’intensité des ferments intellectuels et créatifs, permit d’imaginer des ressources qui n’existaient pas jusqu’alors et ensuite de travailler pour les réaliser : des centres de femmes pour la politique et la culture, des lignes téléphoniques permanentes et une écoute et des conseils pour les femmes violées, des groupes d’action pour l’avortement et la contraception, des refuges pour les femmes battues et leurs enfants, des cliniques médicales et des coopératives de crédit féministes, ainsi qu’une presse féministe et lesbienne, des journaux, des revues d’art, des librairies, des théâtres, des collectifs de montage de films et de vidéos, des ateliers et des instituts culturels. Comme cela arrive toujours, la nouvelle politique de libération ouvrit de nombreux espaces culturels et intellectuels. Au moins pendant toute une période, l’analyse et le militantisme politique entraient en interaction avec l’activité culturelle, et la « culture des femmes » n’avait pas rompu avec la « libération des femmes ».
Tout à fait en dehors de la flambée d’attention lancée par les médias sur quelques personnalités blanches, le mouvement créa ses propres espaces pour l’expression des dissensions et les débats. L’idée même d’un mouvement monolithique fut tôt contestée par les femmes de la classe ouvrière, les féministes socialistes, les femmes de couleur, les lesbiennes, les femmes qui étaient tout cela à la fois. Il y avait des discussions sur la hiérarchie et la démocratie, pour savoir quelles femmes parlaient au nom des femmes et comment et pourquoi ; sur la sexualité ; sur la façon dont les partitions de race et de classe constituent le cadre de nos perceptions et nos manières de nous organiser. Il y avait la ténacité et le courage de celles qui se levaient, meeting après meeting, pour répéter ce que les autres ne voulaient pas entendre : à savoir que les faits basiques de l’inégalité et du pouvoir en Amérique du Nord ne pouvaient être abordés uniquement en termes de genre.
Accordant de l’autorité à l’expérience des femmes comme à quelque chose qui avait été méprisé, déformé, oblitéré, ce mouvement devait également tenir compte du fait que, de l’autre côté, pourrait-on dire, du silence, les femmes ont des expériences extrêmement différentes.
Une des tentatives pour traiter cette contradiction fut la « politique de l’identité ». J’ai rencontré cette expression pour la première fois dans un manifeste féministe noir qui à été très discuté et largement diffusé, la Déclaration du Combahee River Collective, dont la première publication eut lieu en 1977. Cette « politique de l’identité » était une réponse nécessaire à la dévalorisation et à l’invisibilité des femmes afro-américaines dans tous les mouvements, mais elle était considérée, implicitement et explicitement, comme allant dans le sens de la solidarité. Le projet de changer les structures d’inégalité devait être réalisé à partir d’un savoir conscient, fruit de l’analyse, de la place de chacune à l’intersection du genre, de la race, de la classe et de l’orientation sexuelle. Cette conscience de soi était un pas nécessaire vers la définition de soi par soi des femmes afro-américaines contre l’auto-universalisation à la fois blanche et masculine, mais ce n’était pas une fin en soi. Le collectif exprimait son propre « besoin de faire du travail politique et d’aller au-delà de la prise de conscience et au-delà de l’usage que l’on pouvait en faire comme d’un groupe de soutien affectif ».
Si une telle interprétation de la « politique de l’identité » avait été entendue par un nombre suffisant de femmes blanches, cela aurait pu nous amener à considérer – et à agir sur – la racialisation de nos vies, et à examiner comment nos expériences de la couleur et de la classe ont été modelées par les usages variés et contradictoires que le patriarcat capitaliste a fait des différentes identités des femmes. Mais vers la fin des années 80, « identité » est devenu synonyme de « refuge » où l’on pouvait explorer la ressemblance plutôt que la différence, Et bien souvent se sont développés une auto-référence étouffante et un étroit chauvinisme de groupe.
Pendant ce temps le capitalisme ne fut pas long à se réorganiser autour de ce phénomène appelé « féminisme », en rapprochant certaines femmes du centre du pouvoir tout en en expulsant la plupart des autres dans une proportion galopante. Une politique étroite de l’identité se prêtait aisément à un étalage sur une table de « buffet » de styles de vie disposés par les traiteurs spécialisés en solutions personnelles. Un phénomène auquel, nous en faisons l’apprentissage, seule une politique globale de la société peut résister.
Je me suis concentrée brièvement sur le Mouvement de Libération des Femmes dont j’ai été partie prenante, personnellement et de façon : continue, et aussi parce qu’il à incarné pendant toute une période la sorte d’espace créatif que peut ouvrir un mouvement politique de libération : une relation visionnaire à la réalité, La raison de ce phénomène à quelque chose à voir avec le simple pouvoir d’un collectif capable d’imaginer le changement, et avec un sens de l’espoir collectif. Se joindre à d’autres pour définir des désirs et des besoins communs, identifier les forces qui les barrent, cela peut donner un très puissant tonique pour l’imagination, Et il y a eu une dynamique vivifiante entre l’art – là je parle en particulier de l’écriture comme prise sur le langage et transformation de la subjectivité – et la vie continue de mouvements pour des transformations sociales. Lorsque le langage et les images nous aident à nous nommer et à nous reconnaître, nous et notre condition, et que les activités pratiques menées en vue de la libération stimulent l’art et l’incitent à se renouveler, il se produit une complémentarité aussi nécessaire que la circulation du sang. Après tout, une politique de libération n’est en définitive pas simplement de l’opposition : c’est d’abord l’expression d’un élan pour créer du nouveau, un sens élargi de ce qui est humainement possible.
Les mouvements des années 60 et des années 70 aux États-Unis dégageaient des ouvertures auparavant scellées, dans imagination et l’espoir collectifs. Ces mouvements avaient leurs propres œillères, ils ont commis leurs propres erreurs de jugement. Ils ont été impitoyablement trivialisés, moqués et diabolisés par la droite et par ce qui est maintenant connu comme le centre en politique. Ils ont aussi été décriés, comme le note Aïjaz Ahmad, dans de nombreux textes du postmodernisme comme relevant de la « fausse conscience ». où de la « folie », tandis que, dans la théorie critique universitaire, la pensée marxiste où socialiste pouvait être rejetée tout de go, ou bien considérée comme « avant tout une méthode d’interprétation ».
En ce temps d’optimisme officiel débridé, de lourdes négations et de désespoir public, je sais que la génération actuelle d’étudiant·es devra et voudra négocier ses propres chemins au milieu de toutes ces affirmations. Pourtant, lorsque je pense à l’éducation politique des étudiant·es qui sont à présent dans leurs premières années d’université, je songe aux silences politiques et aux déplacements des problèmes pendant les vingt dernières années. Je songe au tissu des discussions, aux grandes déchirures dans ce tissu, au conditionnement et au marketing des désirs et des besoins préfabriqués de chaque génération. J’ai déploré le retrait vers la sphère personnelle comme fétiche omniprésent dans la culture du marché de masse. Dans sa concentration actuelle, l’industrie éditoriale se maintient à flot en partie grâce à une bouillie habile de littérature du développement personnel, laquelle fait l’objet d’une lourde promotion, de mémoires personnelles rédigées par des talents précoces, de biographies de célébrités, et quand ce sont les scandales sexuels et les procès qui font vendre les auteurs. À partir des animations et des entretiens télévisés, vous pourriez conclure que toutes les interactions humaines se limitent à des malheurs individuels et à des drames familiaux, des confessions et des révélations intimes.
Ce sont les relations de l’individu à la communauté, au pouvoir social et aux grands bouleversements de l’expérience humaine collective qui poseront toujours les questions les plus riches et les plus complexes. La question tenue en réserve pourrait bien être : une histoire personnelle, qu’est-ce qu’on peut en faire ? Qu’avons-nous appris lorsque nous connaissons votre histoire ? Avec qui croyez-vous que vous partagez votre sort ?
Si j’ai l’air de tomber à bras raccourcis sur « le personnel », ce n’est pas parce que je sous·estimerais l’expérience individuelle, où la propension humaine au récit, ni parce que je croirais en une sorte quelconque d'« universel » simpliste – masculin où féminin, ancien ou nouveau. Garrett Hongo donne un compte rendu éloquent de l’effort personnel comme un des moyens pour qu’une communauté parvienne à se connaître elle-même, à rejeter tous les stéréotypes, extérieurs ou intérieurs, à entendre « des histoires qui sont d’une certaine manière interdites et étiquetées comme aberrantes, militantes, dépravées ».
« Pour un·e écrivain·e, vous vivez dans cette sorte de silence, dans cette sorte de misère, ne sachant pas exactement ce que c’est que le monde ne vous donne pas… que votre œuvre ne peut pas encore aborder, vous commencez seulement alors à critiquer la culture et la société. C’est le moment où une puissante aliénation personnelle se transforme en pensée critique – l’origine de l’imagination. C’est ce premier pas inaugural de la compréhension qui permet l’émergence d’une créativité nouvelle, capable de faire bouger les choses, voire révolutionnaire, Cela se produit au croisement de la production artistique et de l’exercice d’une pensée profondément critique. »
L’édition et le marketing industriels ont peu d’intérêt pour de telles situations.
J’ai essayé de comprendre l’écologie morale de cette économie qui refuse de rendre des comptes, cet ordre ancien qui se qualifie lui-même de nouveau. Quels sont ses effets sur notre vie émotionnelle, affective et intellectuelle ? Au cours de la décennie passée, j’aurais trouvé plus difficile d’observer plus calmement et à loisir ce qui se passait autour de nous Sans recourir à la perception de Marx, selon laquelle les relations économiques – les relations de production – parviennent à notre insu à infiltrer toutes les autres relations sociales, que ce soit au niveau public ou au niveau le plus privé. Non que Marx pensât que les sentiments, l’esprit humain, les relations humaines ne soient que les produits inertes de l’économie. Il était bien plutôt scandalisé par la manière dont le capital traitait le travail humain et l’énergie humaine seulement comme des moyens, par son hostilité à l’égard de l’épanouissement de la personne tout entière, par sa réduction du tissu entier de l’existence à un bien de consommation : ce qui peut être produit et vendu pour le profit. À la place de tous les sens physiques et spirituels, nous dit-il, il y a le sens de la possession, qui est l’aliénation de tous ces sens. Marx était passionnément indigné par l’insensibilité d’un système qui doit extraire toujours plus d’humanité de l’être humain : du temps et de l’espace pour l’amour, pour le sommeil et le rêve, du temps pour créer de l’art. du temps pour la solitude et du temps pour la vie en commun, du temps pour explorer l’idée d’un univers de liberté en expansion.
Depuis quelques années, les Républicains et la Droite du Congrès ont été à maintes reprises caractérisés par le qualificatif de mesquins.
Par extension, on a utilisé la même expression pour décrie l’humeur des électeurs américains mécontents. J’ai toujours soupçonné ce terme d’être à côté de la plaque. Si c’était seulement une question d’état d’esprit ! La mesquinerie est aussi américaine que la tarte aux cerises – parmi d’autres tendances, cela désigne un trait provincial au milieu d’une plus vaste texture sociale.
En tant que symptôme social généralisé, la mesquinerie évoque une inexplicable humeur nationale, une mauvaise attitude, un mélange de dépérissement de la conscience sociale et de compassion qui ont tourné à l’aigre, Mais les gens ne succombent pas sans raison à l’aigreur, au ressentiment et à la peur. L’expression en question nous renvoie à une conduite sociale, mais pas aux relations économiques que Marx percevait comme imprégnant toutes les conduites sociales. Cela réfère à une attitude mais pas aux politiques, aux pouvoirs et aux intérêts qu’elle sert. C’est un langage hypocrite destiné à faire diversion qui obscurcit l’impact vécu de la cruauté croissante de la législation et de la propagande contre les pauvres, les immigrants, les femmes, les enfants, la jeunesse, les vieux, les malades – pour commencer, tous ceux qui sont vulnérables – et cela marque également l’érosion des espoirs de la classe moyenne modeste, au nom du marché, où bien au nom d’une chimère connue comme l’équilibre du budget.
Nous avons tous assisté à des tentatives pour établir des graphiques numériques des effets de ces politiques : le nombre de gens qui ont dû quitter des appartements ou des chambres louées, ou laisser leurs affaires pêle-mêle dans la rue ; une population de travailleurs sans soins de santé, sans services pour les enfants, sans un abri sûr de prix abordable. Mais chacune de ces personnes est davantage qu’un corps qu’il faut compter : chacune a un esprit et une âme. Quantité d’enfants sont abandonnés à eux-mêmes ou sont à la garde d’autres enfants pour que les parents puissent travailler : quantité d’enfants passent leur temps dans des écoles qui ne sont rien d’autre que des enclos pour la jeunesse, mortifères pour beaucoup. Chacun de ces enfants possède une intelligence, un élan créatif, et des facultés dont on ne peut rendre compte en les quantifiant. Nombre de travailleurs, cols bleus et cols blancs, qui ont perdu leur poste à temps plein pourvu d’une retraite à cause de ce qu’on appelle la réduction des effectifs, la restructuration, la délocalisation de la production – effectuant plusieurs petits boulots pour des salaires qui vont s’amenuisant et des heures supplémentaires obligatoires. Chacune de ces personnes est davantage qu’une tête d’épingle sur une carte : chacune est née en étant pour elle-même sa propre fin, et chacune est unique. On est en train de construire un grand nombre de prisons – une « industrie en pleine croissance » dans ce pays, dont les écoles publiques et les hôpitaux vont à vau-l’eau. Les prisons aussi sont des enclos pour la jeunesse, avec une disproportion flagrante pour les Jeunes hommes afroaméricains. La prison comme une usine de l’ombre, où les détenus assemblent, pour 35 cents de l’heure, des pièces d’automobiles et d’ordinateurs, ou prennent des réservations téléphoniques pour la compagnie d’aviation TWA ou la chaîne hôtelière Best Western – force de travail contrainte et bon marché. Les femmes – de toutes couleurs – constituent le groupe dont le taux d’incarcération croît le plus vite, dont les deux tiers sont mères d’enfants dépendants. Une population croissante de condamnés à perpétuité et de gens dans les couloirs de la mort. Un système de peine de mort que les statistiques révèlent implacablement indexé sur la race. Selon les mots de Mumia AbuJamal, journaliste dans les couloirs de la mort, « l’illusion de réhabilitation est délibérément remplacée par la déshumanisation », dans les unités de haute sécurité et de privation sensorielle des pénitenciers états-uniens, ainsi que dans a plupart des prisons.
Chacune de ces femmes et chacun ces hommes qui sont « à l’intérieur » a, où a eu, une personnalité à offrir au monde, une présence. Et la pente glissante qui mène ceux de « l’extérieur » – parmi lesquels tant de jeunes – à la prison, qui se sentent devenir des rebuts sociaux et économiques est un processus dissimulé par des termes clichés comme la drogue, le crime. Nous sommes censés détourner les yeux de cette réalité. Mais dans n’importe quel pays, ce qui se passe derrière les barreaux n’est pas séparable de la qualité de la vie au-dehors. La « déshumanisation délibérée » ne peut avoir lieu derrière les barreaux sans se produire également dans l’espace public. Dans l’espace public de la plus riche et la plus puissante des nations, la nôtre.
Sur un fond de crise, et dans une perspective de crise, avec une technologie aux moyens éblouissants et d’une violence démente dans sa substance, au milieu des déclarations de résignation et de prédiction de chaos social, il m’arrive parfois – et je sais que je ne suis pas la seule dans ce cas – d’être en proie à un mauvais pressentiment presque insupportable, une perte d’équilibre terrifiante et un chagrin furieux.
Je suis une écrivaine dans un pays où des tendances fascistes enracinées de longue date, associées aux pratiques du « libre marché », se sont efforcées de vider le langage de son sens. Souvent je me suis sentie doublement lésée : du fait que je ne puisse être vraiment entendue, et que les voix que j’aurais le plus besoin d’entendre soient coupées de moi. Tout écrivain, femme ou homme, se pose nécessairement des questions : est-ce que ses mots tiennent le coup, valent-ils la peine d’être lus ? Je me suis aussi posé la question, sentant que presque tout ce qui a nourri et soutenu mon œuvre est en danger. J’ai su alors que c’était en réalité la matière même de mon travail : ce n’est pas « en dépit de l’époque » que j’écris, mais* à partir de mon époque, et pour sortir de cette époque.*
(Dans un tableau de Dorothea Tanning, de 1973, le bras de la femme qui peint passe littéralement à travers la toile : nous ne voyons pas le pinceau, nous voyons le bras jusqu’au poignet, et la déchirure de la toile. C’est ça, viscéralement, que cela signifie pour moi, écrire en dépit de son époque et pour sortir de son époque).
Je suis restée en contact avec le militantisme et avec les gens dont l’élan politique, tel un phénix, renaît continuellement du nid réduit en cendres par l’hostilité et le mensonge. J’ai parlé longtemps avec des ami·es, j’ai cherché des mots – les miens et ceux d’autres écrivain·es.
Dans de nombreux endroits du monde, j’ai été attirée par ces écrivain·es qui ont ressent le besoin de s’interroger sur l’activité autour de laquelle leur vie à gravité : de se poser la question de la valeur du mot écrit en face de dangers de toutes sortes et des immenses besoins humains. Je ne recherchais pas une réassurance facile mais plutôt le témoignage selon lequel d’autres que moi, dans d’autres sociétés, ont eux aussi été aux prises avec cette question.
Quelle que soit son identité sociale, l’écrivain, femme ou homme, est par la nature de l’acte d’écriture quelqu’un qui lutte pour la communication et la connexion, quelqu’un qui s’efforce, par le langage, de maintenir vivante la conversation avec ce qu’Octavio Paz a appelé « la communauté perdue ». Même si ce qui est écrit ressemble plutôt à une lettre placée dans une bouteille jetée à la mer. Le poète palestinien Mahmoud Darwich note l’incapacité de la poésie à trouver un équivalent verbal de circonstances telles que le bombardement 1sraélien de Beyrouth en 1984 : Nous n’en sommes pas à décrire, pas autant que nous devons plutôt être décrits. Nous sommes entièrement mis au monde, ou alors nous mourons entièrement. Dans sa remarquable méditation en prose sur cette guerre, il dit également : Je veux pourtant que le chant fasse irruption Je veux trouver un langage qui transforme le langage lui-même en acier pour l’esprit – un langage pour s’en servir contre ces insectes d’argent étincelants, ces avions à réaction. Je veux chanter Je veux un langage sur lequel je puisse m’appuyer et qui prenne appui sur moi, qui me demande de porter témoignage, et à qui je puisse demander de témoigner de ce pouvoir qui est en nous afin que nous Surmontions cet isolement cosmique.
Darwich écrit depuis le cœur d’un massacre militaire, la poète caribéenne-canadienne Dionne Brand écrit depuis une diaspora coloniale : « J’ai eu des moments où la vie de mon peuple à été si accablante à porter que la poésie semblait inutile, et je ne peux pas dire qu’il n’y ait jamais de moment où je n’aie encore cette pensée. » Pourtant, finalement, elle reconnaît, comme Darwich : « La poésie est là, simplement là. Quelque chose qui entre en lutte avec la manière dont nous vivons, quelque chose de dangereux, quelque chose d’honnête. »
Je suis retournée maintes fois à l’essai d’Eduardo Galeano « Pour la défense du mot », où il déclare :
« Je ne partage pas l’attitude de ces écrivains qui revendiquent pour cuxmêmes des privilèges divins qui ne sont pas accordés aux mortels ordinaires, ni de ceux qui se frappent la poitrine et déchirent leurs vêtements en clamant haut et fort que le pardon public leur soit accordé pour avoir vécu une vie consacrée à servir une vocation inutile. Ni aussi divin, ni aussi méprisable.…
L’ordre social dominant pervertit ou annihile les capacités créatives de l’immense majorité des gens et réduit la possibilité de création – cette réponse du fond des âges à angoisse humaine et à la certitude de la mort à son exercice professionnel par une poignée de spécialistes. Combien de “spécialistes” sommes-nous en Amérique latine ? Pour qui écrivons-nous ? Qui touchons-nous ? Où est notre vrai public ? (Ne nous fions pas aux applaudissements. Parfois nous sommes félicités par ceux qui nous considèrent comme inoffensifs).
Prétendre que la littérature par elle-même va changer la réalité serait pure folie ou arrogance. Il ne me semble pas moins absurde de nier qu’elle puisse aider à ce changement. »
Galeano a écrit cette « Défense » après que sa revue, Crisis, ait été interdite par le gouvernement argentin. C’est comme écrivain en exil qu’il a continué à interroger la place du mot écrit, de la littérature, dans un ordre politique qui interdit à tant de monde l’accès à la lecture et à l’expression créative ; qui nie la valeur de la littérature comme moyen de changement social alors même qu’il redoute son pouvoir. Tout comme Nadine Gordimer en Afrique du Sud, il sait que la censure peut revêtir bien des aspects, depuis la fermeture des revues et interdiction des livres de certains écrivains, jusqu’à l’emprisonnement et la torture pour d’autres, jusqu’à la censure structurelle produite par une totale inégalité des chances dans l’éducation et par la restriction de l’accès aux moyens de distribution – deux traits de la société nord-américaine qui sont devenus de plus en plus marquants au cours des deux dernières décennies.
Je mets en question l’attachement du « libre » marché à la liberté d’expression. Souvenons-nous que lorsque des menaces de violence se sont abattues contre la publication et la vente des Versets sataniques de Salman Rushdie, les magasins appartenant à des chaînes les ont retirés de leurs rayons, tandis que les libraires indépendants continuaient à s’en approvisionner, Les diverses petites maisons d’édition indépendantes dans ce pays, qui ont eu une relation exclusive avec les libraires indépendants, sont dans une passe de plus en plus difficile, au fur et à mesure que les coûts s’élèvent, que les soutiens financiers s’amenuisent, et que les réseaux de distribution deviennent de plus en plus monolithiques. La survie d’une grande diversité de livres, et de l’œuvre d’écrivain·es beaucoup moins reconnu·es internationalement que Rushdie, dépend de la diversité des intérêts ayant les moyens de rendre accessibles de tels livres.
Cela signifie aussi qu’il doit y avoir un public cultivé, qui ne soit pas nécessairement une élite, une population instruite, des gens qui lisent et se parlent, qui peuvent être ouvriers en usine ou boulangers, ou guichetiers de banque, où dans les professions paramédicales, des plombiers, des consultants en informatique ou des ouvriers agricoles, dont la première langue peut être le croate ou le tagalog, l’espagnol ou le vietnamien, mais qui exercent leur pensée critique, sont sensibles à l’art, une intelligentsia au-delà des spécialistes intellectuels.
J’ai rencontré chez des écrivain·es engagé·es politiquement une mise en question de soi vigoureuse et vivifiante, qui allait de pair avec leur conviction que le langage peut être un instrument vital pour combattre la fausse réalité et les mensonges. Je leur ai été reconnaissante pour leur clarté, qu’il s’agisse de l’Amérique latine, de l’Afrique du Sud, des Caraïbes, de l’Amérique du Nord ou du Moyen-Orient, quant aux systèmes qui endommagent et ravagent la majorité des vies humaines. Surtout, il y à la conviction – et ce sont des écrivain·es de poésie, de fiction, de littérature de voyages, ou fantastique – que la liberté de communiquer de l’écrivain·e ne peut être séparée de l’éducation publique universelle et de l’accès public universel au verbe.
L’éducation publique universelle a deux missions possibles – qui sont contradictoires. L’une est de développer une citoyenneté instruite bien informée, capable de s’exprimer, si bien que le processus démocratique peut poursuivre son évolution, et la promesse d’une radicale égalité peut voir sa réalisation s’approcher. L’autre est de perpétuer un système de classe séparant une élite, ce qu’on appelle le petit nombre des gens « doués », repérés dès l’âge tendre, d’une très vaste sous-classe tenue à l’écart parce que décrite comme étrangère au langage, à la science, à la poésie et à la politique, une sous-classe qu’il faut canaliser – quels que soient ses rêves et ses espoirs – vers des emplois temporaires à bas salaires. C’est cette seconde direction que notre société a prise.
Les résultats sont désastreux, c’est la trahison d’une génération de jeunes. La perte pour l’ensemble de la société est incalculable.
Mais prendre l’autre direction, choisir un système éducatif imaginatif et très développé qui soit au service de tou-te-s les citoyen·nes quel que soit leur âge – une vaste école publique, partagée, où chacun de nous se sente investi, comme dans les équipements publics des routes, prêts quand on en a besoin – cela voudrait dire changer pratiquement tout le reste.
Cela voudrait dire refuser catégoriquement les discours sans consistance des piétés et des banalités officielles. Comme l’écrit Jonathan Kozol dans son « Memo au Président Clinton » :
« Vous avez parlé parfois d’introduire des ordinateurs dans les écoles des quartiers ghettos, d’installer des zones d’entreprises dans les faubourgs des ghettos, et de prendre des mesures plus énergiques contre le crime dans les rues des ghettos. Pourtant vous n’avez jamais demandé à la nation de s’interroger, de se demander si les écoles des ghettos et le ghetto lui-même ne représentent pas des institutions détestables, moralement scandaleuses. Le ghetto… doit-il être accepté comme un cancer permanent sur le corps de la démocratie américaine ? Ne s’attaquera-t-on jamais à son existence ? Ne mettra-t-on jamais sa persistance en question ?
Cela fait-il partie de l’agenda moral de notre président de ne rien faire sinon parler de versions plus douces de l’apartheid, de la ségrégation dans les entreprises. ? »
Certes, mais bien sûr des voix s’élèvent pour dire que nous voyons à présent le pire du capitalisme qui s’emballe, il y a même un ou deux millionnaires pour se demander si les choses ne sont pas allées trop loin. Peut·etre que l’on peut restructurer la chose, la réinventer ?
Après tout, c’est tout ce que nous avons, le seul système que nous ayons Jamais connu dans ce pays ! Sans l’attirance du capitalisme pour les enjeux et les risques élevés, sa fascination pour le pouvoir individuel, comment aurions-nous pu concevoir, planifier et développer les stupéfiants feux d’artifice technologiques de la fin de ce siècle – cette technologie capable de générer des produits de consommation qui deviennent toujours plus rapidement obsolètes, des connexions encore plus formidables parmi ceux qui sont déjà très bien connectés ?
D’autres voix parlent d’une technologie capable de venir à notre secours et de nous sauver. Ceux qui font partie de ce contexte pyrotechnique le voient comme mettant en lumière d’énormes possibilités dans l’éducation par exemple. Mais comment pourrait-il aboutir sans que ce soit orienté et guidé par des intérêts non techniques et non tournés vers le profit ? Et d’où viendra une telle orientation ? Quel pouvoir la validera ?
Est-ce la technologie plutôt que la démocratie qui constitue notre destinée ? Qui, quels groupes, montrent sa direction et ses finalités ? À qui appartient·elle réellement ? Quel devrait être son contenu ? Avec les avancées spectaculaires de la technologie médicale, pourquoi n’y aurait-il pas un service de santé d’accès libre et universel ? S’il doit y avoir des ordinateurs dans toutes les écoles des ghettos, pourquoi des ghettos ? Et pourquoi pas des professeurs bien formés et bien payés ?
Si c’est la défense nationale qui est l’enjeu, pourquoi pas, comme le suggère la poète militante Frances Payne Adler, un budget « défense nationale » qui défende le peuple en lui offrant des soins de santé abordables, l’éducation et le logement pour tous ? Pourquoi un tel minimum social serait-il si menaçant ? La technologie – magnifique, certes, mais après tout un simple moyen – ne résoudra pas par elle-même des questions comme celles-ci.
Il faut commencer par changer de questions. Avoir moins peur de réitérer les questions encore sans réponse posées par le marxisme, le socialisme et le communisme. Ne pas interroger les vieux systèmes hiérarchiques corrompus, mais questionner à neuf, pour notre propre temps : en quoi consiste la propriété ? Qu’est-ce que le travail ? Comment les gens peuvent-ils être assurés de recevoir une juste part des produits de leurs précieux efforts humains”? Comment pouvons-nous passer d’un système de production dans lequel le travail humain n’est qu’un simple moyen à disposition, à un processus qui dépend et en même temps développe des relations et des connexions, le respect mutuel, la dignité du travail, le développement du sujet humain poussé au plus haut ? Quelle dose d’inégalité allons-nous encore tolérer dans la nation la plus riche et la plus puissante ? Et qu’est-ce que la richesse sociale ? Cela ne doit-il être défini qu’en termes de propriété privée ? Que signifie pour nous ce mot tellement maltraité et piétiné de révolution ? Comment empêcher les révolutions de se refermer sur elles-mêmes ? Les femmes et les hommes peuvent-ils imaginer ensemble une « révolution permanente » ? Qui se déploierait de manière continue dans le temps ?
Et si nous sommes de ces écrivain·es qui écrivent d’abord parce que tel est leur propre désir, si c’est un besoin irrésistible, si en écrivant nous faisons l’expérience de certaines formes de pouvoir et de liberté qui nous seraient inaccessibles autrement sûrement il doit s’ensuivre que nous voudrions rendre accessible à tous ceux qui peuvent en faire usage cette manière de mettre les choses en forme, de les nommer, de les raconter. Il semblerait que ce soit tout naturel pour les écrivain·es de se soucier passionnément de l’instruction publique, des bibliothèques publiques, des ressources publiques dans tous les arts. Mais il y a plus ! Si nous sommes préoccupé·es de la liberté dans le monde, du langage comme vecteur de liberté, si nous tenons à l’imagination, nous serons soucieux de justice économique.
Ce à quoi aspire le capital, c’est à réduire, non à développer, l’intelligence humaine générale, l’esprit, l’expression, la rébellion créative. Si la libre entreprise doit être complètement libre, une valeur en elle-même et pour elle-même, elle ne peut avoir d’intérêt dans d’autres domaines de valeur. Elle peut aider du bout des lèvres des institutions caritatives, mais son élan va vers ce qui travaille à l’accumulation de la richesse : c’est un système monomanique. Elle ne peut certainement pas enrichir le domaine de l’imagination sociale, et le moins de tous, l’imagination de comportements humains de solidarité et de coopération, l’imagination non réalisée de l’égalité radicale.
Dans un poème écrit dans les années 70 en Angleterre, tandis que le paysage politique s’orientait vers un gouvernement militaire confortant la droite, pratiquant la torture, les disparitions et les massacres, le poète Juan Gelman médite sur les illusions du compromis politique. Le poème est intitulé « Clartés » :
Qui a vu la colombe épouser le faucon
la méfiance s’allier à l’affection, l’exploité à celui qui l’exploite ? Faux
sont de tels innommables mariages
Des désastres, voilà ce qui naît de tels mariages, la discorde, la tristesse,
Combien de temps peut durer le foyer fondé par ce mariage ?
La moindre brise ne va-t·elle Le brover, le détruire, le ciel le réduire en ruines ? Oh, mon pays !
Triste ! En proie à la rage ! Beau ! Oh mon pays face au peloton d’exécution !
Eclaboussé de sang révolutionnaire !
Les perroquets à la crête colorée
Qui vont gloussant dans tous les arbres ou presque
Et se font la cour sur chaque branche
Sont-ils davantage seuls ? Moins seuls ? Solitaires ? Car
Qui a vu le boucher épouser le tendre veau
la tendresse épouser le capitalisme ? Faux
sont de tels innommables mariages
Des désastres, voilà ce qui naît de tels mariages, la discorde, [la tristesse, des clartés telles que
le jour lui-même tournovant dans la coupole de fer au-dessus de ce poème
J’ai parlé assez longuement de la propension du capitalisme à retirer aux citoyens leur capacité politique et à les déshumaniser, à envahir les zones de sentiments et de relations qui sont notre champ d’investigation en tant qu’écrivain·es – et que Marx à décrits il y à longtemps – parce que ces processus doivent encore être décrits comme faisant ce qu’ils font encore. J’ai parlé du point de vue d’une écrivaine, et d’une professeure – depuis longtemps – S’efforçant de saisir les vents mauvais et les virages brusques de son époque – un être humain qui se pense comme une artiste et qui doit donc se demander ce que cela signifie.
Je voudrais terminer en vous disant ceci : nous ne sommes pas simplement piégé·es par le présent. Nous ne sommes pas enfermé·es dans un couloir qui irait se rétrécissant jusqu’à « la fin de histoire ».
Et personne d’entre nous n’a l’obligation de surfer sur les courants d’un système qui repose sur la trahison de tant d’autres. Nous avons le choix. Nous vivons dans une certaine période de l’histoire qui a besoin que nous la vivions, que nous la fassions et que nous l’écrivions. Nous pouvons faire cette histoire avec d’autres, nombreux, des gens que nous ne connaîtrons jamais. Ou bien nous pouvons vivre « par défaut », en protestant, peut·etre, mais en restant neutres en ce qui concerne ce que nous sentons et nos sympathies.
Nous ne devons pas cesser de poser les questions qui sont encore caractérisées comme des non-questions – celles qui commencent par Pourquoi… ? Que se passerait-il si… ? On nous dira que ce sont des questions enfantines, naïves, « pré-postmodernes ». Or ce sont les questions de l’imagination.
Nombre d’entre vous dans l’assistance sont des intellectuel·les professionnel·les, ou étudient pour le devenir, ou bien sont engagé·es d’une manière ou d’une autre dans les activités d’une université publique. Écrivain·es et intellectuel·les peuvent nommer les choses, nous pouvons les décrire, nous pouvons les dépeindre, nous pouvons témoigner – sans sacrifier notre savoir-faire, la nuance ou la beauté.
Par-dessus tout, et lorsque nous sommes à notre mieux, nous pouvons parfois aider à questionner les questions.
Essayons de faire tout cela, si nous le faisons, sans être pompeux.
Reconnaissons également, sans fausse humilité, les limites de la zone où nous travaillons. Écrire et enseigner sont des sortes de travail, et la relative liberté créative de l’écrivain·e ou de l’enseignant·e dépend des conditions du travail humain, globalement et partout.
Car que sommes-nous, de toute façon, à notre mieux, sinon une minuscule grappe dans un grand ferment d’activité humaine – encore et à jamais tournée vers le possible, accordée au possible, le dessein non réalisé et pourtant irrépressible ?