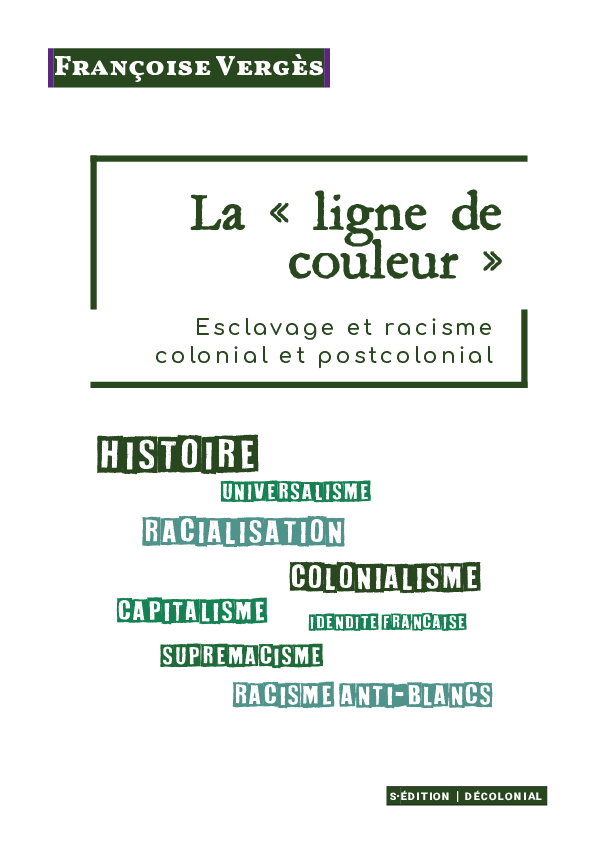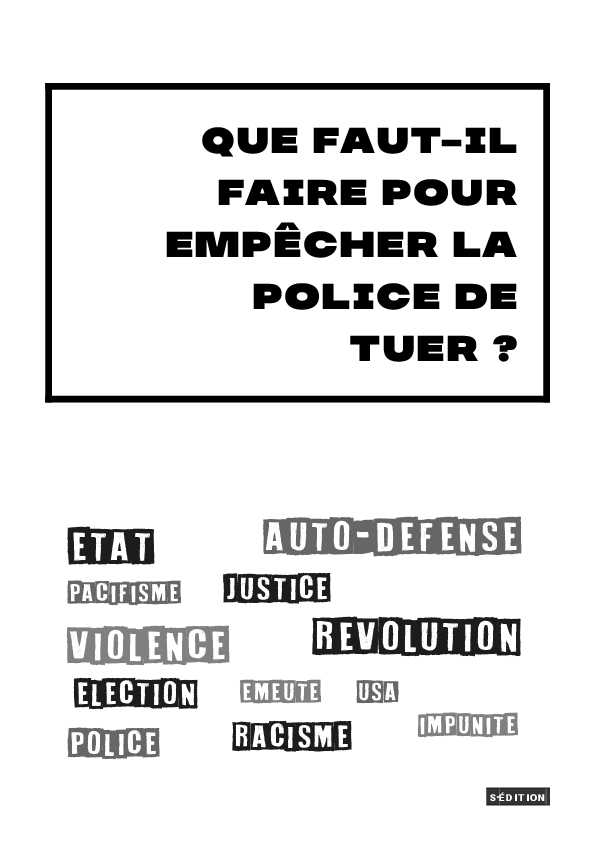Sadri Khiari — La construction de l’unité stratégique du Pouvoir blanc
Temps de lecture : ~ 45 minutes
Ce texte constitue le chapitre 4 du livre de Sadri Khiari, *La contre-révolution coloniale en France – De de Gaulle à Sarkozy, *publié en 2009 aux éditions La Fabrique.
« Ce sont les colons, les maîtres, qui prennent les décisions politiques concernant les colonisés, et qui les transmettent directement ou indirectement. Sur le plan politique, les décisions affectant la vie des Noirs ont toujours été prises par les Blancs, par le “Pouvoir blanc”. Ce terme déplaît souvent, car il semble vouloir ignorer ou schématiser la pluralité des centres du pouvoir, la diversité des forces qui font les décisions. Ceux qui avancent cet argument soulignent le caractère pluraliste du corps politique. Or ils oublient souvent que le pluralisme américain devient très vite un bloc monolithique dès qu’il s’agit de questions raciales. Face aux revendications du peuple noir, les multiples factions blanches s’unissent et présentent un front commun. »
Stokely Carmichael et Charles V. Hamilton, Le Black Power.
Le signe le plus manifeste de la croissance de la Puissance indigène est incontestablement l’ampleur de la réaction blanche qui lui est opposée. Elle a commencé à s’exprimer, on l’a vu, à l’orée des années 1970 ; elle a pris un nouvel essor sous la présidence de Valéry Giscard d’Estaing avant de connaître une impulsion décisive la décennie suivante. Il n’est pas question dans ce bref essai d’en analyser tous les moments et tous les détours, ni de proposer une interprétation détaillée des politiques suivies depuis la Marche pour l’égalité. Au risque d’être trop schématique, je me contenterai de rappeler les principales étapes de la construction du consensus blanc, en insistant moins sur la période la plus récente que nous avons tous en mémoire. De même, pour en faciliter l’exposition, j’évoquerai successivement les différents volets de l’offensive blanche. Mais il va de soi que ce qui la caractérise, c’est son unité. Unité d’abord du Pouvoir blanc, malgré les querelles entre ses partis les plus influents et la compétition serrée entre les différentes sphères qui le constituent ; unité ensuite de ses cibles, les communautés issues de l’immigration postcoloniale et les Français originaires des actuelles colonies ; unité enfin des moyens mis en œuvre, guerre idéologique, répression, politiques sociales et économiques, nouvelles procédures administratives et institutionnelles, dispositifs de contrôle et de clientélisation, etc. Cette unité, immanente au caractère raciale de la République mais constamment battue en brèche par d’autres clivages, a mis plus de vingt ans à se construire sur le plan stratégique pour s’incarner enfin dans la politique de Nicolas Sarkozy.
La majorité des indigènes qui ont le droit de vote porte traditionnellement ses voix sur la gauche – plus particulièrement sur le Parti socialiste, réputé antiraciste ou, en tous les cas, moins enclin à casser du bougnoule. C’est oublier le lourd héritage colonial de la social-démocratie française. Il est vrai qu’au cours des années 1970, alors que s’affirmaient les discours de la droite contre l’immigration et que le PCF masquait à peine sa prédilection pour la « préférence nationale », le PS n’hésitait pas à prendre la défense des travailleurs immigrés. L’antiracisme n’était assurément pas l’une de ses préoccupations centrales, loin de là, mais tout de même il lui fallait, contre ses concurrents au sein du champ politique blanc, se montrer « humaniste » et soucieux de promouvoir l’égalité. Cependant, au lendemain de l’accession de Mitterrand au sommet de l’État, de nombreux militants blancs qui soutenaient notre cause ont alors renoncé à s’engager à nos côtés. Même les plus sincères d’entre eux avaient d’autres priorités. Et puis, pensaient-ils bien souvent, il ne fallait pas affaiblir le nouveau pouvoir en encourageant les mouvements de contestation ; il suffisait d’attendre et d’agir au sein même des nouvelles institutions.
Dans un premier temps, il est vrai, le nouveau gouvernement a pris des mesures qui, malgré leurs limites, ont d’abord favorisé nos résistances. Le principal acquis de cette période, le seul qui ne sera pas totalement ou partiellement remis en cause par la suite, est incontestablement la reconnaissance pour les étrangers du droit de constituer des associations dans le cadre de la loi de 1901 ; une mesure fondamentale mais contradictoire comme tous les dispositifs démocratiques républicains : elle va à la fois faciliter et encourager de nombreux indigènes à s’affirmer et, en même temps, permettre à l’État de contrôler et de clientéliser une frange du mouvement associatif au moyen, notamment, d’une distribution sélective des subventions. Le gouvernement dirigé par les socialistes ne tient évidemment pas l’ensemble des promesses faites pendant la campagne électorale. Il ne revient même pas sur l’ensemble des dispositions adoptées par les gouvernements précédents contre l’immigration. Il supprime l’« aide au retour », régularise le séjour de nombreux étrangers et de leurs familles ; les expulsions sont momentanément interrompues ; d’autres dispositifs sont assouplis. La ligne directrice de la politique gouvernementale reste cependant l’arrêt de tout nouveau flux migratoire, le renforcement du contrôle aux frontières et l’aggravation des peines encourues par les immigrés en situation irrégulière. Très rapidement, malgré les divergences, parfois importantes, qui demeurent en leur sein, les socialistes vont adopter une politique de « fermeté » à l’encontre de l’immigration et des populations qui en sont issues : durcissement des conditions d’entrée et de séjour, sévérité accrue en direction des irréguliers, contrôle toujours plus strict de l’immigration familiale, fermeture des frontières, mesures plus ou moins camouflées pour rétablir l’« aide au retour », remise en vigueur d’un décret de 1946 qui autorise les contrôles d’identité, nécessairement au faciès. Sur tous les plans, le gouvernement instaure de nouvelles bornes à l’immigration, enchaînant dispositions répressives et promesses libérales. En mars 1983, deux ans à peine après l’élection triomphale de Mitterrand, la campagne des municipales ébauche les axes principaux de l’offensive blanche qui s’annonce : immigration, insécurité, quartiers populaires et islam.
Mais le véritable tournant est pris au lendemain de la Marche pour l’égalité. Dès le 25 mai 1984, pour être plus précis. Pour la première fois en effet, à l’occasion d’un débat public au Parlement, droite et gauche s’accordent sur la stratégie à tenir par rapport à l’immigration : distinguer l’immigration régulière qu’il s’agit d’« intégrer » de l’immigration irrégulière qu’il faut réprimer. Mais qui définit la frontière entre immigration régulière et immigration irrégulière ? La loi. Et que fera dorénavant la loi ? Elle fabriquera de l’irrégularité. Plus la loi restreint les possibilités d’immigrer régulièrement, plus les conditions régulières de travail et de séjour deviennent draconiennes, plus se multiplient les clandestins, plus se développent les contrôles et la répression des clandestins, plus les « réguliers » sont soumis à des pressions et précarisés. Une politique contre les entrées irrégulières est aussi une politique contre toute l’immigration. Au-delà, toutes les populations issues de l’immigration en subissent au moins indirectement les conséquences, ne serait-ce qu’en termes de suspicion, de dénigrement et de rejet [1] consensus blanc sera consacré par la loi du 17 juillet 1984 qui accorde la fameuse carte de dix ans [2] en réintroduisant en contrebande l’aide au retour (dénommée désormais « aide à la réinsertion ») et le principe du retrait des titres en cas de retour. Laurent Fabius, tout juste nommé Premier ministre, reconnaîtra à cette occasion le ralliement des socialistes à une politique de fermeté à l’encontre de l’immigration. Quelques mois plus tard, un décret d’application entérinera une série de conditions restrictives qui seront aggravées par les gouvernements ultérieurs. Le 10 octobre, le Conseil des ministres adopte de nouvelles dispositions pour limiter le droit au regroupement familial. Ce même mois, treize centres de rétention administrative sont inaugurés. Commentant la politique socialiste, Patrick Weil, ancien conseiller de Jean-Pierre Chevènement au ministère de l’Intérieur, se félicite que « le gouvernement de gauche prit alors conscience du fait qu’une certaine dose d’ordre public était nécessaire à l’existence de la communauté politique nationale [3]. Mais l’« ordre public », on le sait, n’est qu’un paravent. Il est bien plutôt question de défendre l’ordre national blanc contre l’immigration. Laurent Fabius l’admet implicitement lorsqu’il affirme, en octobre 1985, être d’accord sur le fond avec Jacques Chirac sur la question de l’immigration ; un Jacques Chirac chef de file de l’alliance entre le RPR et l’UDF dont le programme électoral promettait d’« affermir l’identité nationale en luttant contre l’immigration clandestine ». Un raccourci qui est en même temps un aveu : la vérité de la politique de l’immigration, ce n’est pas empêcher que l’Arabe ne « vole le pain des Français », c’est préserver l’« identité nationale » ; la chasse aux « clandestins » camoufle la répression de tous ceux qui sont censés menacer l’« identité nationale ». Sarkozy n’a rien inventé. Il est plus franc. C’est tout.
Cette entente fondamentale entre la droite et la gauche de gouvernement ne se démentira plus. La droite anticipera, les socialistes suivront. Dans l’opposition, ils dénonceront la sévérité des politiques de la droite ; de retour au pouvoir, ils en assoupliront quelques dispositions, en remplaceront certaines trop manifestement répressives ; rarement, cependant, ils en remettront en cause le principe. L’opération SOS-Racisme, engagée au lendemain de la Marche et alors que s’établit le consensus blanc sur l’immigration, procède d’une stratégie complexe. Elle a bien sûr été un moyen de contrer la droite. Mais elle a été aussi, dans le même temps, l’un des vecteurs de la recomposition à droite du champ politique blanc et l’une des médiations qui a légitimé l’alignement de la gauche sur la politique de l’immigration prônée par la droite. D’une certaine manière, et ce n’est pas le moindre de ses paradoxes, la Marche de 1983 tombe à pic du point de vue de la politique d’« intégration ». Et de nombreux responsables socialistes l’ont perçu, lui apportant un soutien ostensible au point que Mitterrand recevra une délégation de Marcheurs et leur promettra l’instauration de la carte de dix ans. À un premier niveau, on pourrait dire que, dans le cadre de la politique d’« intégration », le lancement médiatisé de SOS-Racisme et la mode « beur » qui l’a accompagnée ont constitué une façon de retourner contre elle-même la dynamique de contestation portée par la Marche. En d’autres termes, il s’est agi de dissimuler l’offensive lancée contre l’ensemble des indigènes et de conforter les hiérarchies qui les segmentent : les bons « beurs », que la République se propose généreusement d’« intégrer » et de protéger contre les méchants racistes du Front national, sont ainsi distingués de leurs parents immigrés, trop arabes pour être honnêtes [4] opposés aux « clandestins » ou, plus généralement, aux « derniers arrivés », réputés ralentir le processus d’« intégration ». SOS-Racisme s’est également adossé à la révolte exprimée par les Marcheurs pour imposer au sein du champ politique blanc les problématiques de l’« antiracisme » moralisant et de l’« antifascisme » comme des enjeux majeurs, susceptibles de transcender les lignes de clivages traditionnelles entre la gauche et la droite. À l’heure où la gauche au pouvoir renonçait à la fameuse « rupture anticapitaliste » qu’elle avait annoncée, alors que s’affirmait le potentiel déstabilisateur de la Puissance indigène, s’imposait, en effet, une nouvelle configuration idéologique dont la thématique combinée de l’antiracisme, de la tolérance et du « droit à la différence » a constitué l’une des dimensions dans la matrice plus large de la défense de la République, des droits de l’homme, de la « modernité », ou de la lutte contre l’« exclusion ». On pourrait citer quantité d’autres formulations de cette idéologie destinée à couvrir l’abandon des catégories d’exploitation et d’oppression, et le renoncement à une politique de la confrontation sociale. L’invention de la notion d’« exclusion », complémentaire de celle d’« intégration », est particulièrement significative de ce point de vue. Il y a des « exclus », mais qui sont les « exclueurs » ? Quel est l’ennemi à abattre pour éradiquer l’« exclusion » ? Quelles sont les institutions qu’il se donne pour « exclure » ? Ça n’est pas dit, bien sûr. Ou, plutôt, si : c’est dit dans le langage méritocratique de la responsabilité individuelle. L’exclueur est l’exclu lui-même. L’exclu est celui qui ne s’adapte pas, qui ne s’intègre pas. Il n’a à s’en prendre qu’à lui-même. C’est valable pour le chômeur blanc. C’est encore plus valable pour le chômeur indigène supposé naturellement/culturellement (c’est la même chose) inadapté à la société moderne. L’opération SOS-Racisme s’est ainsi insérée dans les reclassements internes au monde blanc, mais les recompositions idéologiques qu’elle a contribué à impulser au sein de la gauche ont participé aussi de l’offensive menée contre la Puissance indigène. On a souvent pu lire dans les écrits de militants indigènes que SOS-Racisme avait « récupéré » le mouvement issu de la Marche et « cassé » les organisations autonomes qui sont apparues dans son sillage. Une telle affirmation me semble devoir être relativisée dans la mesure où cette association n’est jamais parvenue à s’implanter au sein des populations issues de l’immigration, sinon à la marge. Si SOS-Racisme a bien « récupéré » quelque chose, c’est l’élan de sympathie que la Marche a suscité au sein de certains courants de gauche et de la jeunesse blanche. Si l’association, fondée par Julien Dray, a exclu les organisations de l’immigration et des banlieues, ce n’est pas de l’espace politique, mais de l’espace médiatique blanc et du champ politique blanc. Son impact immédiat sur les organisations de la jeunesse d’origine coloniale me paraît avoir été limité, sans bien sûr être négligeable : SOS-Racisme a « récupéré » de possibles soutiens blancs (notamment certains courants d’extrême gauche) ; elle a semé le trouble parmi les nôtres et a pu en « récupérer » une minorité. Ce n’est pas rien mais, encore une fois, il me semble absurde de voir dans SOS-Racisme la cause première des échecs des tentatives d’organisation autonome dans les années 1980, tout en affirmant (à juste titre) sa faible audience dans l’immigration et les quartiers. Je tends à penser, pour ma part, que SOS-Racisme a été effectivement une arme pointée contre les indigènes, mais principalement à l’intérieur de la « tribu blanche », pour reprendre l’expression de Wole Soyinka [5]
En mars 1986 est constitué le premier gouvernement de cohabitation dirigé par Jacques Chirac. Charles Pasqua, mentor de l’actuel chef de l’État dont il a guidé les premiers pas, en est le ministre de l’Intérieur. Il est décidé à en découdre, fidèle à la déclaration de politique générale présentée par Jacques Chirac à l’Assemblée nationale : « Le Parlement aura à débattre d’un projet instituant une procédure administrative pour reconduire à la frontière les étrangers en situation irrégulière et d’une modification du Code de la nationalité tendant à soumettre l’acquisition de la nationalité française à un acte de volonté préalable. Dans le domaine réglementaire, le gouvernement rétablira les visas pour l’entrée et le séjour des étrangers non originaires de la CEE [6] Un projet qui a le mérite, si l’on peut dire, d’articuler de manière transparente les différents volets de l’offensive contre les indigènes dont la question des « irréguliers » constitue, en quelque sorte, la feuille de vigne. Sans revenir sur le consensus politique de juillet 1984, le nouveau ministre de l’Intérieur s’attelle ainsi à compléter la législation répressive à l’égard de l’immigration clandestine adoptée par l’ancienne majorité. Il en durcit l’application et multiplie déclarations et actions spectaculaires destinées à prouver sa détermination (expulsion de 101 Maliens par vol charter). Surtout, il fait adopter une nouvelle loi qui instaure de nouvelles conditions, particulièrement restrictives, à l’entrée et au séjour des étrangers non communautaires (non blancs, pour dire les choses telles qu’elles sont), renforce les contrôles aux frontières, facilite les expulsions, étend le champ d’application de la « double peine », etc.
À la suite des élections présidentielle et législatives de 1988, la gauche dispose de nouveau de tous les leviers du pouvoir. Elle ne peut pas ignorer les pressions d’une partie de sa base électorale qui revendique l’abrogation des lois répressives. Mais, face au développement de la résistance populaire blanche qui s’est exprimé notamment dans la progression fulgurante du Front national (Le Pen a recueilli plus de 14 % des voix à la présidentielle), elle choisit de maintenir le cap tracé par les précédents gouvernements. La loi Pasqua n’est pas abrogée mais son application seulement assouplie (le nombre d’expulsions chute dans les mois qui suivent les élections). En août 1989, une nouvelle loi sur l’entrée et le séjour des étrangers est finalement adoptée ; elle supprime les dispositions les plus rigoureuses qui s’appliquaient aux immigrés en situation régulière mais préserve le principe de la chasse aux clandestins et la fermeture des frontières. C’est bien en deçà des promesses qu’avaient faites les socialistes durant la campagne électorale. Mais pour la droite, c’est déjà faire preuve de trop d’indulgence à l’égard de l’immigration. Son mot d’ordre à elle, c’est : « immigration zéro ». Et c’est encore à Charles Pasqua que reviendra la mise en œuvre de ce programme au lendemain de la victoire de Jacques Chirac à l’élection présidentielle de 1993. En moins de neuf mois, quatre lois ordinaires sont ainsi promulguées qui durcissent les conditions d’entrée et de séjour en France, instaurent de nouvelles contraintes au regroupement familial, limitent les droits des étudiants étrangers, renforcent des dispositifs policiers et administratifs destinés au contrôle de l’immigration, intensifient les expulsions et autorisent les contrôles préventifs d’identité par la police. La Constitution est également réformée pour restreindre le bénéfice du droit d’asile. Jean-Louis Debré, qui succède à Pasqua au ministère de l’Intérieur, poursuit dans la même direction.
Le socialiste Jean-Pierre Chevènement également ! En effet, à la suite des élections législatives de 1997, s’ouvre une nouvelle période de cohabitation. Cette fois, la droite est à l’Élysée et la gauche, majoritaire à l’Assemblée nationale, se voit confier la constitution du gouvernement. Nommé Premier ministre par Jacques Chirac, Lionel Jospin confie à Jean-Pierre Chevènement le ministère de l’Intérieur. La gauche s’était engagée aux côtés des sans-papiers lors de la grande lutte de 1996 ; elle avait promis d’abroger les lois Pasqua et Debré ; beaucoup lui ont fait confiance. Ils avaient tort. Adoptée en avril 1998 par la majorité socialiste (« courageusement », les communistes s’abstiennent et les Verts ne prennent pas part au vote), la loi Chevènement n’améliore qu’à la marge les dispositifs mis en place par la droite : suppression du certificat d’hébergement, élargissement relatif des conditions d’attribution des titres de séjour, assouplissement du régime des mariages mixtes et du regroupement familial. Quant à la régularisation annoncée des sans-papiers, elle ne concernera finalement qu’un peu plus de la moitié de ceux qui en avaient fait la demande. Comme à l’accoutumée, le PS essaye de neutraliser son électorat antiraciste au moyen de quelques concessions tout en relayant la résistance populaire blanche ; un exercice d’équilibrisme d’autant plus difficile à réaliser que cette dernière ne cesse de se radicaliser. Résultat : à la présidentielle d’avril 2002, Jospin s’écroule ; la droite et l’extrême droite se retrouvent face à face au second tour. Jacques Chirac est élu à plus de 80 % des voix et Nicolas Sarkozy est nommé ministre de l’Intérieur. Sans surprise, sa principale mission est de régler, une fois pour toutes, le problème de l’immigration. Il ne se fera pas prier… On connaît la suite : nouvelles lois, décrets, circulaires, consignes occultes, tous les moyens politiques, administratifs et policiers sont déployés pour débusquer et expulser les immigrés en situation irrégulière, pour dissuader de nouvelles immigrations et pour rendre invivable le séjour des immigrés et de leurs descendants. Je ne m’y étendrai pas. Ce qu’il m’importe de souligner, c’est que la politique sarkozyste de l’immigration ne tombe pas du ciel. Elle n’est pas non plus – sinon dans sa « franchise » – une politique spécifique à la droite. Dès le début des années 1980, alors que les socialistes régnaient tout-puissants à la tête de l’État, s’est construit progressivement un consensus entre les principaux partis blancs articulant répression de l’immigration et « intégration » des « beurs ». Ce consensus est le contenu de ce qu’on pourrait appeler le premier axe de l’offensive blanche contre les indigènes.
Le deuxième axe de cette offensive est la réforme du Code de la nationalité. Si sur cette question, comme sur d’autres, des divergences existent entre la droite et la gauche, sur le fond, là encore, on peut parler d’un consensus. Revenons au milieu des années 1980, plus précisément à l’époque de la première cohabitation. Tandis que Charles Pasqua s’acharne contre l’immigration, Albin Chalandon qui occupe le ministère de la Justice a pour tâche de cadenasser le Code de la nationalité de façon à fermer la porte de la nationalité française aux enfants issus de l’immigration. Jusque-là, les enfants nés en France de parents étrangers bénéficiaient automatiquement de la nationalité française. Désormais, selon la proposition du groupe RPR à l’Assemblée nationale, ils devraient faire acte de volonté pour obtenir le privilège de devenir français. Pas encore une demande de naturalisation, mais presque. La négation, de fait, du droit du sol. Une révolution du point de vue de la tradition républicaine universaliste. Le droit du sol, instauré par le premier Code de la nationalité en 1889, constitue en effet l’un des plus importants piliers du mythe de la « nation citoyenne » sur lequel repose la République. De toute évidence, la direction du RPR était allée trop loin, trop vite en tous les cas. La proposition Chalandon suscite un tollé. La situation est d’autant plus délicate pour la droite au pouvoir que le projet de réforme des universités provoque au même moment une puissante mobilisation étudiante. Chirac n’a guère le choix. Il recule. Le processus législatif est interrompu. Une commission de « sages », présidée par Marceau Long, est constituée pour définir les lignes d’un nouveau consensus blanc sur la nationalité. En janvier 1987, le projet Chalandon est enterré. Ce n’est qu’en 1993 que la droite pourra faire adopter une réforme, moins restrictive que celle annoncée quelques années plus tôt, mais qui ouvre néanmoins une première brèche dans le droit du sol [7] cours des campagnes électorales de 1995 et 1997, la gauche s’engage à revenir sur cette loi. Elle ne le fera que partiellement. C’est la loi Guigou sur la nationalité votée en mars 1998 qui, au prétexte du respect de l’autonomie de volonté de l’enfant né en France d’un parent étranger, l’autorise à sa majorité à décliner la nationalité française [8] réformes du Code de la nationalité telles qu’elles avaient été envisagées par la droite n’avaient que le tort d’être trop audacieuses. Trop franches pour la République. La gauche socialiste est favorable à la remise en cause du droit du sol, mais uniquement si elle avance masquée, seulement s’il est possible de la présenter comme une nouvelle expression du caractère démocratique et universaliste de la République. La droite, elle, est moins prudente. Elle est consciente que le droit du sol est l’un des dogmes républicains, constitutifs de l’« identité nationale », mais celle-ci lui paraît aujourd’hui menacée dans un autre de ses fondements, plus important encore : le privilège blanc-européen-chrétien. Valéry Giscard d’Estaing, homme de la droite libérale démocratique, l’avoue sans ambages. En conclusion d’une tribune intitulée « Immigration ou invasion ? », il affirmait ainsi, en 1991, la nécessité de revenir « à la conception traditionnelle de l’acquisition de la nationalité française, celle du droit du sang [9] Quels sont donc ces immigrés qui, non contents d’envahir le territoire français, occupent également la nationalité française ? Réponse : les musulmans [10]
Tout est là. Être français et musulman, du point de vue de l’« identité nationale » républicaine, est un oxymoron. Il n’est pas possible d’être l’un et l’autre à la fois. Tant, du moins, que la conception même de la nation, telle qu’elle s’est construite dans la République, n’est pas radicalement recomposée, tant que l’« identité nationale » articule privilège « gaulois » et privilège blanc-européen-chrétien. L’offensive contre les musulmans – et contre l’Islam, de manière générale [11] constitue ainsi l’un des volets de la défense de ce double privilège face au spectre indigène. C’est le troisième axe autour duquel s’est construit le consensus blanc.
Pour Thomas Deltombe qui étudie l’islamophobie médiatique, « ce sont les grandes grèves de l’industrie automobile, entre 1982 et 1984, qui marquent un tournant décisif dans les relations entre le gouvernement et les immigrés : la référence à l’islam va être utilisée par le gouvernement pour discréditer une grève qui n’a pas grand-chose de religieux. Alors que la grève des OS débute au printemps 1982 dans les usines Citroën et Talbot d’Aulnay-sous-Bois et de Poissy, les médias s’intéressent rapidement à l’aspect “islamique” de cette mobilisation que les leaders syndicaux habituels ont du mal à canaliser. Les mosquées d’entreprise […] tout à coup sur les écrans de télévision. Les photos des OS en prière s’étalent dans la presse écrite. Les caricaturistes transforment les cheminées d’usine en minarets. La rumeur gonfle d’une manipulation “intégriste”. La presse d’extrême droite, bien sûr, se défoule contre les ouvriers “khomeynistes” ». Gaston Deferre, le ministre socialiste de l’Intérieur, évoque « les grèves saintes d’intégristes, de musulmans, de chiites ». Le lendemain, le Premier ministre, Pierre Mauroy, déclare : « Les principales difficultés qui demeurent sont posées par des travailleurs immigrés dont je ne méconnais pas les problèmes mais qui, il faut bien le constater, sont agités par des groupes religieux et politiques, qui se déterminent en fonction de critères ayant peu à voir avec les réalités sociales française [12]
Le front de l’islam est donc ouvert ; il prendra d’autant plus d’importance dans la stratégie du Pouvoir blanc que les nouvelles générations issues de l’immigration sont de plus en plus nombreuses à se revendiquer de la religion de leurs parents. En 1989, la fatwa iranienne contre Salman Rushdie, puis la première « affaire » du voile ont scellé ainsi une nouvelle étape dans la construction du consensus blanc, un consensus encore plus large désormais puisqu’il s’étend désormais jusqu’à une frange de l’extrême gauche. Le premier bénéficiaire en est le Front national. Le 26 novembre 1989, il obtient des scores exceptionnels aux élections législatives partielles à Dreux et à Marseille. À peine les résultats du scrutin sont-ils connus que le Premier ministre socialiste, Michel Rocard, déclare que la France ne peut pas « héberger toute la misère du monde [13], relayé par Mitterrand qui estime que « le seuil de tolérance a été atteint dans les années 1970 [14]. Jacques Chirac, pour sa part, affirme que la France a « un problème de saturation [15] ; il réclame la fermeture des frontières, davantage de répression à l’encontre de l’immigration irrégulière, la réforme du droit d’asile et du Code de la nationalité. Parler de l’islam en France, c’est bien parler de l’immigration !
Désormais l’offensive contre l’islam n’allait plus cesser de s’amplifier, scandée par les convulsions de la politique internationale et leurs incidences parfois meurtrières en France [16] 1993 à 1995, c’est la deuxième cohabitation. Jacques Chirac est de nouveau Premier ministre ; Charles Pasqua retrouve son portefeuille place Beauvau. Il ne ménagera aucun effort pour alimenter la peur de l’islam et justifier l’appui apporté par son gouvernement à la junte militaire algérienne qui, depuis l’« arrêt du processus électoral » en janvier 1992, mène une véritable guerre contre les organisations politiques islamistes. La gauche partage cette même orientation au nom de la défense de la laïcité et de l’émancipation des femmes. Bonne occasion également de réactiver la vieille division coloniale entre Kabyles et Arabes. Les premiers seraient des démocrates, laïcs, respectueux du droit des femmes. Vraiment civilisés. Les seconds, tout le contraire. À la rentrée 1994, le ministre de l’Éducation nationale, François Bayrou, annonce l’interdiction du voile dans les établissements publics. Le Conseil d’État annule la décision, mais la polémique est relancée. Une autre future candidate à l’élection présidentielle, Ségolène Royal, déclare alors sur France 2 :
« Je voudrais quand même rappeler que, pour le port du voile, on tue en Algérie. Je crois qu’on ne doit pas faire un amalgame entre tous les signes extérieurs de religion. Ce que je crois aussi, c’est qu’il faut s’interroger sur le degré de liberté de ces jeunes filles car, derrière le voile, je pense qu’il y a un mouvement politique d’adultes, l’islamisme, qui cherche quand même à subvertir l’école laïque et qui cherche surtout à subvertir l’égalité des droits pour les filles » [17]
Dans Les Damnés de la terre, Fanon mentionnait déjà ce type de discours coloniaux. « Là, écrivait-il, on entend à longueur de journée des réflexions odieuses sur le voile des femmes, sur la polygamie, sur le mépris supposés des Arabes pour le sexe féminin [18]
Dans le débat public, islam, immigration, banlieues, sécurité sont systématiquement associés. Thomas Deltombe souligne ainsi que les médias « insistent sur l’attraction “naturelle” des jeunes de banlieue pour les thèses islamistes [19]. En 1995, soupçonné d’être impliqué dans des attentats terroristes, Khaled Kelkal est tué de sang-froid par des policiers. Aux yeux du plus grand nombre, il est la preuve flagrante que les jeunes musulmans des cités ont une propension quasi naturelle à la violence. « La grande interrogation des médias, remarque encore Deltombe, va consister à se demander si le jeune homme a agi parce qu’il est “islamiste” ou parce qu’il est “de banlieue”. Pendant un mois, l’islam devient un phénomène de banlieue et la banlieue un quasi-phénomène islamique, dont Kelkal serait le symbole [20]
Je pourrais poursuivre, faire le récit détaillé de tous les prétextes qui ont été impudemment utilisés par les forces politiques blanches, leurs intellectuels et leurs médias afin de réactiver les plus abjectes représentations coloniales – du barbare qu’il faut supplicier au sauvage à civiliser. Dans la République laïque, on n’ose guère en appeler publiquement au souvenir des croisades, mais, incidemment, par petites touches, entre les mots, le message subliminal est le même que celui qu’énonce clairement George Bush : la civilisation chrétienne est menacée par les hordes musulmanes. La fureur islamophobe, attisée par les attentats du 11 septembre 2001 et le nouveau colonialisme américain, atteint son comble en 2003 avec l’affaire des sœurs Alma et Lila Levy [21] loi contre le voile [22] la sordide campagne contre Tariq Ramadan. De l’extrême droite à l’extrême gauche, le front blanc se resserre. Rares seront ceux, principalement au sein de la gauche radicale, qui prendront alors le risque de s’écarter du consensus blanc.
L’offensive islamophobe a pris diverses formes : répressive, idéologique, mais aussi intégrationniste. L’intégrationnisme, comme tactique politique coloniale, a deux facettes. Elle consiste, rappelons-le, à semer le trouble dans la conscience des colonisés, à dissoudre leurs identités, à camoufler les inégalités statutaires. Elle consiste aussi à diviser les colonisés, à promouvoir en leur sein des élites et des flics qui auront la charge de les encadrer et de les contrôler, notamment au travers d’instances particulières de représentation, enchâssées dans les dispositifs institutionnels du Pouvoir blanc. Si la première facette de cette tactique prend la forme de la valorisation de l’« islam modéré », de la promotion des musulmans « modernistes », des musulmanes « émancipées », sa seconde facette, à la fois complémentaire et antagonique, à peine ébauchée à l’époque giscardienne, a commencé à être sérieusement mise en œuvre par le ministre socialiste de l’Intérieur Pierre Joxe, qui instaure en 1989 l’éphémère Conseil de réflexion sur l’islam en France (Corif). Les velléités d’organisation du culte musulman, sous l’égide de l’État, seront poursuivies par tous les ministres de l’Intérieur qui lui ont succédé. Charles Pasqua, Jean-Louis Debré, Jean-Pierre Chevènement et, enfin, Nicolas Sarkozy, le plus malin de tous, auquel nous devons le Conseil français du culte musulman (CFCM) qui est parvenu à rassembler les principales organisations musulmanes sous le patronage du ministère de l’Intérieur. En échange de leur « loyalisme », des efforts qu’elles mènent pour vider l’islam de tout esprit de rébellion, de leur collaboration à la politique de surveillance des populations musulmanes notamment dans les cités, ces organisations se voient accorder une légitimité institutionnelle, quelques concessions destinées à faciliter les pratiques cultuelles, et, bien sûr, le partage entre elles – et non sans tensions – du « marché » de l’islam français. Aziz Zemmouri et Vincent Geisser ont mis en évidence l’inspiration que cette politique a puisée dans la gestion de l’islam colonial [23] similarité de leurs substrats idéologiques et des finalités qui les animent. « Dès les premiers temps de la conquête, écrivent-ils, l’administration coloniale tenta d’imposer un “clergé musulman” – la formule était employée par certains administrateurs coloniaux –, censé servir loyalement les intérêts de la France [24] À travers la « fonctionnarisation » des « clercs musulmans », expliquent-ils, il s’agissait de garantir leur soutien aux autorités coloniales « et surtout de prévenir toute tentative de résistance religieuse ». Hier comme aujourd’hui, l’officialisation de la représentation de l’islam sous la tutelle de l’administration « avait pour contrepartie logique une politique de surveillance et de répression des religieux dits “indépendants”, dont les activités étaient jugées subversives ». L’organisation d’une représentation institutionnalisée de l’islam s’est accompagnée de la volonté de développer des structures officielles de formation d’« imams sur mesure » et d’étouffer les associations soucieuses de favoriser l’épanouissement d’un islam indépendant. La politique du gouvernement à cet égard est relayée par les instances intermédiaires de l’État, collectivités locales et municipalités, principales médiations de la résistance populaire blanche dans les quartiers qui, souvent en s’appuyant sur les rapports fournis par les Renseignements généraux, « pratiquent une forme de favoritisme à l’égard de certaines associations musulmanes réputées “modérées” et “présentables”, au détriment d’autres “peu fréquentables”, auxquelles on accole assez facilement les étiques d’“intégristes” et/ou de “fondamentalistes”. Les cas de villes comme Montpellier, Marseille ou Vénissieux sont exemplaires de cette gestion autoritaire, où les maires tentent de promouvoir un “islam municipal”, loyal et fidèle, ostracisant dans le même temps toutes les autres organisations musulmanes [25].
On aurait tort, cependant, de ne voir dans l’islamophobie contemporaine que les flatulences tardives d’une vieille peur chrétienne de l’« islam conquérant ». Ses puanteurs sont les mêmes, mais ce qui fermente dans les boyaux de l’islamophobe, ce n’est pas la haine de l’islam en tant que croyance. Celle-ci est bien plus le produit de la politique islamophobe que sa motivation initiale. Il ne s’agit pas tant de défendre ou d’étendre la chrétienté pour elle-même que d’en consacrer la mémoire comme l’une des composantes de la blanchitude. Les islamophobes qui nous disent n’avoir pour ennemi que l’« islam radical » ne sont donc hypocrites qu’à moitié. Ils ne défendent pas la chrétienté contre l’islam ; ils défendent la suprématie blanche dans la forme relativement sécularisée qui est la sienne aujourd’hui. L’« islam radical », du point de vue de ces républicains, c’est tout bonnement l’islam indocile, rétif à l’occidentalisation, l’islam creuset d’une dissidence indigène. Le musulman qui veut pouvoir exprimer son islamité dans l’espace public est pour eux un islamiste radical non pas parce qu’il remettrait en cause la laïcité, mais parce qu’il incite les indigènes à s’affirmer dans l’espace public. Il est un terroriste non pas parce qu’il assassine des « victimes innocentes », mais dès lors qu’il s’introduit par effraction dans l’espace public. Peu leur importe que Tariq Ramadan soit favorable ou non à la lapidation ; à leurs yeux, il est un « intégriste », il entretient des liens avec le « terrorisme », parce qu’il dit aux musulmans : ne restez pas en dehors de l’espace public, faites de la politique. Quand les islamophobes dénoncent le « prosélytisme musulman », ils ne parlent pas tant de prosélytisme religieux que d’incitation à l’occupation indigène de l’espace public. Quand ils interdisent le voile à l’école, ils interdisent l’accès de l’espace public aux indigènes qui rechignent à être « beurisés ». Quand ils assurent défendre l’émancipation des femmes musulmanes tout en respectant leur foi, c’est encore un leurre : ils veulent, en fait, interdire aux femmes leur émancipation en tant qu’indigènes. Les musulmans (et plus largement les indigènes) ne sont les bienvenus dans l’espace public qu’à la stricte condition qu’ils s’en prennent à d’autres musulmans, c’est-à-dire qu’ils se battent contre eux-mêmes. La République est une religion islamophobe. L’islamophobie ne combat pas le musulman en tant que musulman mais le musulman en tant que rebelle potentiel à l’ordre blanc – et c’est pourquoi tout musulman est un intégriste ou un terroriste en puissance. Elle ne se développe pas principalement dans le champ de l’intolérance religieuse mais dans celui de la lutte raciale. Elle ne constitue donc qu’un volet de cette contre-offensive coloniale qui est menée contre l’ensemble des indigènes et, plus particulièrement, contre l’espace privilégié de leurs résistances, les cités populaires où se nouent les différentes facettes de la politique sécuritaire.
La politique sécuritaire constitue le quatrième axe autour duquel s’est construit le consensus blanc. Articulant participation aux mécanismes de guerre contre le « terrorisme islamique » à l’échelle internationale, répression contre l’islam dit radical en France, sécurisation des frontières européennes et françaises contre les migrations illégales, dispositifs de lutte contre les immigrés clandestins au sein de l’Hexagone, sélection, surveillance, pressions policières contre l’immigration régulière, expansion, consolidation, diversification, rationalisation, modernisation des instruments policiers et des procédures judiciaires destinés à combattre l’« insécurité » dans les quartiers populaires, la gauche molle et la droite dure ont fabriqué ainsi une gigantesque machine de guerre, aux multiples ramifications dans toutes les sphères de la vie sociale, dont l’un des principaux objectifs est de contrer la Puissance politique indigène. La France n’a pas eu ses tours jumelles, elle a eu les sœurs Levy. Elle n’a pas eu son Kaboul, elle a eu Clichy-sous-Bois. Elle n’a pas eu son « nouvel Hitler », elle a eu ses « racailles ». Elle n’a pas eu sa « Tempête du désert », elle a eu le couvre-feu colonial. Elle n’a pas eu son « Grand Moyen-Orient démocratique », elle a son « Plan banlieue ». Elle n’a pas son Jalal Talabani, elle a sa Fadela Amara. Elle n’a pas ses « marines », elle a ses BAC. Elle n’a pas eu Bush, elle a son Sarkozy. Mais la politique de ce dernier pour mater les quartiers remonte loin dans le temps.
La thématique de la délinquance des jeunes habitants des quartiers apparaît au tournant des années 1970 et 1980, notamment à la suite des émeutes de 1981. La problématique de « l’insécurité » devient progressivement un enjeu électoral majeur. Elle structure les polémiques de campagne à l’occasion des municipales de 1983, des législatives de 1986 et resurgit depuis à chaque élection. Destinée en apparence à répondre à l’inquiétude grandissante des Français face aux « incivilités » et à la « violence urbaine », elle modèle elle-même cette inquiétude et contribue à élargir et radicaliser la résistance populaire blanche. Le consensus entre la droite traditionnelle et la gauche de gouvernement ne se réalise que progressivement concernant les formes de coercition et de contrôle à imposer aux habitants des cités. Le tournant, c’est la résistance indigène qui s’est exprimée sous la forme des révoltes de Vaulx-en-Velin, dans la banlieue de Lyon, en octobre 1990 puis, dans la banlieue parisienne, à Sartrouville, Mantes-la-Jolie, Meaux, Garges-lès-Gonesse, entre mars et juillet 1991. Cependant, les socialistes réagissent eux aussi à la pression populaire blanche. Ainsi, en 1995, Gérard Le Gall, l’un des « experts » du Parti socialiste chargé d’analyser les mouvements de l’opinion publique, rédige de nombreux rapports destinés à attirer l’attention de ses dirigeants sur la nécessité de « durcir » leur discours sur « l’immigration et l’insécurité » pour « reconquérir » les votes « populaires [26]. Ses propositions triomphent en juin 1997 lorsque Lionel Jospin, alors Premier ministre dans le cadre de la troisième cohabitation, déclare que la « sûreté » sera la « seconde priorité » de son gouvernement, la première étant la question du chômage. Quelques mois plus tard, au congrès de Villepinte du PS, il récidive. Comme à l’accoutumée, la stratégie raciste se couvre du manteau des Lumières : « La sécurité est une valeur de gauche » ne craint pas d’affirmer le Premier ministre ; elle est inscrite dans le « droit à la sûreté » de la Déclaration des droits de l’homme [27] pas est franchi : droite et gauche partagent désormais la même conception de la sécurité. Ne subsisteront que des divergences mineures, parfois gonflées artificiellement pour des impératifs électoraux. Au lendemain de la destruction des tours jumelles, le socialiste Daniel Vaillant, qui succède à Chevènement au ministère de l’Intérieur, concocte la loi sur la Sécurité quotidienne (LSQ) qui est adoptée à la quasi-unanimité par les parlementaires [28] officiellement comme une arme contre le terrorisme, elle contient également des dispositions répressives à l’encontre des habitants des cités. On lui doit notamment l’interdiction des rassemblements dans les cages d’escalier ! Droite et gauche rivalisent ainsi d’ardeur pour convaincre leurs électeurs qu’ils sont les mieux à même d’assurer leur sécurité. Dans sa « Chronique », déjà citée, le collectif LMSI relève que « les thèmes de la “violence” et de l’“insécurité” sont les thèmes les plus abordés par les cinq principaux candidats : Jacques Chirac, Lionel Jospin, François Bayrou, Jean-Pierre Chevènement, Jean-Marie Le Pen ». Comme elle l’avait emporté aux municipales qui ont suivi de peu les attentats du 11 septembre 2001, la droite, plus homogène sur cette question, remporte la présidentielle de 2002. Pour expliquer la défaite de son candidat dès le premier tour, le PS incriminera la pluralité des candidatures à gauche. L’explication est ailleurs. De nombreux électeurs probables du PS, soucieux avant tout de la dégradation réelle ou potentielle de leurs conditions économiques, se sont abstenus ou ont voté pour les candidats d’extrême gauche, pour exprimer leur défiance à l’encontre du ralliement des socialistes au néolibéralisme. Les autres électeurs, mobilisés autour de l’« insécurité », de l’immigration, de l’islam, ont reporté leur confiance sur les candidats qui paraissaient les plus déterminés. La présidentielle de 2002 a représenté ainsi la première échéance électorale majeure à l’occasion de laquelle un vote racial s’est montré capable de faire basculer les rapports de forces politiques.
À peine installée, la nouvelle majorité de droite prépare les échéances électorales suivantes. Dès l’automne 2002, est adoptée la première loi Perben sur la « délinquance des mineurs » qui durcit les dispositifs sécuritaires mis en place par les socialistes. À l’hiver 2004, son caractère répressif est encore accentué par la loi sur la « criminalité organisée », dite « loi Perben II ». Nicolas Sarkozy, pour sa part, ambitionne déjà d’être candidat à l’élection présidentielle. Nommé ministre de l’Intérieur, il organise sa stratégie principalement autour de l’aiguisement de la lutte des races sociales, espérant – à juste titre – séduire les électeurs du Front national. La sécurisation symbolique des Blancs est nécessairement sa priorité. Et pour sécuriser les Blanc, il faut naturellement terroriser les non-Blancs. J’ai mentionné plus haut les différents volets de la stratégie qu’il met en œuvre, notamment vis-à-vis de l’immigration. Mais l’arène principale où la résistance blanche entre en collision avec la résistance indigène, ce sont les cités populaires. C’est donc là que se portent avant tout les efforts du ministre de l’Intérieur, avec l’appui explicite des socialistes Julien Dray et Daniel Vaillant. Partout où les indigènes sont présents, la répression s’intensifie, le quadrillage policier est renforcé, la surveillance s’accroît, l’arsenal dont disposent les différents corps de police se « militarise ». Dans les « quartiers sensibles » se met en place un état d’exception permanent. Mais Sarkozy est un fin manœuvrier. Peut-être aussi est-il mal « intégré ». Ou plus « cosmopolite blanc », comme ses amis patrons, que nationaliste à la manière d’un de Gaulle. Il est bien sûr d’abord un homme d’État ; il appartient à l’État et en défend les intérêts. Quoi qu’il en soit, il se montre plus souple avec les dogmes républicains que d’autres responsables politiques, n’hésitant pas à prôner la « discrimination positive » et à préconiser la promotion d’élites issues des cités et de l’immigration, préfigurant ainsi la nomination de ministres indigènes et le Plan banlieue. De même, au risque de se faire accuser de « communautarisme », il cherche à se concilier les musulmans pour arracher des voix aux socialistes vers lesquels se portent généralement la majorité des électeurs issus de l’immigration. Le CFCM est aussi là pour ça. De son côté, le ministre du Logement, Jean-Louis Borloo, mène l’offensive sur un autre plan, celui du nettoyage des banlieues, de la dispersion des indigènes dans l’espace urbain et de la relégation des moins chanceux d’entre eux à l’extrême périphérie des villes au nom de la « mixité sociale » et de la « rénovation urbaine ». La gauche institutionnelle, dont la force réside dans le réseau des municipalités que contrôlent ses élus, ne s’y oppose pas. Elle avait été à l’initiative de la Politique de la ville et des différents dispositifs d’aménagement urbain dont les logiques ont puissamment contribué à flétrir les populations des banlieues et à exacerber les différenciations raciales. J’y reviendrais plus précisément au chapitre suivant ; qu’il me suffise ici de souligner que la politique urbaine est le cinquième axe autour duquel s’est construit le consensus blanc.
S’il fallait encore douter du sens de la politique menée par les principales instances de l’État français, il suffirait d’évoquer la campagne idéologique destinée à raviver la dimension coloniale de l’« identité nationale ». La réhabilitation de la colonisation constitue, ainsi, le sixième axe autour duquel s’est construit le consensus blanc. Quelle différence y a-t-il, en effet, entre Sarkozy déclarant, à Dakar, « le drame de l’Afrique, c’est que l’homme africain n’est pas assez entré dans l’histoire » et Chevènement affirmant : « La colonisation est aussi le moment où le continent africain a été entraîné dans la dynamique de l’Histoire universelle [29] ? Initiée depuis le début des années 1990, cette offensive s’est déployée plus particulièrement – cela n’est pas pour nous étonner – au lendemain des attentats du 11 septembre 2001 pour connaître un nouvel essor à la suite de la révolte de novembre 2005. Le premier moment fort en a été la fameuse loi du 23 février 2005 qui envisageait de réintroduire l’enseignement de l’« œuvre positive » accomplie par la France dans les colonies [30] alinéas les plus problématiques de cette loi ont finalement été abrogés à la suite des protestations de nombreux intellectuels et associations mais, sous d’autres formes – discours de responsables politiques, publications d’articles et d’ouvrages, initiatives délocalisées à l’échelle municipale (commémorations diverses, musées, etc.) –, la réhabilitation du colonialisme est devenue l’une des préoccupations principales du Pouvoir blanc, vaguement dissimulée derrière le souci de dissocier les méthodes les plus violentes de l’expansion coloniale de la vérité républicaine, nécessairement salutaire pour les colonisés. Tout immigré, ou enfant d’immigré, porte en lui la colonisation. Et la colonisation porte en elle la condamnation de la République. Politique et morale. La « repentance » n’est pas la décolonisation. Ni de la République ni de l’immigré. Elle clôt une histoire seulement en apparence : « Allez, je demande pardon et n’en parlons plus ! » Elle clôt et elle ouvre. La repentance appelle en effet d’autres exigences. Le pardon n’est pas conciliable avec la récidive. Or la République ne vit que dans la récidive. Le Noir, l’Arabe, le musulman est toujours un indigène. L’identité de la République, c’est la colonisation ; c’est-à-dire la hiérarchie raciale. Lorsque Sarkozy associe immigration, identité nationale et dénonciation de la repentance, il dénonce la République. C’est de la délation. Il y a toujours une part de vérité dans les paroles de nos adversaires. La colonisation, c’est aussi l’esclavage. Et parler de l’esclavage, c’est dire la responsabilité de l’État français. De la monarchie ou de l’Empire napoléonien, peu importe !, la République révisionniste ne veut pas en entendre parler. Toute l’« histoire de France » est sacrée. Même Clovis, ce maladroit, est sacré. Y porter atteinte serait porter atteinte à l’« identité nationale ». Sous la pression des mobilisations antillaises, les parlementaires ont consenti tout de même à adopter le projet de loi Taubira [31] ils l’ont auparavant vidé de sa substance. La traite et l’esclavage sont certes reconnus comme « crimes contre l’humanité », mais la France n’avait pas de responsabilités particulières ; l’article sur les réparations, quant à lui, passe à la trappe ; les engagements pris concernant l’enseignement de l’esclavage à l’école sont vite oubliés. En 2006, à la suite d’une déclaration du président Chirac, la date du 10 mai est retenue pour « honorer le souvenir des esclaves et commémorer l’abolition de l’esclavage ». C’est surtout une manière d’honorer la République qui a aboli l’esclavage en 1848. Mais c’est aussi une petite avancée, reflet à la fois des luttes antillaises et des politiques destinées à les neutraliser. Sur cette question, comme sur d’autres, un consensus s’est également établi entre les différentes factions du Pouvoir blanc. Car derrière la question de l’esclavage, il y a un autre enjeu : empêcher la jonction entre les luttes des Antillais et celles des descendants de l’immigration maghrébine qui vivent souvent dans les mêmes quartiers. Dès lors, les publicistes blancs s’attachent à dissocier l’esclavage de la colonisation de l’Afrique et des Amériques. La responsabilité européenne et française est dissoute dans la dénonciation indistincte d’un esclavage qu’aurait pratiqué l’ensemble des civilisations et, plus particulièrement, la… civilisation arabo-musulmane ! Déshistoricisée, la reconnaissance de l’esclavage comme crime contre l’humanité perd toute dimension éthique et, surtout, politique. Elle devient simplement l’expression des valeurs de l’humanisme et, plus exactement, une nouvelle profession de foi de l’« esprit des Lumières », étendard de la modernité occidentale ; tandis que s’affirme la volonté d’opposer, à l’Arabe méchant, paresseux, voleur, fourbe, violent et abominable esclavagiste, le bon Nègre, pacifique, docile et travailleur. Mais la manœuvre est encore plus complexe. Le Pouvoir blanc s’applique également à nourrir une autre ligne de clivage : celle qui oppose le Nègre sauvage d’Afrique, « traverseur » illégal de frontières, musulman et polygame, arrière-petit-fils d’un chef de tribu esclavagiste, au Nègre domestique des Antilles, français depuis quatre siècles et fier de l’être, bonifié par quelques gouttes de sang blanc dans les veines, fréquentant assidûment son église, amoureux de la France et de la République, soucieux enfin de « partager sa mémoire » douloureuse. J’ai utilisé à dessein ces stéréotypes les plus éculés qui remontent à l’esclavage et à la colonisation. Car même si, pour la plupart, ils ne sont que rarement employés de manière aussi crue, il suffit de prêter un peu d’attention au discours tenu par de très nombreux responsables politiques, intellectuels et autres journalistes pour débusquer sans difficulté les pires représentations coloniales.
Le caractère racialiste de la politique visant à fragmenter les indigènes, issue d’histoires coloniales différentes, ne procède pas seulement de sa finalité, en l’occurrence préserver la suprématie blanche ; il est déjà contenu dans l’idéologie qui l’innerve.
Notes
[1] Au-delà encore, et c’est aujourd’hui de plus en plus manifeste, de nouvelles contraintes sont exercées à l’égard des anciennes colonies pour leur faire porter le fardeau de la répression de l’émigration.
[2] Patrick Weil note que « le vote divergent en seconde lecture ne remet pas en cause les fondements de l’accord : il ne sera dû qu’à l’effet politique que produit le score du Front national aux élections européennes ». Autrement dit, la droite fait de la surenchère électorale mais, quant au fond, le consensus blanc est bien établi (P. Weil, Qu’est-ce qu’un Français ?, op. cit., p. 286.
[3] Ibid., p. 289.
[4] Saïd Bouamama explique très bien cela dans son livre Dix ans de marche des Beurs. Chronique d’un mouvement avorté, Paris, Desclée de Brouwer, 1994.
[5] Wole Soyinka, Que ce passé parle à son présent. Discours de Stockholm, Paris, Belfond, p. 87.
[6] Le 9 avril 1986. Cité par L. Mathieu, La Double Peine, op. cit., p. 139.
[7] La réforme du Code de la nationalité instaure le volontariat pour l’acquisition de la nationalité française chez les jeunes nés en France de parents étrangers et restreint le droit du sol. Désormais, « le jeune né en France de parents étrangers devra – entre 16 et 21 ans – manifester sa volonté d’être français, au lieu que la nationalité française lui soit attribuée automatiquement à sa majorité. […] ce qui concerne l’acquisition par mariage, la loi adoptée impose dorénavant à l’époux de Français un délai de deux ans au lieu de six mois s’il veut devenir français par déclaration. Enfin, vexation significative, un enfant né en France d’un parent né en Algérie avant 1962 ne se verra attribuer la nationalité française à la naissance – par effet du double jus soli – que si ce parent apporte la preuve qu’il réside en France depuis au moins cinq ans » (Patrick Weil, Qu’est-ce qu’un Français ?, op. cit., p. 176).
[8] « La nouvelle législation, adoptée en 1998, a voulu opérer une synthèse entre le principe d’égalité d’accès à la nationalité française (institué par la loi de 1889) et l’exigence de l’autonomie de la volonté (renforcée en 1993). Le principe d’égalité est réaffirmé, puisque la loi prévoit qu’à 18 ans, tout enfant né en France d’un parent étranger est français, s’il réside toujours en France et s’il y a résidé pendant son adolescence. La résidence de cinq ans toujours exigée peut être discontinue entre l’âge de 11 ans et de 18 ans. […] l’autonomie de la volonté du jeune est aussi mieux respectée. Le pouvoir des parents de déclarer leurs enfants français durant leur minorité sans leur approbation n’a pas été rétabli […] les six mois qui précèdent son dix-huitième anniversaire et surtout pendant l’année qui le suit – alors donc qu’il est majeur –, l’adolescent peut déclarer qu’il veut rester étranger et décliner la qualité de Français. Enfin, dès l’âge de 13 ans et jusqu’à 18 ans, il peut devancer la reconnaissance par l’État de sa qualité de Français et manifester sa volonté d’être français (avec l’autorisation de ses parents entre 13 et 16 ans) » (ibid., p. 181).
[9] Le Figaro-magazine du 21 septembre 1991.
[10] Selon Rémy Leveau et Catherine Wihtol de Wenden, le fil caché des controverses qui ont accompagné la réforme Chalandon pourrait être résumé en une seule question : « Comment peut-on être français et musulman ? », Rémy Leveau, Catherine Wihtol de Wenden, La Beurgeoisie. Les trois âges de la vie associative issue de l’immigration, Paris, CNRS éditions, 2001, p. 65.
[11] Un aveu parmi d’autres, la tribune d’Alain Juppé intitulée « Peut-être n’évitera-t-on pas un conflit avec l’islam ? » (Libération, 29 nov. 2004.)
[12] Th. Deltombe, L’Islam imaginaire, op. cit., cité p. 50. La référence au chiisme est évidemment inspirée de la révolution iranienne. Les événements au Moyen-Orient ont en effet des répercussions directes en France où ils alimentent l’islamophobie. Ainsi, l’engagement des troupes françaises depuis septembre 1982 dans le cadre d’une « force multinationale » stationnée au Liban a des implications immédiates : enlèvement de ressortissants français, successions d’attentats à Paris et Marseille. Les Palestiniens et les musulmans libanais sont présentés comme de terribles barbares face auxquels les chrétiens du Liban et l’État d’Israël se défendent comme ils peuvent.
[13] « Sept sur Sept », TF1, 3 décembre 1989, cité dans Th. Deltombe, L’Islam imaginaire, op. cit., p. 118.
[14] Allocution présidentielle, TF1, Antenne 2, 10 décembre 1989, cité dans Th. Deltombe, L’Islam imaginaire, op. cit., p. 118.
[15] JT de 20 heures, TF1, 8 décembre 1989, cité dans Th. Deltombe, L’Islam imaginaire, op. cit., p. 118.
[16] Vague d’attentats au milieu des années 1990.
[17] Le 25 octobre 1994, Th. Deltombe, L’Islam imaginaire, op. cit., cité p. 230.
[18] F. Fanon, Les Damnés de la terre, Paris, La Découverte, 2004, p. 156.
[19] Th. Deltombe, L’Islam imaginaire, op. cit., p. 205.
[20] Ibid., p. 244.
[21] À la rentrée 2003, les deux élèves sont exclues par le conseil de discipline du lycée d’Aubervilliers parce qu’elles refusent d’ôter leurs voiles. Depuis les mois de mai-juin, la polémique sur le voile avait été relancée par le gouvernement de droite dans le contexte d’un puissant mouvement de grève contre la réforme des retraites. Le PS n’est pas en reste : Jack Lang dépose une proposition de loi visant à interdire le port du « foulard » à l’école. Pour sa part, le 18 mai, devant le Congrès du PS à Dijon, Laurent Fabius défend l’interdiction des « signes religieux ostentatoires » à l’école et dans l’espace public.
[22] La loi sur la laïcité, voté en mars 2004, interdit le port de tout signe religieux « ostensible » à l’école.
[23] Esther Benbassa, pour sa part, note la prégnance du modèle napoléonien d’institutionnalisation d’une forme de représentation des juifs français.
[24] A. Zemouri, V. Geisser, Marianne et Allah. Les politiques français face à la « question musulmane », Paris, La Découverte, 2007, p. 82.
[25] Ibid., p. 26.
[26] Chronologie LMSI.
[27] Ibid.
[28] La LSQ a été votée le 15 novembre 2001.
[29] « Ripostes », France 5, 2002.
[30] Contrairement à ce qu’elle prétend, la gauche parlementaire a, dans un premier temps, approuvé la loi du 23 février. Pour les conditions de son adoption et les réactions qu’elle a suscité, voir Romain Bertrand, Mémoires d’empire. La controverse autour du « fait colonial », Paris, éditions du Croquant, 2006. Si les analyses proposées dans la deuxième partie de l’ouvrage sont très contestables, notamment concernant les positions du Mouvement des Indigènes de la République, ce livre regorge néanmoins d’informations utiles.
[31] Il s’agit de la loi de 2001 « reconnaissant la traite et l’esclavage du xve au xixe siècle en tant que crime contre l’humanité ».