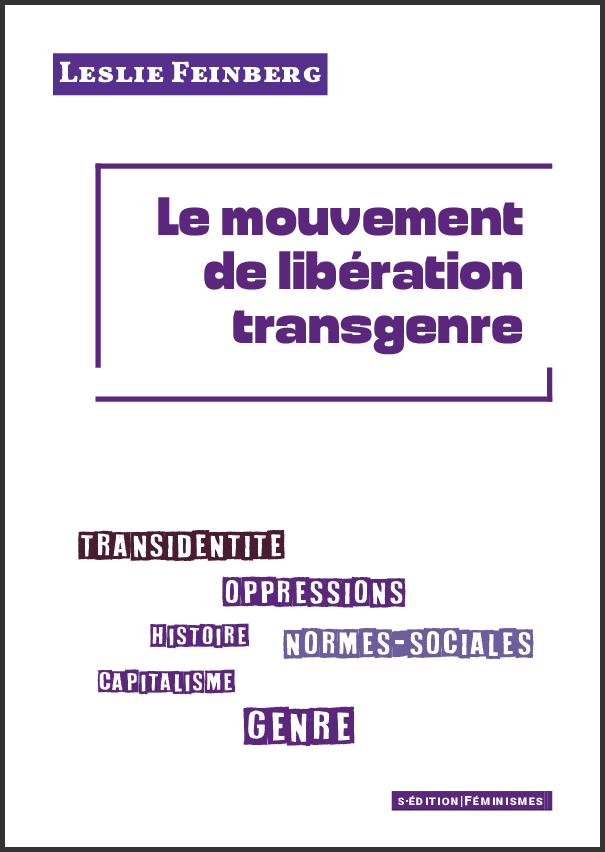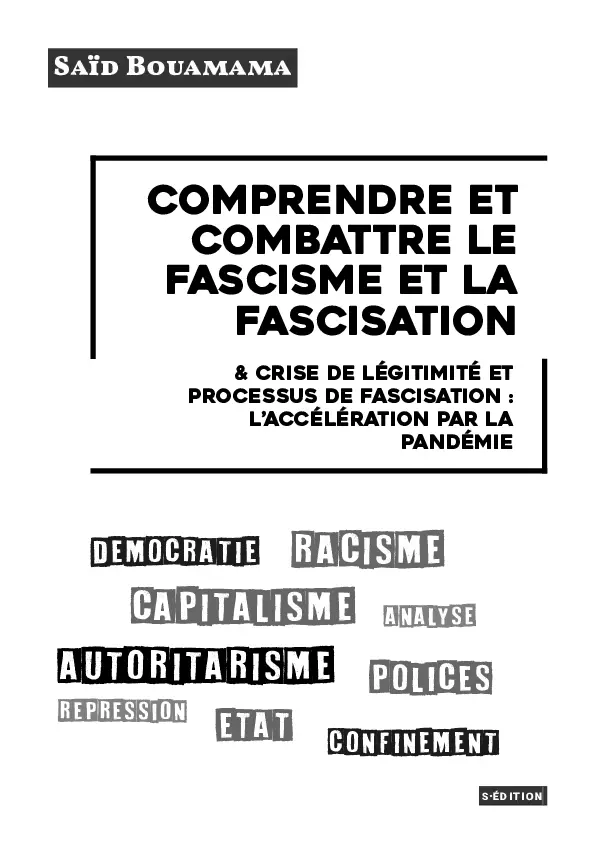Silvia Federici — La revolution feministe inachevée
Temps de lecture : ~ 53 minutes
Voici le premier chapitre du livre de Silvia Federici : Point zéro : propagation de la révolution. Salaire ménager, reproduction sociale, combat féministe (Editions iXe, 2016, 264 p., 20€).
Titre original : « The reproduction of labor power in the global economy and the unfinished feminist revolution ». Communication présentée le 27 janvier 2009 à l’Université de Californie à Santa Cruz, lors d’un colloque sur « La crise de la reproduction sociale et le combat féministe ».
Il est disponible en ligne sur le site contretemps.eu
Le travail des femmes et leur force de travail sont enfouis au plus profond des structures sociales et économiques du capitalisme. (David Staples, No place like home)
Le capitalisme a sans aucun doute entraîné la surexploitation des femmes. Ce serait tout simplement affligeant s’il s’était ainsi contenté d’accroître la misère et l’oppression mais, par chance, il a aussi nourri des résistances. Et le capitalisme a compris que s’il s’obstinait à le ignorer ou cherchait à les briser, ces résistances risquaient de se radicaliser toujours plus, jusqu’à finir par former un mouvement pour l’indépendance, voire le noyau d’un nouvel ordre social. (Robert Biel, The new imperialism)
Un nouveau facteur de libération apparaît dans le tiers monde : la force productive non rémunérée des femmes qui ne sont pas encore déconnectées de la vie économique par leur travail. Elles sont au service de la vie, pas de la production de marchandises. Elles sont le socle invisibilisé de l’économie mondiale : on estime à 16 000 milliards de dollars l’équivalent en salaire de ce travail au service de la vie. (John McMurtry, The cancer state of capitalism)
D’avoir trop pilonné, le pilon s’est cassé net. Demain je rentre à la maison. Jusqu’à demain, jusqu’à demain… J’ai pilonné tant et tant que demain je rentre à la maison. (Chanson de femmes haoussa (Nigeria))
Introduction
Ce qui suit est à la fois une lecture politique de la restructuration de la (re)production de la force de travail dans l’économie mondiale, et une critique féministe de Marx, développée sous différentes formes depuis les années 1970. Cette critique a été élaborée par des activistes de la campagne Wages For Housework, en particulier par Mariarosa Dalla Costa, Selma James, Leopoldina Fortunati, puis, plus tard, par Ariel Salleh, en Australie, et par les féministes de l’école de Bielefeld, dont Maria Mies, Claudia Von Werlhof et Veronica Bennholdt-Thomsen. L’argument qui lui a donné corps dit en substance que l’analyse du capitalisme telle que l’a développée Marx pâtit de son incapacité à imaginer, à côté de la production de marchandises, d’autres formes de travail productrices de valeur, et subséquemment de son impuissance à voir que le travail reproductif non rémunéré des femmes occupe une place importante dans le processus d’accumulation capitaliste. Cette tache aveugle l’empêche de saisir pleinement l’ampleur de l’exploitation capitaliste de la main-d’œuvre et la fonction du salaire dans la création de divisions au sein de la classe ouvrière, à commencer par les relations entre hommes et femmes. Si Marx avait vu que le capitalisme doit pouvoir compter sur une somme faramineuse de travail domestique accompli « à titre gracieux » pour la reproduction de la main-d’œuvre, et, parallèlement, sur la dévalorisation de ces activités reproductives pour diminuer le coût de la force de travail, il aurait peut-être été moins tenté de penser que le développement capitaliste est inévitable et progressif. Quant à nous, cent cinquante ans après la publication du Capital nous avons au moins trois bonnes raisons de remettre en cause ce postulat du caractère inexorable et progressif du capitalisme.
Primo, en cinq siècles le développement capitaliste a épuisé les ressources de la planète au lieu de créer, conformément à la prédiction marxiste, les « conditions matérielles » de la transition vers le « communisme » par accroissement des « forces de production », sous forme de l’industrialisation à grande échelle. La « pénurie » – obstacle majeur, selon Marx, à la libération de l’humanité – n’est pas non plus devenue obsolète. La production capitaliste est au contraire directement responsable de la pénurie qui sévit aujourd’hui sur la planète entière. Deuxio, si l’organisation capitaliste de la production de marchandises vient apparemment renforcer la coopération entre travailleurs, en réalité elle les divise de multiples façons : en répartissant le travail de manière inéquitable, en utilisant le salaire pour conférer aux salariés un pouvoir sur les sans salaire, en institutionnalisant le sexisme et le racisme pour légitimer l’existence de régimes de travail différenciés au moyen de l’argument naturaliste de la différence. Tertio, à commencer par les révolutions mexicaine et chinoise, au siècle dernier les coups les plus rudes portés au système n’ont pas été uniquement ou surtout le fait des ouvriers de l’industrie – sujets révolutionnaires par excellence, pour Marx –, mais de mouvements paysans, indigènes, anticolonialistes, antiracistes et féministes. À l’heure actuelle, ses plus farouches adversaires se recrutent dans la petite paysannerie, parmi les squatters urbains, la main-d’œuvre ouvrière employée en Afrique, en Inde, en Amérique latine et en Chine. De plus, il faut le souligner, ces luttes sont aussi conduites par des femmes qui, contre toute attente, s’occupent de leurs proches indépendamment de la valeur que la vie de ces derniers a sur le marché, valorisent leur existence, veillent à la maintenir pour leur compte à eux, y compris quand les capitalistes les décrètent inutiles car ils n’ont pas besoin de cette force de travail.
Dans ces conditions, quelles perspectives la théorie marxiste peut-elle encore ouvrir pour guider, de nos jours, la « révolution » ? Mon analyse de la restructuration de la reproduction dans l’économie mondialisée m’oblige à poser la question. Je soutiens en effet que pour parler aux mouvements anticapitalistes du XXIe siècle, la théorie marxiste doit repenser la question de la « reproduction » en adoptant un point de vue planétaire. Réfléchir aux activités reproductives qui assurent la vie, cela dissipe l’illusion que l’automatisation de la production créera un jour les conditions matérielles d’une société sans exploitation : on comprend alors que ce n’est pas le manque de savoir-faire technologique qui fait obstacle à la révolution, mais les divisions créées au sein de la classe ouvrière par le développement capitaliste. Le danger vient aujourd’hui de ce que, non content de détruire la terre, le capitalisme déchaîne toujours plus de guerres du type de celles que les États-Unis ont conduites en Afghanistan et en Irak, des guerres dont l’élément déclencheur est la détermination des entreprises à s’approprier l’ensemble des ressources naturelles de la planète et à contrôler l’économie mondiale.
Marx et la reproduction de la main-d’œuvre
Aussi surprenant que cela puisse paraître au vu de la complexité de ses théories, Marx ignore l’existence du travail reproductif effectué par les femmes. Certes, il reconnaît que la force de travail demande à être produite au même titre que n’importe quelle autre marchandise, et que dans la mesure où elle a une valeur monétaire elle « représente le quantum de travail social réalisé en elle » (Marx, 1969 : 133). Mais autant il expose minutieusement les dynamiques de la production textile et de la valorisation capitaliste, autant il reste succinct sur la question du travail reproductif, qu’il réduit à la consommation des marchandises que les travailleurs peuvent acheter avec leurs salaires et au travail requis pour produire ces marchandises. Autrement dit, pour Marx comme pour le modèle néolibéral, la production de marchandises et le marché sont tout ce que réclame la (re)production de la force de travail. Il n’y pas d’autre labeur à fournir, que ce soit pour préparer ces marchandises que les travailleurs consomment ou pour restaurer physiquement et affectivement leur capacité de travail. En fait, il n’y a pas de différence entre la production de marchandises et la (re)production de la force de travail (ibid.). Une même chaîne d’assemblage les produit toutes les deux. La valeur de la force de travail se mesure par conséquent à la valeur des marchandises (nourriture, vêtements, logement) dont le travailleur a besoin, « c’est-à-dire à la valeur d’une somme de marchandises qui ne pourrait être moindre sans exposer la vie même du travailleur » (ibid. : 134) – et dont la mesure est cette fois celle du temps socialement nécessaire à leur production.
Marx ne s’étend pas plus lorsqu’il envisage la reproduction des travailleurs au fil des générations. Il s’en tient à dire que les salaires doivent être suffisamment élevés pour assurer la subsistance des « remplaçants, c’est-à-dire des enfants des travailleurs », de telle sorte que la force de travail « se perpétue sur le marché » (133). Là encore, toutefois, seuls participent à ce processus de reproduction les travailleurs de sexe masculin, leurs salaires et leurs moyens de subsistance. La production des travailleurs se fait via des marchandises. S’il lui arrive, rarement il est vrai, d’évoquer la reproduction biologique, c’est pour l’assimiler à un phénomène naturel, et il explique que les changements opérés dans l’organisation de la production créent périodiquement « une surpopulation relative » (459) afin de satisfaire les besoins variables du marché du travail.
Comment comprendre que Marx reste aussi obstinément aveugle au travail reproductif des femmes ? Pourquoi, par exemple, ne s’intéresse-t-il pas aux transformations que les matières premières entrant dans le processus de reproduction de la force de travail doivent subir pour que leur valeur soit transférée à leurs produits, alors qu’il a étudié cet aspect pour d’autres marchandises ? Cette omission, me semble-t-il, tient en partie aux conditions de vie de la classe ouvrière anglaise, point de référence de Marx et d’Engels (Federici, 2014). Marx décrit la condition du prolétariat industriel de son époque, telle qu’il a pu l’observer, et le travail domestique échappe à son champ de vision. L’horizon historique et politique qui est le sien ne s’étend pas à cette branche particulière de la production capitaliste, au moins pour ce qui concerne la classe ouvrière. Si les tâches reproductives ont toujours contribué au processus d’accumulation – et ce dès la première phase du développement capitaliste, en particulier pendant la période mercantiliste –, ce n’est en effet qu’à la fin du xixe siècle que le travail domestique a vraiment commencé à jouer un rôle moteur dans la reproduction de la main-d’œuvre ouvrière organisée par le capital, pour le capital, en fonction des exigences de la production industrielle. Dans les années 1870 encore ce travail était réduit au minimum, ce qui est logique compte tenu de « l’extension sans limites de la journée de travail » et de la compression maximale des coûts de production de la main-d’œuvre alors prônées par la classe politique. D’où la situation éloquemment décrite par Marx dans le premier volume du Capital, au chapitre « La journée de travail », et par Engels dans La situation de la classe ouvrière en Angleterre : celle d’une classe ouvrière dans la quasi-incapacité de se reproduire, car avec en moyenne une espérance de vie de vingt ans, elle meurt dans la fleur de l’âge, fauchée par le « surtravail » (Marx, 1969 : 180 sq.).
La classe capitaliste n’a entrepris d’investir dans la reproduction de la main-d’œuvre qu’à la fin du xixe siècle, à la faveur d’un renouvellement des formes de l’accumulation : le passage de l’industrie légère à l’industrie lourde exigeait une réglementation plus stricte du travail et des ouvriers moins cachectiques. Pour le dire en termes marxistes, le développement des tâches reproductives et son corollaire, l’apparition de la ménagère « à plein temps », sont les produits de la transition qui fait passer de la plus-value « absolue » à la plus-value « relative » ce mode d’exploitation de la main-d’œuvre qu’est l’extraction de la valeur. Sans qu’il y ait lieu de s’en étonner, Marx peut donc écrire que la consommation individuelle de la classe ouvrière sert « la production et la reproduction de l’instrument le plus indispensable au capitaliste, le travailleur lui-même », avant d’ajouter tout de suite après :
« Le capitaliste n’a pas besoin d’y veiller; il peut s’en fier hardiment aux instincts de conservation et de propagation du travailleur libre. […] Son unique souci est de limiter la consommation individuelle des ouvriers au strict nécessaire » (413-414).
On peut aussi faire l’hypothèse que les difficultés posées par la classification d’une forme de travail échappant à l’évaluation monétaire ont également découragé Marx d’aborder la question. Une autre raison qui éclaire mieux les limites du marxisme en tant que théorie politique explique toutefois que le travail domestique soit resté une tache aveugle pour Marx, et à sa suite pour les générations de marxistes qui ont vécu l’époque triomphale des « arts ménagers » et de la famille nucléaire.
À mon sens, le désintérêt de Marx pour les tâches reproductives des femmes vient de ce qu’il est obstinément resté fidèle à une conception technologique de la révolution où la liberté vient d’abord de la machine, où la productivité accrue des travailleurs doit servir d’assise au communisme, et où l’organisation capitaliste du travail étant le modèle le plus abouti de la rationalité historique, elle vaut pour toutes les formes de production, y compris la reproduction de la force de travail. En somme, l’importance du travail que réclame cette dernière échappe à Marx parce qu’il fait siens les critères capitalistes définissant le travail et qu’il croit fermement que la bataille pour l’émancipation de l’humanité s’engagera sur le terrain du salariat ouvrier.
À quelques exceptions près, les marxistes ont reproduit ces thèses – ce dont témoigne l’histoire d’amour au long cours pour le célèbre « Fragment sur les machines » inclus dans les Grundrisse (1857-1858) –, preuve que l’idéalisme qui présente la science et la technologie en forces libératrices guide toujours la vision marxienne de l’histoire et de la révolution. Quant aux féministes socialistes, si elles ont certes pris en compte l’existence du travail reproductif des femmes, elles se sont longtemps focalisées sur son caractère prétendument daté, rétrograde, précapitaliste, et ont imaginé sa reconstruction socialiste sous forme d’un processus de rationalisation dont la productivité égalerait un jour les niveaux atteints dans les secteurs clés de la production capitaliste.
Ce point aveugle de la modernité explique, entre autres, que les théoriciens marxistes n’aient pas su apprécier la portée historique de la révolte des femmes contre le travail domestique après la Deuxième Guerre mondiale. Expression de leur rébellion, le mouvement de libération des femmes s’est employé à redéfinir pratiquement ce qui constitue le travail, la composition de la classe ouvrière, la nature de la lutte des classes, mais les marxistes ont fait la sourde oreille. Il a fallu que les femmes quittent les organisations de gauche pour qu’ils reconnaissent enfin l’importance politique de ce mouvement de libération. À l’instar d’un éco-marxiste de la trempe de Paul Burkett, par exemple, nombre d’entre eux refusent toujours d’admettre que le travail reproductif est largement genré, ou alors ils n’en conviennent que du bout des lèvres, comme Hardt et Negri avec leur concept de « travail affectif ». Au vrai, la question de la reproduction les intéresse encore moins que Marx, qui a tout de même consacré plusieurs pages à la condition des enfants employés à l’usine. Aujourd’hui, il faut scruter les écrits marxistes à la loupe pour y trouver ne serait-ce qu’une allusion aux enfants.
Je reviendrai plus loin sur les limites contemporaines du marxisme et sur son incapacité à saisir la signification du tournant néolibéral et de la mondialisation. Il suffit pour l’instant de noter que le retentissement des luttes anticolonialistes et antiracistes menées aux États-Unis au cours des années 1960 a conduit des écrivains politiques tiers-mondistes à radicalement critiquer les thèses de Marx sur le capitalisme et les rapports de classe. Samir Amin et Andre Gunder Franck, pour ne citer qu’eux, s’insurgent contre leur eurocentrisme et dénoncent le rôle de premier plan que Marx accorde au prolétariat salarié en en faisant le principal acteur de l’accumulation capitaliste et le sujet révolutionnaire par excellence (Amin, 1970 ; Frank, 1968a et b). Cela étant, la réévaluation la plus catégorique des théories marxistes trouve ses sources dans la révolte des femmes contre le travail domestique dans les pays d’Europe et aux États-Unis, puis dans l’expansion des mouvements féministes au monde entier.
La révolte des femmes contre le travail domestique. Redéfinition féministe du travail, de la lutte des classes et de la crise capitaliste
Existe-t-il une loi sociale qui vient fixer, voire créer la valeur du travail en fonction du refus de travailler ? C’est en tout cas ce qui s’est passé pour le travail domestique, demeuré invisible et dépourvu de toute valeur jusqu’à ce qu’un mouvement de femmes refuse d’accepter comme un destin naturel le travail que réclame la reproduction sociale. En se révoltant dans les années 1960 et 1970, elles ont révélé au grand jour que ce travail domestique non payé joue un rôle central, dans l’économie capitaliste, et elles ont ainsi changé du tout au tout l’image que nous avons de la société, qui désormais s’apparente à un gigantesque circuit de plantations familiales et d’usines d’assemblage où la production des travailleurs s’organise sur une base quotidienne et générationnelle.
Les féministes ont démontré que la reproduction de la force de travail recouvre une gamme d’activités bien plus large que la seule consommation de marchandises, car la nourriture doit être préparée, les vêtements lavés, les corps choyés et soignés, et elles ne s’en sont pas tenues là. En soulignant que la reproduction sociale et le travail domestique des femmes participent de façon essentielle à l’accumulation du capital, elles ont ouvert la voie à un réexamen des catégories marxistes et jeté un jour nouveau sur l’histoire et sur les fondamentaux du développement capitaliste et de la lutte des classes. Dès le début des années 1970, une théorie féministe a élargi la brèche ouverte par les critiques tiers-mondistes de Marx, en confirmant que le mode d’exploitation capitaliste ne se limite pas au travail contractuel rémunéré mais requiert du travail contraint, et qu’il existe un lien de nature ombilicale entre la dévalorisation des tâches reproductives et le statut social dévalorisé des femmes.
Ce changement de paradigme a également eu des conséquences politiques. La plus immédiate fut le rejet des slogans de la gauche marxiste inspirés par les revendications de « grève générale » ou de « refus du travail » auxquelles jamais les ménagères n’avaient été associées. Et l’idée s’est peu à peu imposée que le marxisme passé au crible du léninisme et de la social-démocratie n’exprimait plus que les intérêts d’une petite partie du prolétariat mondial : celle que forment les ouvriers blancs, adultes, de sexe masculin, qui doivent largement leur pouvoir au fait de travailler dans les secteurs de la production industrielle capitaliste les plus développés du point de vue technologique.
Point positif, la découverte du travail reproductif a permis de comprendre que la production capitaliste repose sur la production d’un type de travailleur bien particulier – et donc sur un modèle bien particulier de famille, de sexualité, de procréation –, ce qui a conduit à redéfinir la sphère privée en sphère de rapports de production et donc en terrain de lutte anticapitaliste. À partir de là, il est devenu possible de voir que les lois qui interdisent l’avortement sont des outils au service de la régulation de la main-d’œuvre, que l’effondrement des taux de natalité et l’augmentation du nombre de divorces procèdent aussi de la résistance à la discipline capitaliste du travail. Le privé est devenu politique quand il devint clair que le capital et l’État s’immisçaient jusque dans nos chambres pour contrôler nos vies et notre reproduction.
À partir de cette analyse, tout un courant féministe constitué au milieu des années 1970 – période charnière lors de laquelle le capitalisme a ouvert le chantier de la restructuration néolibérale de l’économie mondiale – a fait le constat que la crise capitaliste n’était pas seulement la réponse apportée par le capital aux luttes ouvrières, mais qu’elle sanctionnait aussi le refus du travail domestique et le rejet de plus en plus affirmé de l’héritage colonialiste par de nouvelles générations d’Africain·es, d’Asiatiques, de Latino-Américain·es et d’Antillais·es. Cette perspective doit beaucoup à des activistes du mouvement Wages for Housework, dont Mariarosa Dalla Costa, Selma James ou Leopoldina Fortunati : elles ont montré que les batailles invisibles des femmes contre leur assujettissement à l’espace domestique signaient la fin du modèle de reproduction sur lequel s’étayait le « compromis » fordiste[/fn] Mis en œuvre aux États-Unis à l’issue de la Première Guerre mondiale par le constructeur automobile Henry Ford et théorisé par Gramsci, le fordisme a rationalisé les principes d’organisation scientifique du travail instaurés par le taylorisme. Mais, et c’est toute la différence avec le modèle tayloriste, les gains de productivité qu’il permet de dégager sont pour partie redistribués aux travailleurs au lieu de venir simplement gonfler les profits. L’augmentation du pouvoir d’achat qui en résulte stimule la croissance économique, laquelle soutient en retour la productivité et la consommation : c’est ce que les économistes appellent le « compromis économique et social vertueux » du fordisme (NdE).[/fn]. Dans un essai intitulé « Emigrazione e riproduzione », Dalla Costa relevait par exemple que la grève silencieuse contre la procréation menée par les Européennes depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale se traduisait concrètement par une chute du taux de natalité et l’adoption de politiques publiques favorables à l’immigration. Dans Brutto Ciao, le livre qu’elle a publié avec Mariarosa Dalla Costa, Fortunati se penchait sur les motivations à l’origine de l’exode rural des Italiennes après la Deuxième Guerre mondiale, sur leur utilisation jusqu’alors inédite des revenus du ménage qu’elles choisissaient de consacrer à la reproduction des nouvelles générations, et sur les liens entre la quête d’indépendance de ces femmes de l’après-guerre, leur investissement dans leurs enfants et la combativité retrouvée des nouvelles cohortes de travailleurs. Quant à Selma James (1990), elle expliquait que le comportement « culturel » et les « rôles » sociaux assumés par les femmes peuvent aussi s’interpréter comme une manière de « réagir et de se rebeller » contre une existence tout entière régie par le capitalisme.
Au milieu des années 1970, les combats des femmes n’avaient plus rien d’« invisible » et remettaient ouvertement en cause la division sexuelle du travail et tous ses corollaires : la dépendance économique à l’égard des hommes, l’état de subordination sociale qui en découle, l’enfermement dans un type de travail non rémunéré parce que essentialisé, le contrôle par l’État de la sexualité et de la procréation. Une idée fausse très répandue laisse croire que cette vague de contestation ne concernait que les femmes blanches des classes moyennes. En réalité, aux États-Unis c’est une action portée par des femmes noires qui est à l’origine de la première apparition du mouvement de libération des femmes : regroupées au sein du Welfare Mothers Movement qui s’inspirait du mouvement pour les droits civiques, elles ont lancé la toute première campagne féministe exigeant des pouvoirs publics qu’ils financent un « salaire ménager » (sous forme d’une allocation pour enfants à charge). Elles affirmaient ainsi haut et fort que le travail reproductif a bel et bien une valeur économique et que « l’aide de l’État » est par conséquent un droit des femmes (Milwaukee County Welfare Rights Organization).
En Afrique, en Asie, en Amérique latine aussi les femmes se mobilisaient, et c’est bien pour cela que les Nations unies ont décidé d’investir le champ politique féministe et de promouvoir les droits des femmes en organisant dès 1975, à Mexico, la première Conférence mondiale sur les femmes. J’ai dit ailleurs que l’extension internationale des mouvements de femmes avait conduit l’ONU à réendosser le rôle qu’elle avait joué dans les années 1960 par rapport aux luttes anticolonialistes (Federici, 1997). En l’occurrence, de même qu’elle avait alors soutenu (de manière très sélective) la « décolonisation », elle s’est arrogé la promotion des droits des femmes afin de contenir leurs politiques d’émancipation dans un cadre qui soit compatible à la fois avec les besoins et les projets du capital international, et avec un programme néolibéral en cours d’élaboration. Au départ de la Conférence de Mexico et de celles qui ont suivi, il y a en effet le constat que les combats des femmes autour du travail reproductif amenaient les économies postcoloniales à plus investir dans la main-d’œuvre domestique, et contribuaient de ce fait plus que tout autre facteur à mettre en échec les plans de la Banque Mondiale pour le développement de l’agriculture commerciale. Les Africaines ne voulaient plus travailler avec leur mari dans les champs cultivés à des fins d’exportation ; à la place, elles privilégiaient l’agriculture de subsistance, grâce à quoi leurs villages menacés de devenir les sites de reproduction d’une main-d’œuvre bon marché (selon l’image qu’en donne Meillassoux1) sont devenus des lieux de résistance à l’exploitation. Dans les années 1980, quand il est apparu que cette résistance était la cause principale de la panne des projets de développement agricole de la Banque mondiale, les publications sur « la contribution des femmes au développement » se sont mises à pleuvoir, bientôt suivies d’un torrent d’initiatives visant à les intégrer à l’économie monétaire, tels les « projets générateurs de revenus » montés par les ONG ou les programmes de microcrédit. Dans ces conditions, il n’est pas surprenant que les restructurations entraînées par la mondialisation de l’économie aient provoqué une réorganisation majeure de la reproduction, assortie d’une offensive en règle contre les femmes au nom du « contrôle démographique ».
Dans les pages qui suivent, je retrace les grandes lignes de cette restructuration, ses principales tendances, ses conséquences sociales et ses répercussions sur les rapports de classe. Auparavant, je me dois toutefois d’expliquer pourquoi je continue à utiliser le concept de « force de travail », alors qu’il est réducteur aux yeux d’un certain nombre de féministes qui rappellent que les femmes produisent des individus vivants – enfants, parents, amis –, pas de la force de travail. La critique est fondée : la force de travail est en effet une abstraction. Comme l’écrit Marx à la suite de Sismondi, la force de travail n’est rien si elle n’est pas vendue et utilisée. Cela étant, je préfère néanmoins garder ce concept pour différentes raisons. Premièrement, afin de mettre en évidence que, dans la société capitaliste, le travail reproductif n’est pas la libre reproduction de nous-même ou des autres en fonction de nos désirs et des leurs. Dans la mesure où, de façon directe ou indirecte, il s’échange contre un salaire, il est en tout point soumis aux conditions que lui imposent l’organisation capitaliste du travail et les rapports de production. Pour le dire autrement, le travail domestique n’est pas une activité librement exercée. Il recouvre « la production et la reproduction de l’instrument le plus indispensable au capitaliste : le travailleur lui-même » (Marx, 1969 : 413). À ce titre, il supporte toutes les contraintes découlant du fait que ce qu’il produit doit répondre aux exigences du marché du travail.
Deuxièmement, l’accent mis sur la reproduction de la « force de travail » révèle la double nature du travail reproductif en même temps que sa contradiction intrinsèque, et par conséquent son caractère instable et potentiellement subversif. La force de travail étant le propre d’un individu vivant, sa reproduction doit simultanément réaliser, d’une part la production et la valorisation des qualités et capacités humaines désirables, d’autre part leur ajustement aux normes dictées de l’extérieur par le marché. De même, donc, qu’il est impossible de séparer l’individu vivant de la force de travail, de même il est impossible de dissocier les deux aspects du travail reproductif qui leur correspondent. Garder ce concept permet cependant d’exposer la tension, la séparation possible, d’autant qu’il évoque tout un monde de conflits, de résistances, de contradictions éminemment politiques. Entre autres choses il nous signale (et cette indication fut déterminante pour le mouvement de libération des femmes) que nous pouvons nous battre contre le travail domestique sans crainte de détruire les cercles dans lesquels nous vivons, car ce travail emprisonne aussi bien les personnes qui le produisent que celles dont il assure la reproduction.
Je tiens également à défendre le point de vue qui, à contre-courant du postmodernisme, m’engage à maintenir la séparation entre production et reproduction. Certes, en un sens non négligeable la différence entre les deux s’est estompée. La classe capitaliste a tiré la leçon des luttes sociales menées dans les années 1960 en Europe et aux États-Unis, en particulier par les mouvements étudiants et féministes, et elle sait désormais qu’il n’est pas « rentable » d’investir dans la reproduction des futures générations de travailleurs : l’augmentation de la productivité de la main-d’œuvre n’en est pas pour autant garantie. D’où la baisse drastique des budgets investis dans la force de travail, à quoi s’ajoute une réorganisation des activités reproductives en services producteurs de valeur, autrement dit payants. La valeur produite par les activités reproductives est ainsi immédiatement réalisée, elle ne dépend plus des performances productives de la main-d’œuvre que ces activités servent à reproduire. L’essor du secteur des services n’a toutefois pas éliminé le travail reproductif non payé effectué à la maison, et il n’a pas non plus aboli la division sexuelle du travail qui départage toujours les activités de production et de reproduction en fonction des sujets traditionnellement chargés de les exécuter et de la discrimination opérée par le salaire et l’absence de salaire.
Enfin, je préfère parler de travail « reproductif » plutôt que de travail « affectif », car au sens où on l’entend le plus souvent le second terme désigne une petite partie seulement du travail qu’exige la reproduction des êtres humains, et il gomme le potentiel subversif du concept féministe de travail reproductif. En mettant en avant son rôle dans le travail de production de la force de travail, et en dévoilant ainsi les contradictions propres à ce travail, le concept de « travail reproductif » montre que des alliances et des formes de coopération cruciales se nouent entre les personnes qui produisent et celles qui sont reproduites – entre les mères et les enfants, les enseignant·es et les étudiant·es, le personnel soignant et les malades.
Gardant à l’esprit ce caractère particulier du travail reproductif, demandons-nous maintenant : 1) comment la mondialisation économique a restructuré la reproduction de la force de travail ; 2) quels ont été les effets de cette restructuration sur les travailleurs, et notamment sur les femmes, sujets traditionnellement chargés d’exécuter le travail reproductif ; 3) quel enseignement il faut tirer de cette restructuration, eu égard au développement capitaliste et à la place de la théorie marxiste dans les luttes anticapitalistes en cours aujourd’hui. Je répondrai à ces questions en deux temps. D’abord en m’arrêtant brièvement sur les grands changements introduits par la mondialisation dans le processus général de la reproduction sociale et des rapports de classe, puis en revenant plus en détail sur la restructuration du travail reproductif.
Nommer l’intolérable : l’accumulation primitive et la restructuration de la reproduction
La réponse apportée par la restructuration de l’économie mondiale au cycle de luttes des années 1960 et 1970, ainsi que la transformation qu’elle a opérée sur l’organisation de la reproduction et les rapports de classes recouvrent en fait cinq plans différents.
- L’expansion du marché du travail est un fait indéniable. La mondialisation a entraîné une augmentation historique de la taille du prolétariat mondial en instaurant un système d’« enclosures »2 qui a coupé des millions de gens de leurs terres, de leur travail, de leurs « droits coutumiers » et, parallèlement, en intégrant de plus en plus de femmes au marché du travail. Il n’est pas surprenant qu’elle se présente sous l’aspect d’un processus d’accumulation primitive aux multiples facettes. Dans le « Nord », elle se caractérise par la déconcentration industrielle et la relocalisation, la flexibilisation et la précarisation du travail, la production à flux tendu. Dans les pays de l’ancien bloc de l’Est, elle a entraîné le désengagement de l’État des structures de production industrielle, la décollectivisation de l’agriculture et la privatisation des biens publics. Au « Sud », elle s’est traduite par la maquilisation de la production3, la levée des droits de douane sur les importations et la privatisation des terres. Partout, cependant, l’objectif était le même.
En détruisant les économies vivrières, en coupant les producteurs de leurs moyens de subsistance, en mettant des millions de personnes dans la nécessité de trouver un apport d’argent alors que l’emploi salarié leur reste inaccessible, la classe capitaliste a simultanément relancé le processus d’accumulation et baissé le coût de production de la main-d’œuvre. Deux milliards de personnes supplémentaires ont ainsi été jetées sur le marché mondial du travail ; ce chiffre dément sévèrement les théories voulant que l’automatisation croissante du travail permette au capitalisme de se passer de quantités massives de main-d’œuvre.
-
La déterritorialisation du capital et la financiarisation des activités économiques rendues possibles par la « révolution informatique » ont créé les conditions à même de rendre permanent le processus d’accumulation primitive : l’échange quasi instantané des capitaux d’un bout à l’autre de la planète balaie tous les obstacles qu’oppose au capital la résistance des travailleurs à leur exploitation.
-
Les programmes d’ajustement structurel et le démantèlement de l’« État providence » ont asséché les budgets que les pouvoirs publics investissaient dans la reproduction de la force de travail. Nous avons vu plus haut que la classe capitaliste, tirant la leçon des luttes sociales des années 1960, a compris que l’argent ainsi placé ne garantissait pas nécessairement un surcroît de productivité. D’où l’apparition d’une politique et d’une idéologie qui redéfinissent les travailleurs en micro-entrepreneurs responsables de leurs propres investissements et uniques bénéficiaires présumés des activités reproductives effectuées pour eux. D’où aussi, en retour, la constriction de l’intervalle temporel entre reproduction et accumulation. Étant donné la baisse drastique des budgets de la santé, de l’éducation, des retraites, des transports, la hausse concomitante des tarifs et la nécessité dans laquelle se trouve aujourd’hui la « classe laborieuse » d’assumer elle-même le coût de sa reproduction, tous les points d’articulation de la reproduction de la force de travail correspondent désormais à des sites d’accumulation immédiate.
-
La mainmise des grandes entreprises sur les forêts, les océans, l’eau, la pêche, les barrières de corail, quantité d’espèces animales et végétales est sans précédent, de même que le niveau de destruction qui s’ensuit. De l’Afrique à l’Océanie, d’immenses étendues de terres cultivées et des eaux littorales abritant des ressources dont des populations entières tiraient leur subsistance ont été privatisées pour les besoins de l’agro-industrie, de l’extraction minière et de la pêche industrielle. La mondialisation révèle de manière si éclatante le coût de la production capitaliste et de sa technologie qu’il est inimaginable de parler, comme Marx dans les Grundrisse, de l’« influence civilisatrice du capital », elle-même effet, ajoutait Marx, de l’« appropriation universelle de la nature », au départ de :
« la production d’une étape de la société [où] la nature devient pour l’humanité un simple objet, une pure affaire d’utilité ; [où] elle cesse d’être reconnue comme une puissance en soi ; et [où] la reconnaissance théorique de ses lois propres n’apparaît plus que comme un stratagème conçu pour l’assujettir aux besoins humains que ce soit en qualité d’objet de consommation ou de moyen de production4 ».
Ces phrases prennent une résonance particulièrement sinistre aujourd’hui, en 2011, après la marée noire de la British Petroleum et après Fukushima – deux des nombreuses catastrophes écologiques directement provoquées par des entreprises privées –, à une époque où les océans se meurent, asphyxiés par des îles de déchets, et où l’espace transformé en poubelle sert aussi à stocker tout un arsenal militaire.
Toutes les populations de la planète pâtissent de ces évolutions à des niveaux différents. Assimiler le « Nouvel Ordre mondial » à un processus de recolonisation est cependant la meilleure façon de le caractériser. Loin d’aplanir le monde en en faisant un réseau de circuits interdépendants, il l’a de nouveau érigé en structure pyramidale en creusant les inégalités, en intensifiant la polarisation socioéconomique et en restaurant sur des bases solides les hiérarchies emblématiques de la division sexuelle et internationale du travail qui avaient été fragilisées par le mouvement anticolonialiste et le mouvement de libération des femmes.
L’ancien monde colonial, l’espace de l’esclavage et des plantations, la face cachée du système capitaliste, fut le centre stratégique de l’accumulation primitive. « Centre stratégique », car sa restructuration était un préalable nécessaire à la réorganisation mondiale de la production et à l’extension du marché du travail international. Là, en effet, s’est pour la première fois engagé sous nos yeux le processus d’expropriation et de paupérisation le plus impitoyable qui soit, en lien avec un désengagement massif de l’État vis-à-vis de la reproduction de la force de travail. L’histoire est connue. Au début des années 1980, sous l’effet des politiques d’« ajustement structurel » les taux de chômage ont grimpé si haut, dans la plupart des pays du « tiers monde », que l’USAID5 a pu recruter des gens à qui elle n’offrait rien d’autre que de la nourriture en échange de leur travail6. Le niveau des salaires était si bas que les ouvrières des maquiladoras7 achetaient le lait au verre, les œufs ou les tomates à l’unité.
La démonétisation a acculé à la ruine des populations entières, leurs terres ont été confisquées pour des projets gouvernementaux ou données à des investisseurs étrangers. À l’heure actuelle, la moitié du continent africain vit, si l’on peut dire, des programmes alimentaires d’urgence (Moyo et Yeros : 1). En Afrique de l’ouest, du Niger au Nigeria et au Ghana, les coupures d’électricité sont récurrentes et le dysfonctionnement des réseaux de distribution oblige ceux qui en ont les moyens à acheter des générateurs individuels dont le bourdonnement, la nuit, empêche les gens de dormir. Les budgets de la santé et de l’éducation, les subventions versées aux agriculteurs, les aides allouées pour l’achat de biens de première nécessité ont été amputées, taillées, hachées menu. Résultat, l’espérance de vie chute et nous voyons resurgir des fléaux que l’influence civilisatrice du capitalisme avait, disait-on, éradiqués de la surface de la terre : disettes, famines, épidémies et même chasses aux sorcières (Federici, 2008b : 21-35).
Là où les mesures dites « d’austérité » et la confiscation des terres n’ont pu être appliquées, la guerre a pris le relais et ouvert de nouveaux espaces au forage du pétrole ou à l’exploitation des diamants et du coltan. Ces opérations de liquidation alimentent la formation d’une nouvelle diaspora en drainant des millions de personnes des campagnes vers des villes qui, de plus en plus, ont des allures de camps de réfugié·es. Mike Davis parle à ce propos de « planète de bidonvilles »8, mais il serait plus juste et plus frappant de parler de « planète de ghettos » et d’apartheid mondialisé.
Sachant, en outre, que la crise de la dette et les politiques d’ajustement structurel ont contraint les pays dudit « tiers monde » à détourner leur production vivrière vers le marché d’exportation, à abandonner les terres arables à l’extraction minière et à la production de biocarburants, à déboiser leurs forêts, à devenir ni plus ni moins des décharges pour toutes sortes de déchets et des terrains de chasse pour les biopirates qui brevètent le vivant, force est d’en conclure que le capital international condamne froidement certaines régions du monde à « une reproduction proche de zéro ». Lorsque le but est de razzier les matières premières, de se débarrasser des travailleurs indésirables, de vaincre les résistances et d’abaisser les coûts de production, la destruction de la vie sous toutes ses formes est une solution aussi efficace que l’a été l’exercice du biopouvoir dans la formation des rapports capitalistes.
Pour mesurer le degré de sous-développement de la reproduction de la force de travail, il suffit de savoir que partout dans le monde des millions de gens forcés d’émigrer s’apprêtent à affronter des épreuves inouïes, à risquer la prison et jusqu’à leur vie. À l’évidence, émigrer n’est pas seulement une nécessité ; ainsi que l’avancent, entre autres, Yann Moulier Boutang et Dimitris Papadopoulos, c’est aussi un exode vers des terres où les luttes sont mieux structurées, un moyen de se réapproprier les richesses volées. Raison pour laquelle les migrations ont désormais un caractère autonome et ne peuvent plus guère servir de mécanisme régulateur pour restructurer le marché du travail. Cela étant, si des millions de gens partent à des milliers de kilomètres de chez eux vers un destin incertain, c’est parce qu’ils ne peuvent plus assurer leur reproduction, en tout cas pas dans des conditions de vie décentes. C’est particulièrement flagrant lorsqu’on sait que la moitié de ces migrant·es sont des femmes, mariées, pour beaucoup d’entre elles, et avec des enfants qu’elles doivent laisser au pays. D’un point de vue historique, cette pratique est tout à fait inédite. Les femmes sont en principe celles qui restent, non par manque d’initiative ou à cause du poids des traditions, mais parce que l’éducation qu’elles reçoivent les pousse à se sentir responsables de la reproduction de leur famille. C’est à elles qu’il revient de veiller à ce que les enfants aient de quoi manger – quitte, souvent, à se passer elles-mêmes de nourriture –, ce sont elles qui s’occupent quotidiennement des vieillards et des malades. Aussi, quand par centaines de milliers elles quittent leurs foyers pour aller au-devant d’une longue période d’humiliation et de solitude, aggravée par l’angoisse de ne pouvoir prodiguer à leurs proches l’attention qu’elles témoignent à de parfaits étrangers, force est de constater qu’un retournement dramatique bouleverse de fond en comble l’organisation mondiale de la reproduction.
Gardons-nous toutefois d’en déduire que l’indifférence de la classe capitaliste internationale vis-à-vis de l’hécatombe provoquée par la mondialisation est la preuve que le capital n’a plus besoin de main-d’œuvre. En réalité, depuis toujours la destruction de la vie humaine à grande échelle est une donnée structurelle du capitalisme, le pendant obligé de ce processus inévitablement violent qu’est l’accumulation de la force de travail. Les « crises de la reproduction » qui frappent l’Afrique depuis quelques décennies sont le fruit de cette dialectique entre accumulation et destruction de la main-d’œuvre. C’est dans ce contexte qu’il faut appréhender l’essor du travail non contractuel et d’un certain nombre d’autres phénomènes encore tenus pour abominables dans le « monde moderne » : le taux hallucinant des mises en détention, le trafic de sang, d’organes et autres parties du corps humain.
Le capitalisme nourrit une crise permanente de la reproduction. Si chaque génération n’en a que peu ou pas conscience, du moins dans de nombreux pays du « Nord », c’est parce que les catastrophes humaines qu’elle déclenche ont bien souvent été externalisées, circonscrites aux colonies, rationalisées comme étant les effets d’un retard culturel ou d’un attachement au « tribalisme » et à des traditions déplorables. Par ailleurs, pendant pratiquement toutes les années 1980 et 1990, les conséquences de la restructuration mondiale se sont à peine fait sentir dans le Nord, hormis dans les communautés racisées, ou bien elles ont pu passer (par exemple dans le cas de la flexibilisation et de la précarisation du travail) pour des solutions intéressantes qui cassaient la routine inflexible de la journée de huit heures, voire pour les signes annonciateurs d’une société où les robots remplaceraient les travailleurs.
Envisagées du point de vue des relations globales travailleur-capital, ces évolutions démontrent en réalité que le capital arrive toujours à désunir les travailleurs et à saper leurs efforts pour s’organiser sur les lieux du travail salarié. Leurs effets combinés se traduisent par l’abrogation des contrats sociaux, la dérèglementation du marché du travail et la réapparition de formes de travail non contractuelles, ce qui en sus de détruire les interstices ouverts au communisme par un siècle de luttes ouvrières compromet la production de nouveaux « biens communs ».
Au Nord aussi, les revenus et l’emploi se sont effondrés, la terre et les logements deviennent inabordables, la pauvreté gagne du terrain, et la faim avec elle. Selon un récent rapport, trente-sept millions de personnes souffrent actuellement de la faim, aux États-Unis, et des études réalisées en 2011 estiment que la moitié de la population dispose de « bas revenus ». De plus, au lieu de diminuer la durée de la journée de travail les technologies peu exigeantes en main-d’œuvre l’allongent considérablement, au point qu’au Japon des employé·es se tuent littéralement à la tâche tandis que pour le plus grand nombre les « loisirs » et la retraite deviennent des luxes. Aux États-Unis où trop de gens n’ont d’autre choix que de travailler au noir, les sexagénaires et les septuagénaires dont les retraites sont réduites à la portion congrue encombrent le marché de l’emploi. Signe plus criant encore, on voit se développer une main-d’œuvre itinérante, sans domicile fixe et nomade par force, qui se déplace constamment en camion, en caravane, en bus, à la recherche d’un travail, là où il s’en présente – un sort jadis réservé aux saisonniers agricoles qui, tels des oiseaux migrateurs, voyageaient au rythme des récoltes d’un bout à l’autre du pays.
L’appauvrissement, le chômage, le surmenage, la clochardisation et la dette vont de pair avec une criminalisation croissante de la classe ouvrière réalisée au moyen d’une politique d’incarcération de masse qui n’est pas rappeler le Grand Renfermement du xviie siècle, et par la formation d’un prolétariat hors-la-loi composé de sans papiers, d’étudiant·es dans l’incapacité de rembourser leurs prêts, de gens qui produisent
et/ou vendent des marchandises illicites, de travailleuses et de travailleurs du sexe. La multitude de ces prolétaires qui vivent et travaillent dans l’ombre nous rappelle que la production de catégories de population privées de droits (esclaves, « engagés » et coolies, péons et journaliers, sans papiers9) reste structurellement indispensable à l’accumulation du capital.
La charge contre la jeunesse aura été particulièrement rude, surtout dans les ghettos noirs où elle apparaît comme l’héritière potentielle du Black Power : toutes les portes lui sont fermées, celles des emplois stables comme celles de l’enseignement. Mais bien des jeunes des classes moyennes ont aussi devant eux un avenir incertain. Le coût élevé des études les oblige à s’endetter et beaucoup, ensuite, se retrouvent dans l’impossibilité de rembourser ces emprunts. Sur le marché de l’emploi, la compétition est féroce, et les rapports sociaux de plus en plus stériles car l’instabilité empêche la construction d’une communauté. La restructuration de la reproduction entraîne, entre autres conséquences sociales, une augmentation des suicides chez les jeunes et une recrudescence des violences envers les femmes et les enfants, infanticides compris. Aussi est-il impensable de partager l’optimisme d’intellectuels qui, à l’instar de Hardt et de Negri, soutiennent depuis quelque temps que les nouvelles formes de production d’ores et déjà créées par la restructuration mondiale de l’économie rendent d’ores et déjà possibles des formes de travail plus autonome et plus coopératives.
L’attaque contre nos conditions de reproduction a néanmoins rencontré des résistances qui se sont diversement exprimées et dont certaines sont longtemps restées invisibles avant d’apparaître comme des phénomènes de masse. En la matière, il faudrait aussi admettre que la financiarisation de la reproduction quotidienne – qui, aux États-Unis en particulier, passe par la généralisation des cartes bancaires, du crédit à la consommation, de l’endettement – n’est pas simplement le résultat d’une manipulation financière mais une réaction à la baisse des salaires et un refus de l’austérité. Depuis les années 1990, un mouvement de mouvements propagé aux quatre coins du monde conteste en bloc tous les aspects de la mondialisation au moyen de manifestations impressionnantes, d’occupations des terres, de la création d’économies solidaires et autres formes de biens communs. La résilience des soulèvements populaires et des mouvements « Occupy » qui, depuis l’an dernier, ont gagné plusieurs régions du monde – de la Tunisie à l’Égypte et à une large partie du Moyen-Orient en passant par l’Espagne et les États-Unis –, ouvre un espace où il redevient possible d’imaginer des transformations sociales majeures. Après des années de repli apparent où rien ne semblait pouvoir mettre un terme au pouvoir de destruction d’un ordre capitaliste pourtant sur le déclin, les « Printemps arabes » et les tentes des protestataires qui transforment le paysage des villes américaines en venant s’ajouter à celles de sans-abri toujours plus nombreux, sont des signes qui ne trompent pas : la base s’insurge à nouveau et une nouvelle génération décidée à prendre en main son avenir descend dans la rue, en optant pour des formes de luttes qui réussiront peut-être, même si ce n’est qu’un début, à réduire quelques-unes au moins des grandes fractures sociales.
Travail reproductif, travail des femmes et rapports de genre dans l’économie mondiale
La situation étant ce qu’elle est, il faut à présent se demander ce qu’il advient du travail reproductif dans l’économie mondiale, et comment les changements qu’il a subis retentissent sur la division sexuelle du travail et les rapports hommes-femmes. En la matière aussi il existe une différence substantielle remarquable entre production et reproduction. Notons d’abord que les avancées technologiques qui ont largement restructuré la production dans les secteurs clés de l’économie mondiale n’ont pas pénétré la sphère du travail domestique, et qu’en conséquence la quantité de travail socialement nécessaire à la reproduction de la force de travail n’a pas diminué de façon significative, malgré l’augmentation impressionnante du nombre de femmes employées « à l’extérieur ». Dans le « Nord », une partie importante de la population se sert désormais d’un ordinateur pour effectuer toute une série de tâches reproductives : les achats, les relations sociales, la recherche d’informations et jusqu’à certaines formes de travail sexuel peuvent se faire en ligne. Des entreprises japonaises développent la robotisation de services de nature sociale ou sexuelle. Parmi leurs inventions, il y a les « nursebots »10, pour la toilette des personnes âgées, et les poupées sexuelles interactives que le client monte et assemble au gré de ses fantasmes et de ses désirs. Pour autant, même dans les pays les plus développés technologiquement le travail domestique n’a pas diminué de façon significative : il a été marchandisé, redistribué, et aujourd’hui le gros de sa charge pèse sur des travailleuses immigrées venues du Sud et des pays de l’ancien bloc socialiste. Ce sont toujours les femmes qui, pour l’essentiel, l’accomplissent. À la différence d’autres formes de production, celle des êtres humains reste dans une large mesure irréductible à la mécanisation, car la satisfaction des besoins complexes qu’elle recouvre, et qui mêle inextricablement des éléments physiques et affectifs, passe avant tout par l’interaction humaine. Les soins à apporter aux enfants et aux personnes âgées suffisent à démontrer, si besoin en était, que le travail reproductif est un processus de travail intensif, puisque même dans leurs aspects les plus matériels ils ont pour finalité de rassurer, de consoler, d’anticiper les peurs et les désirs (Folbre). Les activités qu’ils mettent en jeu ne sont jamais purement « matérielles » ou « immatérielles », et on ne peut pas non plus les scinder pour les mécaniser ou leur substituer le flux virtuel de la communication en ligne.
Le travail domestique et le care ne pouvaient donc pas être « technologisés », mais ils ont été marchandisés, mondialisés et répartis entre plusieurs prestataires. La participation des femmes au marché du travail ayant considérablement augmenté, surtout dans le Nord, de larges pans du travail domestique sont maintenant sous-traités et réorganisés sur une base commerciale grâce à l’envolée de l’industrie des services, aujourd’hui le secteur économique qui emploie le plus grand nombre de personnes. En clair, cela signifie que les gens mangent plus souvent hors de chez eux, fréquentent plus les laveries automatiques ou les pressings, achètent davantage de plats tout préparés.
Le refus des femmes de se plier aux contraintes de la vie conjugale et de l’élevage des enfants a également contribué au déclin des activités reproductives gratuitement effectuées. Aux États-Unis, le nombre de naissances qui s’élevait à 118 ‰ dans les années 1960 a chuté à 67,6 ‰ en 2006, et dans le même temps l’âge médian des primipares a augmenté en passant de 30 ans en 1980 à 36,4 ans en 2006. La chute de la natalité est particulièrement marquée en Europe, de l’Ouest et de l’Est, où dans certains pays (l’Italie et la Grèce par exemple) les femmes poursuivent une « grève » de la procréation qui, dans les faits, se traduit par une croissance démographique à taux nul des plus préoccupantes, pour les décideurs politiques, car elle donne du poids aux arguments en faveur d’un assouplissement des procédures d’immigration. À quoi il faut ajouter la baisse du nombre de mariages et de couples mariés (aux États-Unis, ils ne représentaient plus que 51% des ménages en 2006, contre 56% en 1990) et la hausse concomitante du nombre de célibataires (plus de 7,5 millions, toujours aux États-Unis où au cours de la même période cette population est passée de 23 à 30,5 millions de personnes, soit une augmentation d’environ 30%).
Plus déterminant encore, les mesures d’ajustement structurel et les reconversions économiques ont entraîné une restructuration internationale du travail reproductif, suite à quoi l’essentiel de la reproduction de la force de travail des métropoles est désormais assumée par des immigrées venues spécialement du Sud pour s’occuper des enfants et des personnes âgées et fournir, entre autres tâches reproductives, des services sexuels aux travailleurs masculins11. Cette évolution est extrêmement importante à de multiples égards, et pourtant les féministes n’en ont pas encore bien cerné les conséquences politiques, qu’il s’agisse des rapports de pouvoir qu’elle instaure entre les femmes ou des limites de la marchandisation de la reproduction qu’elle révèle au grand jour. Si la « mondialisation du care » est sûrement une aubaine pour les gouvernements qu’elle dispense d’investir dans la reproduction, il est clair que cette « solution » a un coût social faramineux, non seulement pour les immigrées en tant qu’individus, mais aussi pour leurs sociétés et communautés d’origine.
La réorganisation du travail reproductif selon les règles du marché, la « mondialisation du care » et, plus encore, la technologisation du travail reproductif n’ont ni « libéré les femmes » ni éliminé l’exploitation inhérente à ce travail tel qu’il se présente aujourd’hui. Il faut replacer les choses dans une perspective mondiale pour se rendre compte que non seulement les femmes assument encore, dans tous les pays, l’essentiel des tâches domestique non payées, mais que, de surcroît, le démantèlement des services sociaux et la décentralisation de la production industrielle ont très probablement augmenté la quantité de travail domestique qu’elles effectuent, gratuitement ou non, y compris pour celles qui ont un autre emploi à l’extérieur.
L’allongement de la journée de travail des femmes et le retour en force du travail à domicile (payé ou pas) tiennent à trois facteurs. Tout d’abord, les femmes ont constitué le premier cordon d’amortissement contre la mondialisation : elles ont travaillé plus pour pallier la détérioration des conditions économiques due à la libéralisation de l’économie mondiale et au désengagement croissant des pouvoirs publics vis-à-vis de la reproduction de la force de travail. Ce fut particulièrement vrai dans les pays soumis à des programmes d’ajustement structurel, où les budgets destinés à la santé, à l’éducation, aux infrastructures et aux besoins fondamentaux de la population ont été purement et simplement supprimés. Résultat, un peu partout en Afrique et en Amérique du Sud les femmes doivent consacrer plus de temps à aller chercher de l’eau, à se procurer de quoi manger et à préparer les repas, à soulager des maladies beaucoup plus fréquentes maintenant que la privatisation des soins de santé rend les consultations médicales à peu près inabordables à un moment, justement, où la malnutrition et les atteintes à l’environnement fragilisent les individus.
Aux États-Unis également, les coupes budgétaires ont conduit à privatiser et à déléguer aux familles une bonne part des services traditionnellement prodigués par les hôpitaux et autres structures publiques, et c’est encore une fois le travail non rémunéré des femmes qui est ainsi exploité. À l’heure actuelle, par exemple, après une intervention chirurgicale les patients sont très vite renvoyés chez eux, à la maison où il faut donc effectuer toutes sortes de tâches médicales post-opératoires ou thérapeutiques (dans le cas de maladies chroniques) qui étaient autrefois l’apanage des médecins et du personnel infirmier (Glazer). Les aides publiques allouées aux personnes âgées (ménage, soins d’hygiène) ont elles aussi été sabrées, les visites à domicile sont écourtées et les services fournis se réduisent comme peau de chagrin.
Le deuxième facteur responsable du recentrage du travail reproductif dans la sphère privée, c’est le développement du « travail à domicile » dû pour partie à la déconcentration industrielle et pour partie à l’essor du travail informel. David Staples observe dans No place like home que loin d’être anachronique le travail à domicile relève d’une stratégie aussi vieille que le capitalisme et qu’il occupe aujourd’hui des millions de femmes et d’enfants dans les villes, les villages et les banlieues du monde entier. Staples souligne à juste titre que la gratuité des tâches ménagères draine inexorablement le travail dans l’espace familial, car en le réorganisant à l’intérieur de ce cadre où il devient invisible les employeurs peuvent sans mal déjouer les tentatives de syndicalisation et tirer les salaires vers le bas. Bien des femmes choisissent de travailler chez elles pour essayer de concilier la nécessité de gagner leur vie avec leurs obligations familiales ; au final, elles se retrouvent asservies à un travail dont le niveau de rémunération,
« très inférieur au salaire moyen auquel il serait payé s’il se déroulait dans des conditions formelles, […] reproduit une division sexuelle du travail qui astreint encore plus les femmes aux tâches domestiques » (Staples : 1-5).
Quant au troisième facteur, il correspond aux hiérarchies de genre qui déterminent toujours largement les niveaux de revenus et le recrutement sur le marché de l’emploi malgré la proportion de plus importante des femmes dans la population active et la restructuration de la reproduction. Les femmes gagnent toujours moins que les hommes, qui pour leur part sont de plus en plus touchés par le chômage. Derrière la recrudescence des violences masculines contre les femmes il y a sans doute, tout à la fois, la crainte de la compétition économique, la frustration d’hommes déchus de leur rôle de soutien de famille et qui, surtout, contrôlent beaucoup moins les corps et le travail des femmes, maintenant qu’elles gagnent leur vie et passent plus de temps hors de chez elles. Dans un contexte où il est plus difficile de fonder une famille à cause de la baisse des salaires et de la hausse du chômage, quantité d’hommes utilisent les corps des femmes comme un moyen d’échange et, via la pornographie et la prostitution, un moyen d’accès au marché mondial.
Cette montée des violences contre les femmes est difficile à quantifier et pour en apprécier l’importance le mieux est encore de l’envisager d’un point de vue qualitatif, à partir des formes nouvelles qu’elle prend. Dans plusieurs pays la structure familiale s’est pratiquement désintégrée sous la pression des mesures d’ajustement structurel. Il arrive assez souvent que les liens soient rompus d’un commun accord : un des conjoints, voire les deux, émigre, ou bien ils partent chacun de leur côté pour tenter de se procurer de quoi vivre. La plupart du temps cependant les choses se passent de façon plus tragique, avec le départ de l’époux et père qui abandonne femme et enfants à la paupérisation. En Afrique et en Inde, des femmes âgées accusées de sorcellerie où d’être possédées par le diable sont chassées de chez elles, brutalisées et parfois même assassinées. Ce phénomène trahit probablement la disparition de tout soutien familial à l’égard de personnes qui ont cessé d’être productives alors même que les ressources s’épuisent à vue d’œil. Non sans raison, il a également été relié à la destruction des terres collectives (Hinfelaar). Pour autant, il témoigne aussi de la dévalorisation du travail reproductif provoquée par la généralisation des rapports d’argent, dévalorisation qui frappe aussi de plein fouet celles qui prennent en charge ce travail (Federici, 2008a et ci-dessus : 121-134).
Parmi les violences imputables au processus de mondialisation il faut encore citer la flambée des meurtres commis en Inde en raison de la dot, l’explosion du trafic prostitutionnel et du travail sexuel forcé, l’augmentation alarmante des assassinats et des disparitions de femmes. À Ciudad Juarez et dans plusieurs villes mexicaines proches de la frontière avec les États-Unis, des centaines de jeunes femmes, pour la plupart ouvrières dans les maquiladoras, ont été violées et assassinées par les membres de réseaux criminels en cheville avec l’industrie de la pornographie et des snuff movies12. Au Mexique et au Guatemala, le nombre de femmes victimes de meurtres grossit de façon terrifiante. Mais la flambée de violence la plus hallucinante est d’abord institutionnelle : c’est celle qui provoque la paupérisation absolue, des conditions de travail inhumaines, l’immigration clandestine. On peut certes considérer que les migrations sont encore une façon de lutter, en s’enfuyant, pour plus d’autonomie et d’autodétermination, qu’elles procèdent d’une volonté d’inverser des rapports de force par trop déséquilibrés, mais cela ne change rien à la réalité des faits.
Cette analyse appelle plusieurs conclusions. Tout d’abord, ce n’est pas s’engager sur la voie de la libération que se battre pour décrocher un emploi ou pour « rejoindre la classe ouvrière là où elle est exploitée », selon une formule chère aux féministes marxistes. Si l’emploi salarié est peut-être une nécessité, ce n’est en aucun cas une stratégie politique cohérente. Tant que le travail reproductif restera dévalorisé, passera pour une affaire d’ordre privé à la charge exclusive des femmes, celles-ci auront toujours moins de pouvoir que les hommes face au capital et à l’État, et elles vivront toujours dans une extrême vulnérabilité sociale et économique. Il est aussi important de reconnaître que les lois du marché posent de sérieuses limites à la réduction et à la réorganisation du travail reproductif. Jusqu’à quel point pourra-t-on restreindre ou commercialiser les soins à dispenser aux enfants, aux personnes âgées et aux malades sans les leur faire payer au prix fort ? Les conséquences désastreuses du marketing des produits alimentaires sur la santé (l’augmentation de l’obésité jusque chez les enfants, pour ne prendre que cet exemple) en donnent une bonne indication. Quant à la commercialisation du travail reproductif qui consiste à se délester des soins du ménage sur d’autres femmes, c’est une « solution » qui a pour seul résultat d’amplifier la crise du travail domestique en l’étendant aux familles de celles qui fournissent désormais ces services, et en créant de la sorte de nouvelles inégalités entre les femmes.
- Il faut rouvrir le chantier de la lutte collective sur les tâches
- reproductives, reprendre le contrôle des conditions matérielles de la
- reproduction sociale, inventer de nouvelles formes de coopération qui
- échappent à la logique du capital et du marché. Ce n’est pas une utopie
- le processus est déjà enclenché dans de nombreuses parties du monde et l’effondrement du système financier mondial pourrait jouer en sa faveur. Les gouvernements voudraient aujourd’hui mettre à profit la crise pour nous imposer des régimes d’austérité très durs. Mais les opérations de récupération des terres, l’agriculture urbaine, les associations de soutien avec les producteurs locaux, les occupations de terrains ou de logements, la redécouverte de différentes formes de troc, d’aide mutuelle, des médecines dites alternatives – pour s’en tenir aux domaines où cette réorganisation de la reproduction s’est le plus développée –, dessinent la possibilité d’une autre économie susceptible de transformer cette activité étouffante et discriminatoire qu’est le travail reproductif en un terrain d’expérimentation des plus libérateurs et créatifs pour les relations humaines.
Je l’ai dit, il ne s’agit pas d’une utopie. L’économie mondialisée aurait sûrement des conséquences plus abominables encore si les femmes, par millions, ne mettaient pas tout dans la balance pour assurer la survie de leurs proches, quelle que soit leur valeur sur le marché du travail capitaliste. En poursuivant leurs activités de subsistance, en participant à des formes d’action directe (de l’occupation de terres domaniales à l’agriculture urbaine) ces femmes ont évité à leurs communautés d’être totalement dépossédées, elles les ont aidées à augmenter leurs recettes et à améliorer l’ordinaire.
Autour d’elles le monde s’écroulait sous l’effet combiné des guerres, des crises économiques, des dévaluations, mais elles ont semé du maïs et du blé dans des friches urbaines, cuisiné des plats qu’elles vendaient dans la rue, créé des cuisines collectives (les ola communes du Chili et du Pérou), et en empêchant ainsi que la vie tout entière soit traitée en marchandise elles ont impulsé un mouvement de réappropriation et de recollectivisation des activités reproductives qui seul peut nous permettre de reprendre le contrôle sur nos vies. Les événements festifs et les rassemblements des collectifs « Occupy » surgis en 2011 en sont d’une certaine façon le prolongement, dans la mesure où les « multitudes » savent désormais qu’un mouvement, pour être durable, doit accorder une place centrale à leurs activités reproductives, ce qui permet aussi de transformer les manifestations contestataires en moments de coopération autour du partage de ces activités.
Bibliographie
Amin, Samir. 1970. L’accumulation à l’échelle mondiale. Critique de la théorie du sous-développement. Paris, Anthropos.
Dalla Costa, Mariarosa et Fortunati, Leopoldina. 1976. Brutto Ciao. Direzioni di marcia delle donne negli ultimi trent’anni. Rome, Edizioni delle Donne.
Davis, Mike. 2006. Le pire des mondes possibles. De l’explosion urbaine au bidonville global. Traduit de l’anglais par Jacques Mailhos. Paris, La Découverte.
Federici, Silvia. 2014 [2004]. Caliban et la sorcière. Femmes, corps et accumulation primitive. Traduit de l’anglais par le collectif Senonevero, revue et complétée par Julien Guazzini. Genève, Entremonde et Senonevero.
Federici, Silvia. 2008a [2000]. « War, globalization and reproduction » », **in **Meyer, Matt et Ndura-Ouéradrogo Elavie (dir.), Seeds of new hope. Pan-African peace studies for the Twenty-First Century. Trenton (New Jersey), Africa World Press, p. 141-164.
Federici, Silvia. 2008b. « Witch-hunting, globalization and feminist solidarity in Africa today ». Journal of International Women’s Studies 10, n° 1 (octobre) : Women’s gender activism in Africa, p. 21-35.
Federici, Silvia. 1997. « Going to Beijin. The United Nations and the taming of the international Women’s Movement » (non publié).
Gunder Frank, Andre. 1968a [1966]. « Le développement du sous-développement ». Traduit de l’anglais par le département d’économie de la Sir George Williams University (Montréal). **Cahiers Vilfredo Pareto **6, n° 16-17, p. 69-81. [Rééd. 1972 : Le développement du sous-développement. Paris, Maspero.]
Gunder Frank, Andre. 1968b [1967]. **Capitalisme et sous-développement en Amérique latine. **Traduit de l’anglais par Guillaume Carle et Christos Passadeos. Paris, Maspero.James, Selma. 1990 [1973]. Sexe, race et classe. Montréal, Campagne internationale pour un salaire au travail ménager. [Repris en 2012 en anglais in JAMES, Sex, race and class : The perspective of winnning. A selection of writings, 1952-2011. Oakland, PM Press, p. 92-101.]
Marx, Karl. 2011 [1858]. « Fragment sur les machines ». **Manuscrits de 1858 dits **Grundisse. Traduction de Jean-Pierre Lefebvre. Paris, Les Éditions sociales, p. 660-662.
Marx, Karl. 1969 [1867]. **Le capital. Critique de l’économie politique. **Livre I : Le développement de la production capitaliste. Traduction de Joseph Roy entièrement révisée par l’auteur. Paris, Les Éditions Sociales.
McMurtry, John. 1999. The cancer stage of capitalism. Londres, Pluto Press.
Staples, David E. 2006. No place like home. Organizing home-based labor in the era of structural adjustment. New York, Routledge.
**Silvia Federici, écrivaine, militante et professeure de l’Université de Hofstra de New York, est une référence pour comprendre l’interconnexion entre la crise systémique actuelle du capital et l’augmentation des différentes formes de violences à l’égard des femmes, en se référant aux analyses féministes de la transition du féodalisme au capitalisme et au rôle du travail reproductif non salarié dans la constitution du système capitaliste. Elle est notamment l’auteure de Caliban et la sorcière. **
Voici le premier chapitre du livre de Silvia Federici : Point zéro : propagation de la révolution. Salaire ménager, reproduction sociale, combat féministe
" Mon engagement dans le mouvement des femmes m’a amenée à prendre conscience que la reproduction des êtres humains est au fondement de tout système économique et politique, et que si le monde continue de tourner, c’est grâce à l’immense quantité de tâches ménagères, payées et non payées, effectuées par les femmes. “