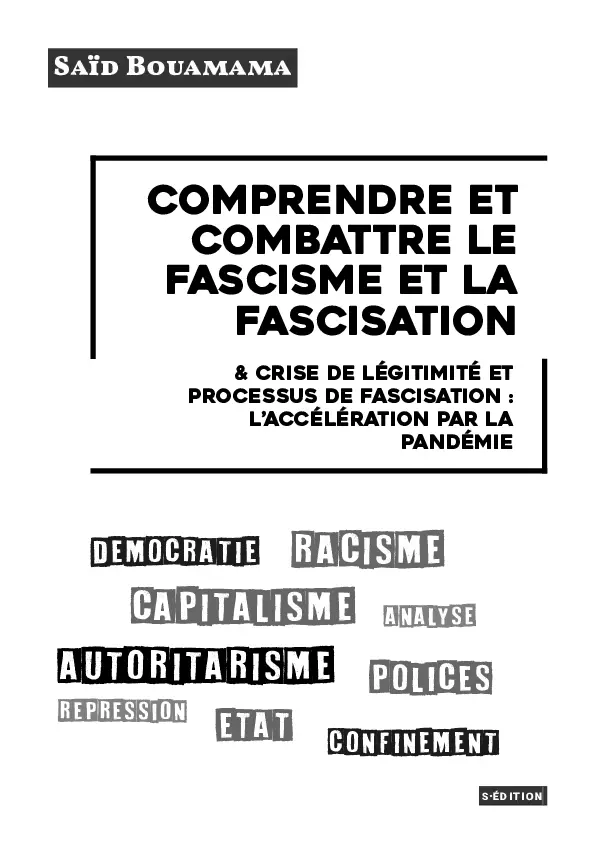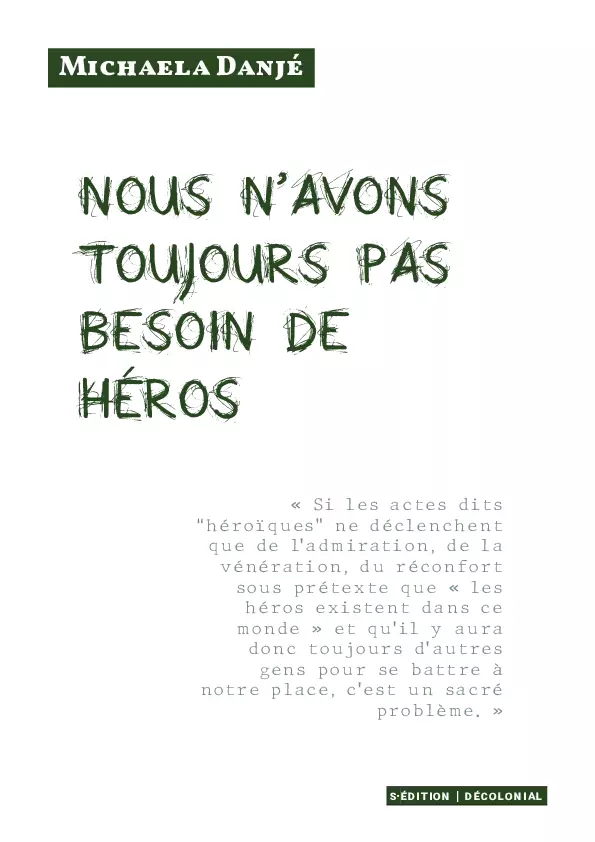Said Bouamama — Comprendre et combattre le fascime et la fascisation
Temps de lecture : ~ 44 minutes
Crise de légitimité et processus de fascisation : L’accélération par la pandémie
Texte initialement publié sur le site de Said Bouamama le bouamamas.wordpress.com
Les images de personnels hospitaliers manifestant avec banderoles et drapeaux syndicaux dans plusieurs hôpitaux français illustrent l’ampleur de la crise de légitimité qui touche le gouvernement Macron. Ces défilés revendicatifs se déroulent au moment même où le gouvernement et ses relais médiatiques déploient un discours appelant à célébrer et applaudir les « héros de première ligne ». Le désaveu des hospitaliers est ici à la hauteur d’une colère populaire qui gronde sans pouvoir se visibiliser du fait du confinement. Cette colère populaire est mesurée par le gouvernement qui prépare activement ses réponses [répressives d’une part et idéologiques d’autre part] pour la juguler et la détourner. La crise de légitimité antérieure à la pandémie est accélérée par celle-ci et suscite logiquement une accélération du processus de fascisation, lui aussi déjà entamé avant la séquence du Corona. Le rappel de quelques fondamentaux permet d’éclairer la signification politique et idéologique de quelques faits et choix gouvernementaux récents ayant à première vue aucun liens : gestion autoritaire du confinement ayant déjà fait 10 victimes dans les quartiers populaires, note aux établissements scolaires appelant à « lutter contre le communautarisme » dans le cadre du déconfinement, document de prospective du ministère des affaires étrangères sur les conséquences politiques de la pandémie en Afrique, soutien d’Emmanuel Macron à Éric Zemmour, etc.
Crise de légitimité et processus de fascisation
Le concept d’ « hégémonie culturelle » proposé par Gramsci permet d’éclairer le lien entre la « crise de légitimité » et le « processus de fascisation ». Contrairement à une idée répandue ce n’est pas la répression qui est l’assise la plus importante de la domination. Les classes dominantes préfèrent s’en passer conscientes qu’elles sont de l’incertitude de l’issue d’un affrontement ouvert avec les classes dominées. C’est, souligne Gramsci, la dimension idéologique qui est l’assise la plus solide de la domination. Elle se déploie sous la forme de la construction d’une « hégémonie culturelle » dont la fonction est d’amener les dominés à adopter la vision du monde des dominants et à considérer la politique économique qui en découle au mieux comme souhaitable et au pire comme la seule possible. « La classe bourgeoise se conçoit comme un organisme en perpétuel mouvement, capable d’absorber la société entière, l’assimilant ainsi à sa propre dimension culturelle et économique. Toute la fonction de l’État a été transformée ; il est devenu un éducateur[1] » explique Gramsci. C’est cette hégémonie culturelle qui est donneuse de légitimité, les élections en constituant une mesure. A l’inverse l’affaiblissement de l’hégémonie signifie une crise de légitimité que l’auteur appelle « esprit de scission » : « Que peut opposer une classe innovatrice, demande Gramsci, au formidable ensemble de tranchées et de fortifications de la classe dominante ? L’esprit de scission, c’est-à-dire l’acquisition progressive de la conscience de sa propre personnalité historique ; esprit de scission qui doit tendre à l’élargissement de la classe protagoniste aux classes qui sont ses alliées potentielles[2]. »
L’ampleur de la régression sociale produite par la séquence néolibérale du capitalisme depuis la décennie 80 sape progressivement les conditions de la légitimation de l’ordre dominant. Cette séquence est par son culte de l’individu, des « gagnants et des « premiers de cordée », son retrait de l’Etat des fonctions de régulation et de redistribution, sa destruction des protections sociales minimums, etc., productrice d’un déclassement social généralisé reflétant une redistribution massive des richesses vers le haut. La crise de légitimité n’a cessé de se déployer depuis sous les formes successives et dispersées de grands mouvements syndicaux (1995, réforme des retraites, etc.), de la révolte des quartiers populaires en novembre 2005, du mouvement des Gilets Jaunes, etc. La progression de l’abstention et son installation durable constitue un des thermomètres de cette illégitimité grandissante. L’élection d’Emmanuel Macron avec seulement 18,19 % des inscrits [qui représente les électeurs ayant émis un vote d’adhésion] au premier tour souligne l’ampleur de celle-ci.
Au fur et à mesure que se développe l’illégitimité croissent les « débats écran » d’une part et l’usage de la répression policière d’autre part. Les multiples « débats » propulsés politiquement et médiatiquement par en haut sur le communautarisme, le voile, la sécession des quartiers populaires, etc., illustrent le premier aspect. Les violences policières [jusque-là essentiellement réservées aux quartiers populaires] à l’encontre des Gilets Jaunes et des opposants à la réforme des retraites concrétisent le second. C’est ce que nous nommons « processus de fascisation » du fait de ses dimensions idéologiques [construction d’un bouc émissaire dérivatif des colères sociales], juridiques [entrée dans le droit commun de mesures jusque-là limitée aux situations d’exception] et politique [doctrine de maintien de l’ordre].
Il convient de préciser le concept de fascisation » pour éviter les compréhensions possiblement « complotistes » et « réductionnistes » de l’expression. La fascisation n’est pas le fascisme qui est un régime de dictature ouverte se donnant pour objectif la destruction violente et totale des opposants. Le processus de fascisation n’est pas non plus une intentionnalité de la classe dominante ou un « complot » de celle-ci. Il est le résultat de l’accumulation de réponses autoritaires successives pour gérer les contestations sociales dans un contexte de crise de légitimité. La carence de légitimité contraint la classe dominante et ses représentants à une gestion à court terme de la conflictualité sociale, crise par crise, mouvement social par mouvement social [par les trois vecteurs soulignés ci-dessus : idéologique, juridique et répressif]. S’installe alors progressivement et tendanciellement un modèle autoritaire reflétant la crise de l’hégémonie culturelle de la classe dominante. Terminons ces précisions en soulignant que la fascisation ne mène pas systématiquement au fascisme, qu’elle n’en constitue pas fatalement l’antichambre. Le processus de fascisation exprime les séquences historiques particulières où les dominés ne croient plus aux discours idéologiques dominants sans pour autant encore constituer un « nous » susceptible d’imposer une alternative. L’issue de telles séquences est fonction du rapport de forces et de la capacité à produire ce « nous ».
C’est dans ce contexte que survient la pandémie qui comme toute perturbation durable du fonctionnement social et économique fait fonction de révélateur de dimensions que l’idéologie dominante parvenait encore à masquer : les pénuries de masques, de personnels de santé et de matériels médicaux visibilisent les conséquences de la destruction des services publics ; la faim qui apparaît dans certains quartiers populaires fait fonction de miroir grossissant de la paupérisation et de la précarisation massive qui avaient déjà suscités la révolte des quartiers populaires de novembre 2005 et le mouvement des Gilets Jaunes ; la gestion autoritaire du confinement et sa politique de l’amende révèlent au grand jour le modèle de citoyenneté infantilisante et méfiante qui s’est installé du fait de la crise de légitimité ; le maintien de l’activité dans des secteurs non vitaux en dépit du manque de moyens de protection démasquent l’ancrage de classe des choix gouvernementaux ; les aides et allégements de charges aux entreprises, l’absence de mesures sociales d’accompagnement des baisses de revenus brusques liées au confinement [annulation des loyers et des charges par exemple], l’annonce de mesures de restriction « temporaires » de conquis sociaux [durée du travail, congés, etc.] pour faire face aux conséquences économiques de la pandémie, les conditions du déconfinement scolaire, etc., finissent de déchirer le mythe du discours sur l’unité nationale face à la crise. La crise de légitimité déjà bien avancée avant la pandémie sort de celle-ci considérablement renforcée. Le déconfinement survient dans ce contexte de colère sociale massive, d’écœurement des personnels de santé, de quartiers populaires au bord de l’explosion, etc.
La préparation policière, juridique et idéologique de l’après-pandémie
Le bilan humain du choix d’une gestion autoritaire du confinement est à lui seul parlant et significatif de la préparation policière de l’après-pandémie. Déjà une dizaine de décès suite à des contrôles de police depuis le début du confinement. Les révoltes populaires dans plusieurs quartiers suite à ces violences policières révèlent l’état de tension qui y règne. Non seulement les habitants de ces quartiers populaires ont été abandonnés à leur sort [alors que les niveaux connus de pauvreté et de précarité rendaient prévisibles la dégradation brusque des conditions d’existence que le confinement produirait] mais ils subissent les pratiques d’un appareil de police gangréné par le racisme, infiltré de manière non marginale par l’extrême-droite, habitué à l’impunité, etc. Le mépris de classe et l’humiliation raciste caractérisent plus que jamais le rapport entre institution policière et habitant des quartiers populaires.
Le discours politique et médiatiques sur l’incivilité et l’irresponsabilité des habitants des quartiers populaires a accompagné cette accélération des violences policières. Sans surprise ceux que le géo-politologue Pascal Boniface a pertinemment appelé les « intellectuels faussaires [3]» ou les « experts du mensonge » ont été mobilisés. Dès le 23 mars Michel Onfray ouvre le bal : « Que le confinement soit purement et simplement violé, méprisé, moqué, ridiculisé dans la centaine des territoires perdus de la République, voilà qui ne pose aucun problème au chef de l’État. Il est plus facile de faire verbaliser mon vieil ami qui fait sa balade autour de son pâté de maison avec son épouse d’une amende de deux fois 135 euros que d’appréhender ceux qui, dans certaines banlieues, font des barbecues dans la rue, brisent les parebrises pour voler les caducées dans les voitures de soignants, organisent ensuite le trafic de matériel médical volé, se font photographier vêtus de combinaison de protection en faisant les doigts d’honneur[4]. » Alain Finkielkraut confirme ce constat alarmant et s’interroge quelques jours plus tard : « Les quartiers qu’on appelle “populaires” depuis que l’ancien peuple en est parti, le trafic continue, les contrôles policiers dégénèrent en affrontements, des jeunes dénoncent une maladie ou un complot des “Blancs” et les maires hésitent à imposer un couvre-feu parce qu’ils n’auraient pas les moyens de le faire respecter. Union nationale, bien sûr, mais formons-nous encore une nation ?[5] ». La situation et ces discours de stigmatisation sont d’autant plus insupportables que les quartiers populaires et leurs habitants ont été le lieu et les acteurs d’une mobilisation de solidarité citoyenne multiforme. Mobilisations familiales, de voisinages, associatives, informelles ou organisées, autofinancées, etc., sans laquelle la situation aurait été bien plus grave qu’elle ne l’est.
Le contrôle, la contrainte, la mise en scène de la force [que révèlent de nombreuses vidéos de contrôles pendant le confinement] et la répression, dessinent la tendance des réponses envisagées en réponse aux colères sociales qui s’exprimeront inévitablement après la pandémie. C’est dans cette direction que s’oriente l’approbation le 6 mai 2020 par la commission des lois de la proposition de plusieurs députés de la majorité visant à autoriser des « gardes particuliers » à participer au contrôle des règles du déconfinement et à dresser des procès-verbaux en cas d’infractions. L’annonce de l’utilisation de drones et autres outils technologiques pour la surveillance du déconfinement est dans la même teneur. Comme le souligne l’Observatoire des Libertés et du Numérique (OLN) ces nouvelles technologies de surveillance sont porteuses d’une « régression des libertés publiques » :
Chacune des crises qui ont marqué le 21e siècle ont été l’occasion d’une régression des libertés publiques. Les attentats terroristes du 11 septembre 2001 ont vu l’Europe adopter la Directive sur la rétention des données de connexions électroniques et l’obligation faite aux opérateurs de stocker celles de tous leurs clients. Les attentats terroristes qui ont touché la France en 2015 ont permis le vote sans débat de la loi renseignement. Ils ont aussi entraîné la mise en place de l’état d’urgence dont des mesures liberticides ont été introduites dans le droit commun en 2017. La pandémie de Covid-19 menace d’entraîner de nouvelles régressions : discriminations, atteintes aux libertés, à la protection des données personnelles et à la vie privée[6].
La crise de légitimité oriente le gouvernement vers des réponses exclusivement autoritaires et répressives accompagnées d’une offensive idéologique visant à présenter les habitants des quartiers populaires comme incivils, irresponsables, irrationnels, complotistes, etc., à des fins d’isolement de leurs colères et de leurs révoltes légitimes. L’offensive idéologique s’annonce d’autant plus importante que l’expérience des Gilets Jaunes et du mouvement contre la réforme des retraites tant sur le plan du traitement médiatique [et des déformations des faits auquel il a donné lieu] que sur le plan des violences policières, ont produit des acquis palpables. En témoignent les déclarations de soutien aux habitants des quartiers populaires et de condamnation des violences policières qui ont vu le jour. Pour ne citer qu’un exemple, citons la vidéo de salariés et de syndicalistes de la RATP et de la SNCF témoignant de cette solidarité. De tels faits de solidarité étaient inexistants lors de la révolte des quartiers populaires de novembre 2005 et témoignent une nouvelle fois de l’approfondissement de la crise de légitimité.
C’est dans le cadre de ce besoin de détournement idéologique de l’attention qu’il faut, selon nous, situer la distribution à tous les établissements scolaires pour préparer le déconfinement d’une « fiche » intitulée « Corona virus et risque de replis communautaristes ». Alors que la grande majorité des enseignants est légitimement préoccupée des conditions matérielles et pédagogiques de la reprise des cours, l’attention est orientée vers un pseudo danger « communautaristes » décrit de manière alarmante comme suit :
Aujourd’hui, la violence de la pandémie causée par un nouveau virus nous confronte à l’incertitude sur de multiples plans (en matière, médicale, sociale, économique, culturelle…). La crise du Covid-19 peut être utilisée par certains pour démontrer l’incapacité des États à protéger la population et tenter de déstabiliser les individus fragilisés. Divers groupes radicaux exploitent cette situation dramatique dans le but de rallier à leur cause de nouveaux membres et de troubler l’ordre public. Leur projet politique peut être anti-démocratique et antirépublicain. Ces contre-projets de société peuvent être communautaires, autoritaires et inégalitaires. En conséquence, certaines questions et réactions d’élèves peuvent être abruptes et empreintes d’hostilité et de défiance : remise en question radicale de notre société et des valeurs républicaines, méfiance envers les discours scientifiques, fronde contre les mesures gouvernementales, etc.[7].
Dénoncer l’incapacité ou les carences de l’Etat en matière de protection ou exprimer un désaccord contre les mesures gouvernementales devient ainsi un indicateur de communautarisme. Une autre partie du document situe les actes du gouvernement sans contestation possible du côté de la « science » et des « valeurs républicaines » et toute critique de ces actes du côté de l’irrationalité, du complot et du communautarisme. Bien sur une telle introduction au « problème » ne peut déboucher que sur un appel à la délation dont il est précisé qu’il doit s’étendre jusque dans la cour de récréation : « • Être attentif aux atteintes à la République qui doivent être identifiées et sanctionnées. • Mobiliser la vigilance de tous : les enseignants en cours, les CPE et assistants d’éducation dans les couloirs et la cour pour repérer des propos hors de la sphère républicaine […] • Alerter l’équipe de direction afin qu’elle puisse : – Effectuer un signalement dans l’application « Faits établissement » ; – Informer l’IA-DASEN en lien avec la cellule départementale des services de l’État dédiée à cette action et mise en place par le préfet[8]. » Quand à la cible de cette vigilance et de cette délation, elle se situe, bien entendu dans les quartiers populaires, la « fiche » en question faisant référence au plan national de prévention de la radicalisation [« prévenir pour protéger »] du 23 février 2018[9] qui précise qu’il s’applique « plus particulièrement dans les quartiers sensibles ».
Même la politique étrangère française fait partie de ce document hallucinant au regard des questions concrètes et réelles que se posent les enseignants. Il leur est ainsi demandé de se faire les défenseurs de celle-ci : « Aborder les questions sur la nouvelle situation géopolitique en lien avec la pandémie, en montrant à la fois la complexité des relations internationales et la place de la France[10]. » Il est vrai que les préoccupations africaines du gouvernement sont particulièrement fébriles comme en témoigne une autre note, cette fois-ci de ministère des affaires étrangères. Cette note datée du 24 mars 2020 et intitulée « L’effet Pangolin : la tempête qui vient en Afrique ? » émane du Centre d’Analyse, de Prévision et de Stratégie. Se voulant prospective l’analyse développée annonce une série de crises politiques en Afrique comme conséquences de la Pandémie : « En Afrique notamment, ce pourrait être « la crise de trop » qui déstabilise durablement, voire qui mette à bas des régimes fragiles (Sahel) ou en bout de course (Afrique centrale) ». Elle en déduit la nécessité « de trouver d’autres interlocuteurs africains pour affronter cette crise aux conséquences politiques » c’est-à-dire qu’elle appelle tout simplement à de nouvelles ingérences. Enfin elle précise la nature de ces nouveaux interlocuteurs sur lesquels la stratégie française devrait s’appuyer : « les autorités religieuses », « les diasporas », les « artistes populaires » et « les entrepreneurs économiques et businessmen néo-libéraux[11] ». Sur le plan international également l’après pandémie est en préparation et il a la couleur de l’ingérence impérialiste.
Les conséquences économiques de la pandémie dans le contexte d’un néolibéralisme dominant au niveau mondial, de crise de légitimité profonde et de colères sociales massives et généralisées, sont le véritable enjeu de cette préparation active de l’après-pandémie sur les plans policier, juridique et idéologique. L’économiste, Nouriel Roubini qui avait un des rares à anticiper la crise de 2008 parle d’ores et déjà de « grande Dépression » en référence à la crise de 1929. Le séisme qui s’annonce ne peut avoir que deux issues logiques : une dégradation et un déclassement social sans précédent depuis la seconde guerre mondiale ou une baisse conséquente des revenus des dividendes faramineux des actionnaires. La fascisation, le retour aux fondamentaux islamophobes et à la stigmatisation des quartiers populaires expriment la stratégie de la classe dominante pour faire face à cet enjeu. Plus que jamais la phrase célèbre de Gramsci résonne avec une grande modernité : « La crise consiste justement dans le fait que l’ancien meurt et que le nouveau ne peut pas naître. Pendant cet interrègne, on observe les phénomènes morbides les plus variés[12]. » A nous d’accélérer par nos mobilisations la réunion des conditions de possibilité du nouveau sans lesquelles nous ne pourrons que déplorer le développement de ces morbidités.
Comprendre et combattre le fascisme et la fascisation
Texte initialement publié sur le site bouamamas.wordpress.com. Cette version, réactualisée et corrigée par l’auteur lui-même, n’inclut pas les digressions très intéressantes qui ont entrecoupé la conférence dont est elle issue, prononcée en octobre 2009 à Paris, au Centre International de Culture Populaire,
De nombreuses analyses du fascisme ont été produites depuis les années 1930 et une multitude de définitions de ce régime politique ont été avancées. Il ne s’agit pas ici de les exposer exhaustivement mais de souligner quelques débats clefs essentiels dans le contexte de fascisation actuelle accompagnant l’offensive capitaliste ultralibérale qui caractérise notre planète depuis plusieurs décennies. Il n’y aura en effet pas de pratique antifasciste efficace sans théorie antifasciste clarifiant les causes, enjeux et cibles. Sans théorie antifasciste, il n’y a pas et il ne peut pas avoir de pratiques antifascistes efficaces.
Les approches parcellaires du fascisme
Il existe une multitude de définitions « spontanées » du fascisme. Celles-ci sont en apparence « spontanées » au sens où les personnes qui en parlent ne les réfèrent pas à un corpus théorique précis ou à une analyse du fascisme identifiée. Au-delà de l’apparence cependant, ces définitions sont le reflet des luttes idéologiques entre classes sociales. En particulier le discours dominant sur le fascisme transmis par une multitude de canaux constituant les « appareils idéologiques d’État » (discours médiatique, contenus des enseignements des cours d’histoire, contenus et formes des commémorations, etc.), contribue à imposer « spontanément » certaines définitions et à en éliminer d’autres. Ainsi par exemple l’occultation du lien entre capitalisme et fascisme résumée dans le slogan de la bourgeoisie des années 1930 « plutôt Hitler que le Front populaire » contribue à nous habituer à détacher le fascisme de sa dimension de classe. Il est en conséquence essentiel de renouer avec une analyse systémique du fascisme. Ce dernier n’est jamais simplement le fait d’un homme et de sa folie ou d’une organisation fasciste accédant seule au pouvoir et bafouant la « démocratie ». Il est un résultat logique d’un système dans un contexte de rapports de force entre classes sociales précis. Il est un mode de gestion du rapport de classes dans un contexte de crise économique et de crise politique menaçant les classes dominantes.
Regardons du côté des définitions « spontanées » du fascisme. La première de ces définitions consiste à le réduire à sa forme dictatoriale ou violente et à l’opposer ainsi à la « démocratie ». Que le fascisme soit violent et dictatorial est une évidence. Que ce soient ces dimensions qui le distinguent d’autres formes de gouvernement l’est beaucoup moins. Faut-il rappeler que se sont de bons « républicains » qui ont massacrés à grande échelle et férocement les communards ? Faut-il remettre en mémoire que c’est la « République » qui instaura pendant des décennies une violence systémique dans les colonies ? Réduire le fascisme à la violence ou à la dictature c’est ainsi s’empêcher de comprendre les liens qu’il a avec le système capitaliste, c’est couper le fascisme comme idéologie et comme mode d’exercice du pouvoir de sa base matérielle, c’est-à-dire des intérêts de classe.
Une seconde idée « spontanée » est de définir le fascisme par sa dimension raciste. On insiste alors sur la racialisation qu’il opère, sur la division qu’il entretient au sein des classes populaires, sur sa construction de « boucs émissaire ». Que le fascisme soit raciste est également une évidence. Que ce soit le racisme qui le distingue des autres formes de gouvernement l’est beaucoup moins. En témoignent les multiples séquences historiques de racisme d’État avant et après les victoires fascistes des années 1930. Du traitement des « tsiganes » à celui des indigènes coloniaux en passant par l’antisémitisme, le racisme fut présent dans les périodes dites « démocratiques » depuis la naissance du capitalisme. Une nouvelle fois cette approche du fascisme conduit à couper celui-ci de sa base matérielle ou de classe.
Une troisième idée « spontanée » du fascisme consiste à le définir par une ou plusieurs de ses formes historiques, le plus souvent ses formes nazie ou mussolinienne. Cette approche occulte que le fascisme comme forme du pouvoir est doté d’une dynamique historique, c’est-à-dire qu’il adapte ses formes aux besoins du contexte. Il en est du fascisme comme du racisme pour lequel la forme historique peut varier pour préserver le fond. Le racisme a ainsi historiquement pris une forme biologique, puis après la défaite du nazisme et les luttes anticoloniales une forme « culturaliste », avant d’adopter aujourd’hui une forme « civilisationnelle » dans ses versions que sont l’islamophobie, la négrophobie, le racisme anti-rom ou anti-asiatique. Ceux qui adoptent cette approche attendent les défilés de chemises brunes. Ils oublient ainsi que le fascisme contemporain peut très bien s’accommoder du costume cravate ou du jeans.
Ces idées « spontanées », loin d’être neutres, aboutissent toutes à découpler le fascisme de sa base matérielle. L’approche parcellaire du fascisme empêche de saisir les liens entre ces différentes dimensions c’est-à-dire occulte la dimension systémique du fascisme.
Un fond de classe et des formes nationales et historiques
Le fascisme comme toutes les formes politiques est un concept soulignant ce qu’il y a de commun à de nombreuses réalités matérielles. Le concept d’arbre décrit ainsi ce qu’il y a de commun entre un chêne, un pin ou un baobab. Si le chêne est différent du baobab, ils appartiennent néanmoins tous les deux à la catégorie arbre. Le fascisme est ainsi un « fond » pouvant se traduire par une multitude de « formes ». L’enjeu de cette précision est de taille. Sans elle les formes contemporaines du fascisme deviennent imperceptibles. Les fascistes contemporains prennent dans leur grande majorité soin de se distinguer des formes historiques antérieures délégitimées par l’expérience historique du fascisme et les horreurs qui l’ont accompagnées.
La variabilité historique du fascisme est accompagnée d’une variabilité géographique ou nationale. Hier comme aujourd’hui le fascisme ne peut pas être indifférent aux héritages et aux histoires nationaux. Plusieurs aspects distinguaient le nazisme du mussolinisme ou du pétainisme. Les argumentaires antisémites par exemple n’avait pas la même place dans ces différents régimes fascistes. Il en est de même aujourd’hui où le discours fasciste s’adapte aux différents contextes nationaux. Le thème d’une pseudo « défense de la laïcité » n’a ainsi pas le même poids dans les différents discours fascistes nationaux. Il convient de se défaire de l’idée de l’existence d’une forme unique et pure du fascisme. Le fascisme n’a jamais de forme pure, il est toujours historiquement et nationalement situé.
De la même façon le fascisme ne peut pas se diagnostiquer à partir du discours qu’il tient sur lui-même. Très peu de fascistes aujourd’hui se définissent publiquement et explicitement comme fascistes. C’est d’ailleurs un des éléments de distinction de la période d’avant 1945 et de celle d’aujourd’hui. Beaucoup de militants antifascistes sous-estiment la victoire populaire qu’a été la défaite du nazisme ou n’en mesurent pas toutes les conséquences. Le mouvement ouvrier, le mouvement antifasciste et le mouvement anticolonial ont imposé durablement une frontière de légitimité rendant impossible ou difficile de se revendiquer explicitement du fascisme aujourd’hui. Le fascisme est ainsi contraint de se présenter différemment, de faire passer en contrebande sa marchandise en quelque sorte. Le combat essentiel aujourd’hui n’est pas de chasser le fasciste explicite mais de déceler l’idéologie fasciste dans des mouvements qui ne le revendiquent pas. Ceux-ci peuvent prendre des visages multiples pour neutraliser la frontière de légitimité posée par nos luttes : défense de la République, défense de la Nation, défense de la laïcité et même national-communisme, nationalisme socialiste, etc.
Le fascisme contemporain s’adapte au contexte actuel et prend donc une forme dominante différente des visages qu’il a pu avoir dans le passé. La lutte antifasciste ne peut en conséquence pas être limitée aux groupes explicitement fascistes.
Les approches idéalistes du fascisme
L’idéalisme est un courant philosophique expliquant le monde par les idées et leurs évolutions. Il s’oppose à un autre courant, le matérialisme, expliquant la réalité par les facteurs matériels et leurs évolutions. Les premiers expliquent la réalité sociale à partir des idées et les seconds expliquent les idées et théories à partir de leurs bases matérielles. Dans l’approche idéaliste du fascisme ce dernier s’explique par l’action d’un homme [Hitler, Mussolini, Pétain, Jean-Marie Le Pen]. Il n’y aurait aucun intérêt matériel en jeu dans l’avènement du fascisme mais simplement l’action néfaste d’un homme et de ses idées. On comprend dès lors l’intérêt de la classe dominante à diffuser des approches idéalistes du fascisme.
Refuser ces approches idéalistes ne signifie pas que les idées n’ont aucun rôle et qu’il est inutile de mener la bataille des idées. Simplement les idées à elles seules ne peuvent pas expliquer l’avènement du fascisme. Ces explications passent sous silence des questions aussi importantes que : « pourquoi ces idées prennent-elles dans certaines circonstances historiques et pas dans d’autres ? » ou « qui a intérêt à l’émergence des théorisations fascistes dans certains contextes précis ? ». Poser ces questions conduit en effet à s’interroger sur le rôle de la classe dominante dans l’émergence de forces fascistes et dans l’avènement d’un régime fasciste.
Toutes les explications en termes de « manipulateurs », de « gourous », de « charisme d’un leader », de « stratégie d’une organisation politique », etc., conduisent à une lutte inconséquente contre le fascisme en centrant celle-ci sur l’élimination ou la neutralisation des « perturbateurs » [par l’interdiction d’une organisation, la condamnation d’un leader, la mise en avant d’un « Front Républicain » pour faire barrage, etc.] en laissant de côté le système économique et social qui leur donne naissance, qui les encourage à certains moments et qui les appelle au pouvoir lorsqu’il est sérieusement mis en danger. Il ne suffira donc pas d’éradiquer des fascistes ou de les neutraliser [même s’il faut bien sûr le faire] pour éliminer définitivement le fascisme. Seul est un antifasciste conséquent celui qui ne se contente pas de combattre les fascistes explicites pour étendre le combat jusqu’au système social qui l’engendre. Un antifascisme conséquent ne peut pas ne pas être un anticapitalisme.
Cette explication idéaliste niant le lien entre capitalisme et fascisme présente donc le fascisme comme un accident de l’histoire lié aux circonstances particulières de la première guerre mondiale et au traumatisme qu’elle a constitué. Dans ce contexte de confusion sociale et de crise morale, des « manipulateurs » auraient trouvé le chemin de l’accès au pouvoir en s’appuyant sur le besoin de cadre et de stabilité des masses populaires frappées de plein fouet par la paupérisation. Le fascisme comme le bolchévisme seraient ainsi des accidents de l’histoire libérale. On retrouve cette thèse dès les années 1920 dans les écrits du dirigeant radical italien Francesco Nitti. On la retrouve également après la seconde guerre mondiale dans les analyses du leader du parti libéral italien Benedetto Croce pour qui le fascisme et le communisme sont tous deux de simples parenthèses historiques liées à des circonstances particulières. Bien sûr à aucun moment ces analyses ne s’interrogent sur les liens entre les classes sociales et le fascisme. L’intérêt d’une telle approche pour la classe dominante est de présenter le fascisme comme un phénomène du passé ne pouvant pas se reproduire aujourd’hui.
Une deuxième explication idéaliste du fascisme consiste à l’analyser comme une exceptionnalité nationale de certains pays. Le fascisme ne serait que le résultat logique des histoires allemande et italienne. Le fascisme serait le fait des pays ayant connu une unification tardive et une industrialisation rapide menées sous la direction d’une classe féodale se mutant en classe capitaliste. Les autres pays capitalistes seraient ainsi préservés du fascisme par leur héritage historique différent. Les chercheurs anglais Brian Jenkins et Chris Millington ont largement documenté la prédominance de cette thèse « exceptionnaliste » dans les analyses françaises du fascisme [le fascisme comme caractéristique spécifique et exceptionnelle de certaines histoires nationales] dans leur ouvrage paru en 2020 Le fascisme français : Le 6 février 1934 et le déclin de la République.
Une troisième analyse idéaliste du fascisme consiste justement à le présenter comme un anticapitalisme. Des groupes fascistes eux-mêmes n’hésitent pas à se présenter comme révolutionnaires ou anticapitalistes [ou anti-mondialisation, anti-Europe du capital, etc.]. Le terme de « totalitarisme » a été propulsé idéologiquement pour mettre dans le même sac des théories anticapitalistes et le fascisme. Dans les cours d’histoire les enfants apprennent ainsi que nazisme et communisme appartiennent à une même catégorie de régime. Les grands médias reprennent également régulièrement cet amalgame. Ce faisant ce sont toutes les tentatives d’émancipation sociale et politique qui sont délégitimées. Elles seront toutes présentées comme des fascismes parce que justement anticapitalistes.
Le pseudo « anticapitalisme » des fascistes n’est jamais la critique du capitalisme comme système. Il est généralement la critique du capitalisme des autres pays c’est-à-dire des concurrents du capitalisme français. C’est pourquoi il est fréquent d’entendre des fascistes critiquer le capitalisme états-unien ou allemand mais on n’entend jamais ces derniers critiquer sérieusement [cela peut arriver de manière conjoncturelle, tactique, momentanée] le capitalisme de leur nation. La critique du capitalisme comme système conduit en effet à une analyse de classe alors que la critique du capitalisme des concurrents conduit à la défense des intérêts de ma bourgeoisie contre ceux des intérêts des autres bourgeoisies. Le fascisme tente ainsi de récupérer par le nationalisme bourgeois les colères et révoltes anticapitalistes en essayant de les canaliser vers des cibles compatibles avec les intérêts de la classe dominante nationale. Dans chaque nation les fascistes s’inscrivent ainsi dans les intérêts de leur classe dominante confrontée aux contradictions d’intérêt avec les autres capitalismes, c’est-à-dire aux contradictions inter-impérialistes. C’est pourquoi les mêmes qui se disent anticapitalistes peuvent aussi se proclamer contre l’indépendance des colonies, celle-ci étant en contradiction avec les intérêts de la classe dominante.
Le capitalisme est d’abord un système social et économique basé sur l’exploitation, c’est-à-dire l’extorsion de la plus-value. Être anticapitaliste c’est agir pour abattre ce système et le remplacer par un autre exempt de l’exploitation, c’est-à-dire sans propriété privée des moyens de production. C’est pourquoi les fascistes ne peuvent pas être anticapitalistes. C’est pourquoi le combat idéologique antifasciste ne peut pas faire l’économie de la critique du programme économique des fascistes. Ceux-ci défendent la propriété privée, s’opposent à la hausse des salaires et des prestations sociales, refusent la taxation du capital, condamnent toute réduction du temps de travail, se prononcent pour l’allongement des durées de cotisations pour la retraite ou les prestations chômage, etc.
Une quatrième explication idéaliste du fascisme consiste à le définir d’abord par son racisme et ses discours à l’encontre de l’immigration. De nouveau le lien entre capitalisme et fascisme est ainsi occulté. Que le fascisme soit raciste est une évidence. Mais encore faut-il se poser la question de la fonction sociale et idéologique de ce racisme [qui au demeurant est loin de se limiter à la galaxie fasciste]. En présentant l’immigration comme cause des difficultés sociales, il s’agit pour les fascistes d’éloigner les prises de conscience des véritables causes qui sont liées au capitalisme en tant que système ne pouvant que générer [du fait même des lois de son fonctionnement] des crises et les paupérisations et précarisations qui vont avec.
Comme on le saisit tout n’est pas faux dans les explications idéalistes du fascisme. Il est vrai que le fascisme historique [tel que nous l’avons connu dans les années 1930] se caractérise par l’existence de leaders charismatiques, qu’il se développe dans les circonstances traumatisantes issues de la première guerre mondiale, que certaines histoires nationales ont été des terrains favorables au fascisme, que le racisme est un trait commun à tous les fascismes, etc. Ces vérités descriptives sont cependant systématiquement coupées de la question de la base matérielle c’est-à-dire des intérêts de classe que défend le fascisme.
Le pseudo « anticapitalisme » des fascistes
Le premier aspect du discours fasciste est son pseudo « anticapitalisme ». Des fascistes peuvent certes dans certaines périodes historiques se faire le porte-parole de révoltes sociales mais c’est toujours pour les détourner ou les dévoyer des véritables cibles des classes populaires. Un Alain Soral n’hésite ainsi pas à se réclamer de la « gauche du travail » en se proclamant simultanément à « la droite des valeurs ». C’est pourquoi nous devons apprendre à nous adresser à des personnes attirées par les fascistes pour leurs discours sur la « droite des valeurs ». Ces personnes sont dans une révolte que les fascistes dévoient. Nous sommes en présence d’une « révolte dévoyée ». Si le dévoiement doit être combattu, la révolte, elle, est saine.
Le second aspect du discours des fascistes se situe dans la nature des critiques faites au capitalisme [à la mondialisation, à l’Europe, etc.]. Ce qui est reproché au gouvernement en place, c’est sa « mollesse » par rapport aux pays capitalistes concurrents, c’est la défense jugée insuffisante de la « nation », c’est la pseudo absence de fermeté à l’égard des syndicats et des revendications sociales. À aucun moment le système capitaliste en tant que tel n’est remis en cause. Il est possible que soit critiqué tel ou tel aspect du capitalisme mais jamais ce dernier comme système. Les aspects du capitalisme critiqués par les fascistes sont toujours ceux correspondants aux colères sociales les plus importantes du moment. La logique ici présente est celle de la critique d’une partie pour préserver le tout, de la critique d’un aspect pour protéger le système.
La troisième dimension du discours fasciste est la fameuse défense des valeurs que nous avons évoquée plus haut à propos d’Alain Soral. L’approche commune à toutes les versions du fascisme est l’approche organiciste, c’est-à-dire qu’elles conçoivent la société comme un organisme dans lequel chaque élément a une place « naturelle » intangible. Selon cette approche la société est un organisme à l’image d’un corps humain et les classes sociales correspondraient aux différents organes de ce corps. Dans cette logique les classes sociales ne devraient pas s’opposer mais collaborer. Les rapports sociaux idéaux pour eux sont ceux qui respectent ces équilibres pseudo naturels que seraient la soumission de la femme à l’homme, du salarié à son patron, des gouvernés aux gouvernants. L’origine de ces « équilibres naturels » et leur fonction sociale sont évacuées de l’analyse. Ce faisant, ce qui est occulté, c’est que loin d’être naturels ces « équilibres naturels » produisent une hiérarchie sociale au service du capitalisme. Certains discours contemporains fascistes peuvent sembler contradictoires avec nos propos. Le Rassemblement national n’hésite pas aujourd’hui à se déclarer pour les droits des femmes ou pour la laïcité alors que toute l’histoire de ce courant de pensée témoigne de l’inverse. Cette « conversion » survient justement au moment où la laïcité comme les droits des femmes sont instrumentalisées par la classe dominante contre l’immigration, les musulmans ou supposés tels, les habitants des quartiers populaires, etc. La laïcité et les droits des femmes deviennent défendables à condition d’être intégrés à une logique islamophobe et/ou de « choc des civilisations ».
Le quatrième trait distinctif du discours des fascistes est la négation et l’opposition à la lutte des classes. Celle-ci est considérée comme affaiblissant la « nation » face aux concurrents. La fameuse unité nationale qu’ils défendent suppose la négation de l’existence de classes sociales aux intérêts divergents, c’est-à-dire de classes entrant inévitablement en lutte les unes contre les autres. Niant ce moteur de l’histoire qu’est la lutte des classes, les fascistes ne peuvent que se rabattre sur une présentation de « l’ordre » comme moteur de l’histoire. C’est pourquoi les fascistes considèrent que se sont les grands hommes et les élites qui font l’histoire. Hier avec des théories sur les races inférieures et aujourd’hui avec des discours sur le « choc des civilisations », c’est l’idée d’une hiérarchie naturelle des peuples au niveau international et celle d’une hiérarchie tout aussi « naturelle » des élites à l’échelle nationale, qu’ils défendent.
Une cinquième caractéristique du discours fasciste est l’explication qu’il avance des crises sociales. Alors que celles-ci sont le résultat du fonctionnement même du capitalisme, elles sont expliquées par les fascistes par la « mauvaise gestion », par « l’anarchie », par « l’absence de fermeté » des gouvernements successifs, par « la soumission aux mondialisme », etc. Une telle analyse conduit à un appel à « l’ordre », à la « fermeté », à la « priorité nationale », etc. Autrement dit, les réponses proposées aux crises du capitalisme consistent à exiger le renforcement des idéologies et pratiques historiquement liées au capitalisme. Le système qui engendre les crises est présenté comme solution à ces crises.
Enfin parmi les spécificités essentielles du discours fasciste on trouve la critique du parlementarisme dans une logique du « tous pourris ». Ils s’appuient pour ce faire sur de réels scandales du parlementarisme tel que nous le connaissons [non représentativité sociale des élus, carence de légitimité liée au fort taux d’abstention des classes populaires, poids prédominant de l’exécutif, etc.]. C’est pourquoi le discours antifasciste ne peut pas consister en une défense du parlementarisme qui n’est pas le nôtre mais qui est celui de la classe dominante. Il convient également de visibiliser les différences absolues entre la critique du parlementarisme des progressistes et celle des fascistes. Si eux critiquent le parlementarisme sur la base d’une exigence de moins de démocratie, notre critique se déploie elle sur la base d’une exigence de plus de démocratie directe. Ils pensent qu’il y a trop de démocratie, nous pensons qu’il n’y en a pas assez.
L’anticapitalisme des fascistes est toujours de façade, partiel, conjoncturel. Leur critique du parlementarisme dominant se déploie en direction d’une restriction des droits et libertés démocratiques alors même que le scandale de ce parlementarisme se situe dans une démocratie formelle et de façade.
Connaître l’héritage théorique antifasciste
Nous ne sommes pas les premiers à avoir tenté de comprendre la nature politique du fascisme. Il y a des générations de militants qui se sont battus avant nous et qui ont essayé d’analyser le fascisme avant nous. Nous disposons d’un héritage nous permettant d’éviter des erreurs qui ont été dramatiques dans le passé. Bien sûr cet héritage doit être adapté aux réalités contemporaines et aux nouveaux visages du fascisme. Sans être exhaustif, il n’est pas inutile de rappeler quelques-uns de ces héritages.
Commençons par la définition du fascisme lui-même. Un des premiers acquis des débats contradictoires qui ont caractérisé l’antifascisme est sa caractérisation de classe du fascisme. La nécessité de distinguer la nature de classes du fascisme d’une part et les classes qu’il mobilise pour accéder au pouvoir d’autre part, est un des acquis importants dont nous sommes héritiers. Si les cibles du fascisme sont les classes populaires et les couches moyennes déclassées, en cours de déclassement ou en crainte de déclassement, les intérêts de classe défendus par les fascistes sont ceux de la classe dominante et même d’une fraction particulière de cette classe, celle liée au capital financier.
Cette fraction de la bourgeoisie que Lénine définissait comme « la fusion du capital bancaire et du capital industriel » prend la forme de grands groupes industriels et financiers ou de fonds spéculatifs ne se contentant pas du profit moyen de chaque marché national mais étant à la recherche d’un profit maximum sur le marché mondial. Le capital financier n’hésite pas à déplacer ses capitaux d’une branche à l’autre, d’un pays à l’autre dans la quête d’une force de travail la moins payée possible afin de maximiser son profit. Logiquement la concurrence au sein de ce capital financier mondial est féroce. Chaque capital financier national s’appuie dès lors sur son État national pour défendre ses intérêts face aux autre capitaux nationaux et à leurs États. C’est pourquoi le capital financier national se caractérise aussi par son caractère chauvin. Si les multinationales regroupent des capitaux appartenant à des actionnaires de plusieurs pays, cela ne veut pas dire qu’elles n’ont plus un ancrage national. Ce regroupement de capitaux de plusieurs pays se réalise toujours sous la direction ou la domination d’un groupe industriel et/ou financier d’un pays. Chaque multinationale du point de vue de ses capitaux est en fait nationale du point de vue du groupe dirigeant. Ce dernier peut s’appuyer sur la politique étrangère de son État pour faire avancer ses intérêts, c’est-à-dire maximiser ses profits. C’est cette fraction du capital, la plus réactionnaire, la plus impérialiste et la plus chauvine qui dans certaines circonstances a besoin du fascisme pour maintenir ses profits.
Georges Dimitrov formule en 1935 une définition du fascisme qui reste, selon moi, d’une actualité brûlante. Ce communiste bulgare accusé par les nazis de l’incendie du Reichstag et qui transforme son audition devant les juges en procès du fascisme, définit le fascisme comme suit : « une dictature terroriste ouverte des éléments les plus réactionnaires, les plus chauvins et les plus impérialistes du capitalisme financier ». Le fascisme est donc à la fois en continuité avec le pouvoir classique de la bourgeoisie [dans les deux cas il s’agit d’un capitalisme et d’une bourgeoisie dominante] et en rupture avec lui [en ce qui concerne les moyens terroristes mobilisés par cette classe dominante]. D’autres analyses antifascistes se sont interrogées sur les circonstances historiques de développement du fascisme. Le communiste allemand August Thalheimer définit ainsi en 1929 le fascisme comme un régime d’exception prenant une forme bonapartiste, c’est-à-dire que la classe dominante confie le pouvoir à un « Bonaparte » afin de sauvegarder son pouvoir économique.
Ces analyses reliant fascisme et analyse de classe mettent en exergue que le fascisme se développe quand la classe dominante se sent menacée par le développement des luttes sociales, qu’il devient une hypothèse crédible pour cette classe lorsqu’elle est confrontée à une crise de légitimité et à une crise de gouvernementalité. C’est donc la classe dominante qui fait appel au fascisme lorsque son pouvoir lui semble menacé. C’est pour cette raison que les facteurs menant à une révolution et celles menant au fascisme sont fréquemment réunis simultanément. Le communiste anglais Palme Dutt développe ainsi en 1934 la thèse du fascisme comme résultat de trois circonstances : une bourgeoisie affaiblie par le développement des luttes sociales et une crise de légitimité ; une bourgeoisie restant cependant encore forte ; des couches moyennes déstabilisées et subissant un processus de déclassement. Dans ces circonstances, l’enjeu est la récupération de la révolte montante des classes populaires paupérisées et encore plus de la révolte grandissante des couches moyennes en voie de déclassement. Celles-ci orienteront-elles leurs colères contre le capitalisme ou contre un autre groupe social [les étrangers, les juifs, les musulmans, etc.] ? Telle est la question que se pose la classe dominante dans ces circonstances.
Souligner que le fascisme est en lien avec les intérêts de la classe dominante en général et avec ceux du capital financier en particulier ne signifie pas que nous sommes en présence d’un complot. Les fascistes ne sont pas seulement les outils de la classe dominante. Cette dernière estime généralement qu’elle pourra canaliser, contrôler ou limiter le fascisme. Le communiste italien Antonio Gramsci insiste ainsi sur le fait que les fascistes disposent d’une autonomie relative par rapport à la classe dominante. Ils jouent des luttes de pouvoir entre les différentes fractions du capital pour faire avancer leur propre agenda en se posant progressivement comme le dernier et seul recours face à la menace d’une révolution sociale. Il y a donc une offre de fascisme constituée par les organisations fascistes et une demande de fascisme constituée par d’abord certaines fractions de la classe dominante puis par des fractions plus importantes. Lorsque les deux se rencontrent la situation devient mûre pour que s’installe une dictature terroriste ouverte.
Quand l’offre ne correspond pas à la demande du fait que la bourgeoisie ne se sent pas suffisamment menacée, le fascisme ne trouve pas les conditions d’un accès au pouvoir. Cependant dans des circonstances de développement et de radicalisation importantes des luttes sociales, la classe dominante n’hésitera pas à emprunter au fascisme ses analyses, ses propositions et une partie de ses méthodes. Nous sommes alors en présence d’un processus de fascisation de l’appareil d’État.
Le processus de fascisation
Les quelques analyses ci-dessus exposées, constitutive de notre héritage antifasciste, ne sont pas exhaustives. Il en existe de nombreuses autres que nous ne pouvons pas exposer dans cette séance pour des raisons de temps. Elles suffisent cependant pour tordre le coup à quelques idées erronées encore trop fréquentes dans les rangs antifascistes. La première erreur consiste à analyser le fascisme comme l’arrivée brusque et instantanée d’un régime dictatorial. Ce qui est sous-estimé dans cette thèse est la séquence qui précède le fascisme c’est-à-dire le processus de fascisation. Bien avant que d’avoir besoin d’un pouvoir fasciste, la classe dominante se sert de son État pour réagir à la montée des luttes sociales. La répression de plus en plus violente de ces luttes, la restriction des droits et libertés démocratiques, la dissolution d’organisations contestataires, la modification de la législation vers une logique autoritaire et sécuritaire grandissante, la construction de groupes sociaux en boucs émissaires, etc., précèdent l’arrivée au pouvoir des fascistes. Ce n’est que quand ces mesures s’avèrent inefficaces et que le pouvoir est immédiatement menacé que la fascisation passe un seuil qualitatif en se mutant en fascisme.
En lien avec cette première erreur s’en trouve une seconde consistant à considérer que le fascisme vient au pouvoir par la violence. Cela peut certes survenir mais généralement c’est en toute légalité que les fascistes arrivent au pouvoir et transforment ensuite celui-ci en dictature terroriste ouverte. Le processus de fascisation réuni les conditions du fascisme pour rendre celui-ci possible si la classe dominante venait à en avoir besoin. C’est en ce sens que l’on peut dire que la fascisation est l’antichambre du fascisme. Mais cela ne veut pas dire que la fascisation mène systématiquement au fascisme. Il n’y a aucun déterminisme historique absolu à ce niveau. Tout dépend du rapport des forces. C’est ainsi le roi Victor Emmanuel III qui confie à Mussolini les rênes du pouvoir après la marche sur Rome des fascistes. C’est également le président Hindenburg qui nomme Hitler chancelier.
La troisième erreur est celle que nous avons déjà soulignée, c’est-à-dire la confusion entre le fascisme et l’une de ses formes historiques. Le fascisme contemporain peut prendre des formes historiques nouvelles. Il ne défilera pas forcément avec des chemises brunes. Il peut très bien surgir du sein même de l’appareil d’État actuel et de la démocratie parlementaire actuellement en place. Il peut être le fait d’une mutation qualitative de membres de la classe politique « démocrates » et « républicains ». Prendre en compte la diversité des origines possibles du fascisme c’est revenir à cette notion « d’autonomie relative » des fascistes dont parlait Gramsci. Il n’existe pas un seul bloc fasciste mais une galaxie fasciste caractérisée par la diversité de ses analyses.
Nous n’avons pas le temps nécessaire pour décrire toute cette diversité. Contentons-nous de rappeler deux de ses principaux courants. Le premier se base sur une logique centrée sur l’affirmation de l’existence d’un danger que subirait la « civilisation occidentale » du fait de la montée de « l’islamisme » pour certains, de la montée de l’Islam pour d’autres, de l’immigration que l’on prétend devenue massive pour d’autres encore. L’idéologue de la bourgeoisie Samuel Huntington a théorisé cette approche dans ses livres Le choc des civilisations et Qui sommes-nous ? Identité nationale et choc des cultures. Un des visages principaux du fascisme [du discours sur le péril musulman à la thèse du « grand remplacement » en passant par celle d’une identité nationale menacée par l’immigration] s’origine de ce postulat d’une guerre des civilisations. L’aura de cette thèse dépasse largement l’extrême-droite, faisant d’elle une des assises centrales de justification de la fascisation de l’appareil d’État. C’est pourquoi se limiter à l’affrontement avec les groupes explicitement fascistes ou d’extrême-droite sans combattre la fascisation de l’appareil d’État est une autre erreur possible. Le second courant est plus classique et est constitué du « nationalisme révolutionnaire » mettant en avant des thèses proches du fascisme que nous avons connu dans les années 1930 [critique du parlementarisme, appel à l’ordre moral, racisme explicite, etc.].
Ces deux courants ont néanmoins un point commun essentiel : la présentation de la lutte des classes comme divisant la nation, comme destructrice de l’unité nationale, comme complicité objective face au péril civilisationnel qui nous menacerait.
Sur notre séquence historique
Nous sommes actuellement dans une séquence historique caractérisée par l’arrivée au pouvoir depuis plus de quatre décennies du néolibéralisme sous la forme d’une mondialisation capitaliste. Ce néolibéralisme n’est rien d’autre que la politique économique correspondant aux intérêts des monopoles et grands groupes du capital financier. Basée sur une course mondiale à la maximisation du profit cette phase néolibérale se concrétise par la destruction des conquêtes sociales, par une délocalisation massive à la recherche des coûts toujours plus bas du travail, par une flexibilisation généralisée du travail, un repli de l’État sur ses seules fonctions régaliennes [le maintien de l’ordre, la justice et la défense guerrière des intérêts du capitalisme français et européen au niveau international]. La conséquence en est une paupérisation massive des classes populaires et un déclassement social des couches moyennes.
Une autre conséquence de la mondialisation capitaliste est l’exacerbation de la concurrence entre les différents pays capitalistes qui se concrétise par le développement des guerres pour la maîtrise des sources de matières premières et par une militarisation croissante. Le développement des discours chauvins sur l’identité nationale menacée n’est que l’expression de cette base matérielle que constitue la lutte entre les puissances impérialistes pour se partager le monde.
Nous sommes également dans un contexte de développement et de radicalisation des luttes sociales concrétisé par le mouvement contre les réformes des retraites, celui des cheminots contre la privatisation, celui des Gilets jaunes, celui contre les violences policières, etc. Après une phase de deux décennies de recul face à la logique implacable de la mondialisation capitaliste, le temps est de nouveau celui des luttes sociales grandissantes. La pandémie du coronavirus, en mettant en exergue les conséquences des choix économiques néolibéraux des dernières décennies, accroit encore plus la colère sociale et plonge la classe dominante dans une crise de légitimité importante. Les prises de conscience d’une cause systémique de la paupérisation et de la précarisation massive connaissent un progrès inédit depuis le tournant néolibéral des décennies 1970 et 1980. La possibilité de mouvements sociaux de grande ampleur est présente et anticipée dans les analyses et les choix du gouvernement. Bien sûr, ces mouvements sociaux ne constituent pas un danger immédiat pour la classe dominante. Cependant cette dernière possède une expérience historique lui permettant de saisir les dangers potentiels de la situation sociale actuelle. Il ne faut jamais sous-estimer notre ennemi.
Ce contexte d’une bourgeoisie affaiblie mais encore forte et d’un mouvement social en progression importante mais encore insuffisamment puissant permet d’expliquer la fascisation actuelle de l’appareil d’État. La reprise par Macron et ses ministres de pans entiers d’analyses jusque-là spécifiques à l’extrême-droite reflète cette fascisation, de même que les mesures liberticides contenues dans l’entrée dans le droit commun de l’État d’urgence, dans la loi sur la « sécurité globale » ou dans celle contre le pseudo-séparatisme. Si la classe dominante n’a pas encore besoin du fascisme, elle en prépare les conditions au cas où l’évolution de la situation sociale le rendrait nécessaire. Dans cette préparation de l’hypothèse fasciste comme dernier recours, la classe dominante entretient deux fers au feu : la tolérance vis-à-vis de groupes plus ou moins explicitement fascistes d’une part et l’accélération de la fascisation de l’appareil d’État d’autre part.
Dans ce contexte il est illusoire de combattre le fascisme en sous-estimant la gravité de la fascisation de l’appareil d’État. Il est tout aussi illusoire de sous-estimer le combat contre les groupes explicitement fascistes. Une fois au pouvoir ces groupes ne pourront être combattus que par la lutte armée comme au temps du nazisme. C’est dès aujourd’hui que nous sommes confrontés au double combat contre la fascisation et contre les groupes fascistes.
[1] Antonio Gramsci, Cahier de Prison 8, in Gramsci dans le texte, éditions sociales, Paris, 1975, p. 572.
[2] Antonio Gramsci, Cahiers de prison, Cahier 3, Gallimard, Paris, 1996, p.298.
[3] Pascal Boniface, Les Intellectuels faussaires : Le triomphe médiatique des experts en mensonge, Gawsewitch, Paris, 2011.
[4] Michel Onfray, Faire la guerre, https://michelonfray.com/interventions-hebdomadaires/faire-la-guerre, consulté le 11 mai 2020 à 8 h 30.
[5] Alain Finkielkraut, Le nihilisme n’a pas encore vaincu, nous demeurons une civilisation, Le Figaro du 27 mars 2020.
[6] « La crise sanitaire ne justifie pas d’imposer les technologies de surveillance », Communiqué de l’Observatoire des Libertés et du Numérique (OLN) du 8 avril 2020.
[7] Fiche-replis communautaires, Coronavirus et replis communautaristes, Ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse, p. 1.
[8] Ibid., p. 2.
[9] « Prévenir pour protéger », Plan national de prévention de la radicalisation, Service de Presse de Matignon, 23 février 2018, p. 9.
[10] Fiche-replis communautaires, op. cit., p. 2.
[11] Manuel Lafont Rapnouil, L’Effet Pangolin : la tempête qui vient en Afrique ?, Note diplomatique du Centre d’analyse, de Prévision et de Stratégie NDI 2020 – 0161812, Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères, 24 mars 2020, pp. 1, 3 et 4.
[12] Antonio Gramsci, Cahiers de prison, Cahier 3, Gallimard, Paris, 1996, p.283.