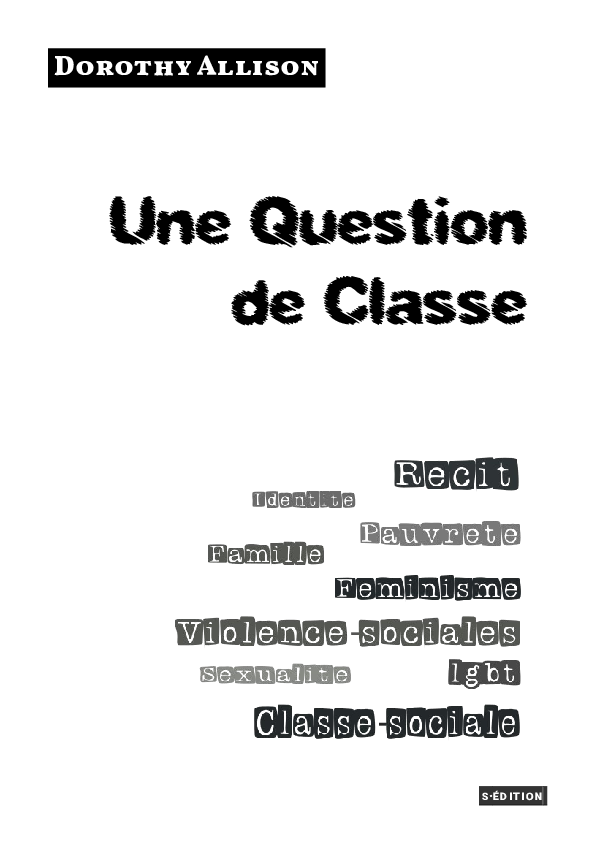Dorothy Allison — une question de classe
Temps de lecture : ~ 54 minutes
Ces textes sont extraits de « Skin, talking about sex, class and literature » (Firebrand Books, Ithaca, New York, 1994), un recueil de plusieurs essais de Dorothy Allison parus dans des revues américaines.
Il s’agit de versions légèrement remaniées (à partir des versions originales) des traductions français parues dans “Peau” (Éditions Balland, Paris, 1999), tiré de la brochure au format A5 disponible sur infokioques.net.
[Ce récit aborde le sujet des violences familiales et sexuelles.]
Contexte
Un été, il y a presque dix ans, j’ai emmené ma copine rendre visite à ma
tante Dot ainsi qu’au reste de la famille de ma mère à Greenville. Nous
avons pris notre temps pour y aller, passant une journée à Washington et
une autre à Durham. J’ai même pensé lui suggérer un détour par les Smoky
Mountains, jusqu’à ce que je réalise que la raison pour laquelle j’y
pensais était la peur. Ce n’était pas ma famille que je craignais.
C’était ma copine. J’avais peur d’amener ma copine à la maison à cause
de l’expression que je pourrais lire sur son visage une fois qu’elle
aurait passé un peu de temps avec ma tante, rencontré quelques-uns de
mes oncles et essayé de parler à n’importe lequel de mes cousins. Je
craignais la distance, la peur ou le mépris qui, je l’imaginais,
pourraient apparaître entre nous. J’avais peur qu’elle me voie avec des
yeux nouveaux, des yeux odieux, les yeux de quelqu’une qui aurait
soudain complètement compris combien nous étions différentes. La
froideur de ma tante, sa méfiance envers mes cousins ou le dédain de mon
oncle me semblaient moins menaçants.
J’ai eu raison de m’inquiéter. Ma copine m’a en effet vue avec des yeux
nouveaux, pourtant il s’avéra qu’elle craignait moins sa propre peur ou
le malaise qui pouvait s’installer entre nous que le fait que je pusse
m’éloigner d’elle.
Ce que j’ai lu sur son visage après le premier jour en Caroline du Sud
ne correspondait à rien de ce que je prévoyais. ses traits étaient
marqués par une sorte de crainte ténue, de confusion, de doute et de
honte. Tout ce qu’elle a pu me dire est qu’elle n’avait pas été
préparée. Ma tante Dot lui a souhaité la bienvenue, lui a servi du thé
glacé dans un grand verre, et l’a installée à la meilleure place autour
de la table de la cuisine, celle près de la fenêtre, là où la fumée de
cigarette de mon oncle ne la gênerait pas. Mais ma copine a à peine
parlé.
« C’est une sorte de dialecte, n’est-ce pas, m’a-t-elle dit cette nuit
là dans la chambre du motel. Je n’ai pas compris un mot sur quatre de
tout ce qu’a dit ta tante. » Je l’ai regardée. L’accent de tante Dot
était prononcé mais je ne l’avais jamais pris pour un dialecte. C’était
juste qu’elle n’avait jamais quitté le comté de Greenville. Elle avait
une télévision, mais elle était pour les enfants, dans le living-room.
Ma tante passait sa vie à cette table de cuisine.
Ma copine s’appuya sur mon épaule, la joue posée contre ma clavicule.
« Je pensais que je savais à quoi cela ressemblerait – ta famille,
Greenville. Tu m’avais raconté tellement d’anecdotes. Mais les mots… »
Elle leva la paume de sa main en l’air et tendit les doigts comme si
elle cherchait à exprimer une idée.
« Je ne sais pas, dit-elle. Je pensais comprendre ce que tu voulais dire
quand tu disais « classe ouvrière », mais il me manquait un contexte. »
J’étais étendue, immobile. Bien que l’air conditionné du motel marchât à
fond, je pouvais sentir la chaleur moite du dehors. Elle passait quand
même à travers les portes et les fenêtres, une odeur de terre
marécageuse qui me ramenait à l’âge de dix ans, quand je descendais pour
dormir à même le sol avec mes sœurs, espérant qu’il y ferait un peu plus
frais. Nous n’avions jamais eu l’air conditionné, nous n’avions jamais
séjourné dans un motel, nous n’avions jamais mangé dans un restaurant où
ma mère ne travaillait pas. Le contexte. J’ai respiré l’odeur de métal
humide du climatiseur et me suis souvenue de Folly Beach.
Lorsque j’avais environ huit ans, mon beau-père nous y avait conduites
par la route qui venait de Charleston, et nous nous étions installé·es
tou·tes les cinq dans une seule pièce qu’un de ses amis de travail avait
mis à notre disposition. Ce n’était pas un motel. C’était une pension,
et la femme qui la dirigeait ne semblait pas très ravie que nous nous
présentions pour une chambre que quelqu’un avait déjà payée pour nous.
Je dormais dans un lit d’enfant pliant qui menaçait de s’effondrer. Mes
sœurs dormaient ensemble dans le lit en face de celui de mes parents. Ma
mère cuisinait sur un réchaud à deux feux pour nous économiser le coût
de repas pris dehors, et notre petite fête c’était de la nourriture à
emporter – du poisson frit dont mon beau-père jurait qu’il était
mauvais, et des hamburgers qui venaient du même endroit. Nous étions
impressionnées par la douche extérieure sous les escaliers où nous
devions rincer le sable que nous ramenions de la plage. Nous avions très
envie de louer un de ces canoës, parasols, et bicyclettes que l’on
pouvait se procurer sur la plage. Mais mon beau-père soutenait que
toutes ces choses étaient proposées à des tarifs de voleur, et il
maudissait l’homme qui essayait de nous tenter avec. Cela nous importait
peu. Nous étions comblées par la simple liberté de passer de vraies
vacances dans des lieux publics qui obligeaient mon beau-père à
surveiller son caractère, et par celle de courir partout en maillot de
bain et en tongs.
Nous sommes resté·es une semaine. Par deux fois mon beau-père nous a
envoyées à la plage pendant que lui et ma mère sont restés dans la
chambre. Nous en avons profité pour suivre les faits et gestes d’autres
familles, pour écouter les pères faire des éloges de leurs fils et
regarder les mères rougir de fierté en voyant comment les gens
regardaient leurs filles. Nous avons écouté les accents et étudié les
menus de pique-nique. Chacun était étrange et merveilleux. En
vacances.
Mon beau-père ne s’emporta qu’une seule fois durant ce voyage. Il était
horrifié par les prix pratiqués dans les magasins de souvenirs et nous
faisait garder nos mains dans nos poches.
« Ces salauds de juifs me feront payer si vous cassez quelque chose »,
jura-t-il.
ses paroles m’ont fait tressaillir et aussi réaliser que l’homme
derrière le comptoir l’avait entendu. Je l’ai vu rougir violemment alors
qu’il suivait du regard mon beau-père qui se dirigeait vers la porte.
Puis j’ai vu son coup d’œil sur moi et mes sœurs, reflétant le même
mépris que celui destiné à mon beau-père. Une chaleur est montée dans ma
nuque et j’ai voulu m’excuser – lui dire que nous n’étions pas comme
notre beau-père – mais je ne pouvais rien faire. Je ne pouvais rien lui
dire devant mon beau-père, et si je l’avais fait, pourquoi m’aurait-il
crue ? Souviens-t’en, ai-je pensé. N’oublie jamais ce que tu as vu,
entendu et ressenti. J’ai serré les dents et gardé la tête bien droite,
j’ai regardé cet homme dans les yeux et prononcé sans un bruit, « je
suis désolée », mais je ne sais pas s’il a saisi.
Quel contexte avait-il pour des gens comme nous ?
Après que ma copine se fut endormie cette première nuit à Greenville, je
suis restée allongée, longtemps éveillée. Ma copine était une Yankee de
bonne famille, qui avait passé les étés de son enfance sur les rivages
du New Jersey. J’étais allée là-bas avec elle, j’avais marché avec elle
sur les plages de son enfance, larges et plates, d’un gris très clair,
si propres qu’elles m’intimidaient. Après avoir vu où elle avait grandi
et rencontré quelques membres de sa famille je la comprenais mieux, je
voyais d’où venaient certaines de ses peurs et d’où venait sa fierté.
Qu’avait-elle compris à mon sujet aujourd’hui ? Je m’interrogeais.
J’ai tourné la tête sur le côté pour la regarder dormir, ses lèvres
légèrement appuyées contre ma peau. ses cheveux étaient foncés et
brillants, ses dents droites et blanches. Je me demandais ce qu’elle
aurait pensé de Folly Beach, côte du New Jersey des pauvres gens, ou de
nous, si elle avait pu nous y voir. Une vieille honte me submergea, puis
je me résolus à la chasser.
Le contexte, c’est si peu à partager, et c’est si vital.
Une question de classe
La première fois que j’ai entendu « ils sont différents de nous, ils
n’accordent pas la même valeur que nous à la vie humaine », j’étais au
lycée en Floride. L’homme qui parlait était un recruteur de l’armée
s’adressant à une bande de garçons, leur expliquant ce qu’était vraiment
l’armée et ce à quoi ils devaient s’attendre outre-mer. Un sentiment de
colère froide m’avait envahie. J’avais entendu le mot ils prononcé sur
le même ton dur, avant. Ils, ces gens là-bas, ces gens ne sont pas
nous, ils meurent si facilement, s’entre-tuent si aisément. Ils sont
différents. Nous, j’ai pensé. Moi.
Lorsque j’avais six ou huit ans à Greenville, en Caroline du Sud,
j’avais entendu ce même ton de rejet, en l’occurrence employé à mon
égard. « Ne joue pas avec elle. Je ne veux pas que tu leur parles. » Ma
famille et moi, nous avons toujours été eux. Qui suis-je ? me
demandai-je en écoutant ce recruteur. Qui sont mes semblables ? Nous
mourons si facilement, disparaissons si sûrement – nous/elles/eux, les
pauvres et les queers. J’ai pressé mes pauvres poings blancs osseux
contre ma bouche de lesbienne têtue. La fureur était une bonne
sensation, plus forte et plus pure que la honte qui lui succédait, que
la peur et l’envie soudaine de courir et de se cacher, de nier, de faire
semblant de ne savoir ni qui j’étais ni ce que le monde me faisait.
Les gens comme moi n’étaient pas remarquables. Nous étions ordinaires
mais, même ainsi, nous étions des mythes. Nous étions ce eux dont tout
le monde parle – les pauvre bougres. J’ai grandi en essayant d’échapper
au sort qui a détruit tant de gens que j’aimais, et, ayant pris
l’habitude de me cacher, j’ai découvert que j’avais aussi pris celle de
me cacher de moi-même. Je ne savais pas qui j’étais, je savais seulement
que je ne voulais pas être eux, ceux et celles qui sont détruit·es ou
écarté·es pour que les « vraies personnes », les gens importants, se
sentent plus en sécurité. Une fois que j’ai compris que j’étais queer,
cette habitude de me cacher était ancrée en moi, si profondément que ce
n’était plus un choix mais de l’instinct. Se cacher, se cacher pour
survivre je pensais, étant entendu pour moi que si je disais la vérité
sur ma vie, ma famille, mon inclination sexuelle, mon histoire je me
retrouverais dans ce territoire inconnu, le pays des ils, sans jamais
aucune chance de mettre un nom sur ma propre vie, de la comprendre ou de
la revendiquer.
Pourquoi as-tu si peur ? me demandaient mes amies et amantes toutes les
fois où je semblais soudainement être étrangère, quelqu’une qui ne leur
parlait plus, qui ne faisait plus les choses que d’après elles je devais
faire, des choses simples comme faire une demande d’emploi, de bourse,
ou de prix dont elles étaient sûres que je les obtiendrais facilement.
Le bon droit, je leur ai dit, c’est de se sentir nous plutôt que
eux. Vous pensez que vous avez droit à des choses, que vous avez une
place sur cette terre, et ça fait tellement partie intégrante de vous
que vous ne pouvez pas imaginer des gens comme moi, des gens qui
semblent vivre dans votre monde mais qui n’en font pas partie. J’ai
expliqué ce que je sais encore et encore, de toutes les façons
possibles, mais je n’ai jamais été capable de faire comprendre le degré
de ma peur, jusqu’à quel point je me sentais niée : non seulement
j’étais homosexuelle dans un monde qui hait les homosexuel·les, mais
j’étais née pauvre dans un monde qui méprise les pauvres. Le besoin de
rendre mon monde crédible pour des gens qui ne le connaissent pas
constitue en partie la raison pour laquelle j’écris. Je sais que
certaines choses doivent être ressenties pour être compris·es, que le
désespoir, par exemple, ne peut jamais être analysé de façon
suffisante ; il doit être vécu. Mais si je peux écrire une histoire qui
entraîne ma lectrice au point qu’elle s’imagine être mes personnages,
qu’elle ressent leur degré de peur et de doute, leurs espoirs et leurs
angoisses, alors je serai parvenue à me sentir plus réelle, aussi
importante que ces mêmes gens que j’ai toujours regardés avec crainte et
respect.
Je sais que je suis lesbienne depuis mon adolescence, et j’ai passé une
bonne vingtaine d’années à panser les plaies de l’inceste et des mauvais
traitements. Mais ce qui est sans doute le fait marquant de ma vie,
c’est d’être née en 1949 à Greenville, en Caroline du Sud, et d’être la
fille naturelle d’une femme blanche issue d’une famille dés·espérément
pauvre, une femme qui avait quitté la quatrième l’année précédente,
travaillé comme serveuse, et avait juste quinze ans et un mois
lorsqu’elle m’avait eue. Ce fait, l’impact auquel je n’ai pu échapper
d’être née dans des conditions de pauvreté que cette société trouve
honteuses, méprisables et quelque part méritées, a eu le dessus sur moi
à un point tel que j’ai passé ma vie à essayer de le surmonter ou de le
nier. J’ai appris avec beaucoup de douleur que la grande majorité des
gens pensent que la pauvreté est une condition de vie volontaire.
J’ai aimé ma famille si obstinément que chaque geste pour la maintenir
dans le mépris a allumé chez moi un contre-feu de fierté – compliqué par
l’envie sous-jacente de nous couler dans les mythes et les théories
acceptables de la société en général et de sa réinterprétation
lesbienne-féministe. Le choix devient : soit les films de Steven
Spielberg et les romans de Erskine Caldwell, l’un mettant en valeur et
l’autre caricaturant, soit le patriarcat comme scélérat, banalisant les
choix que les hommes et les femmes de ma famille ont faits. J’ai eu à
combattre de vastes généralisations issues de tous les points de vue
théoriques.
La théorie féministe traditionnelle a eu une compréhension limitée des
différences de classes ainsi que de la façon dont la sexualité et le moi
sont façonnés à la fois par le désir et par le déni. Cette théorie
suggère que nous sommes toutes des sœurs qui devrions seulement diriger
notre colère et notre méfiance vers le monde extérieur à la communauté
lesbienne. Il est facile de dire que le patriarcat est la cause de tout,
que la pauvreté et le mépris sont des produits de la société
patriarcale, et j’ai souvent ressenti le besoin de confondre mon vécu
sexuel avec ce que j’étais d’accord de partager de mes origines de
classe, de prétendre que ma vie en tant que lesbienne et ma vie de femme
issue de la classe ouvrière étaient toutes deux construites par le
patriarcat. Ou, inversement, d’ignorer combien ma vie fut façonnée par
le fait de grandir pauvre et de ne parler que de l’influence de
l’inceste sur mon identité de femme et de lesbienne. La difficulté
réside dans ce que je ne peux pas imputer purement et simplement la
source de mes problèmes dans la vie ni au patriarcat, ni à l’inceste, ni
même à la structure de classes de notre société, invisible et objet de
déni.
Au sein de mon collectif lesbien-féministe nous avons eu de longues
conversations au sujet de la séparation corps/esprit, et de la manière
dont nous compartimentons nos vies pour survivre. Durant des années j’ai
pensé que ce concept renvoyait à ma façon de séparer ma vie engagée,
activiste, de ma vie secrète, passionnée, à travers laquelle
j’assouvissais mes désirs sexuels. J’étais convaincue que la fracture
était assez simple, qu’elle serait résolue avec le temps lorsque j’y
verrais plus clair – à peu près au moment où je commencerais à
comprendre le sexe. Jamais je n’imaginais que ce n’était pas une
scission mais une fragmentation, et j’ai traversé des parties entières
de ma vie – des jours, des mois, des années – à progresser de façon
purement dirigée, me levant tous les matins et me mettant au travail,
travaillant tellement et si continuellement que j’évitais par n’importe
quel moyen d’analyser ce que je savais de ma vie. Travailler devenait
une transe. J’ignorais qui j’étais vraiment et comment j’étais devenue
cette personne, je continuais dans cette avancée journalière, j’étais
devenue une automate qui n’existe que par son travail.
J’ai essayé de faire partie de la communauté lesbienne féministe afin de
me sentir réelle et valorisée. Je ne me rendais pas compte que je me
cachais, me fondant au milieu des autres par sécurité comme je l’avais
fait au lycée, à l’université. J’ai trop connu cette attitude pour
l’oublier. Je croyais que toutes ces choses dont je ne parlais pas, ou
auxquelles je ne voulais même pas trop penser, n’étaient pas
importantes, qu’aucune ne me définissait. J’avais bâti une vie, une
identité dont j’étais fière, j’avais une autre famille, la famille
lesbienne, dans laquelle je me sentais en sécurité, et je n’avais pas
réalisé que mon moi fondamental avait presque disparu.
Il était facile de vivre cette vie à un point surprenant. Tout un chacun
concourait à ce processus. Tout dans notre culture – livres, télévision,
films, école, mode – est présenté comme étant vu, entendu, ou façonné
par une seule et unique personne. Même si vous savez que vous ne
partagez en rien cet imaginaire standard – si vous aimez la country
music et pas le classique, si vous lisez les livres avec un certain
cynisme, si vous restez incrédule face aux informations que vous
écoutez, si vous être lesbienne et pas hétérosexuelle, et vivez entourée
de votre petite communauté déviante – vous êtes tout de même
conditionnée par cet hégémonisme, ou par votre résistance à celui-ci. Le
seul moyen que j’ai trouvé pour résister à cette vision hégémonique du
monde fut de m’inclure moi-même dans quelque chose de plus grand que
moi. Comme féministe et militante lesbienne radicale, et plus tard comme
militante sexe-radicale (ce qui plus tard devint le terme, avec
féministes pro-sexe, pour désigner celles qui n’étaient pas
anti-pornographie mais anti-censure, celles d’entre nous qui défendaient
la diversité sexuelle), le besoin d’appartenance, afin de me sentir en
sécurité, était tout aussi important pour moi que pour n’importe quelLE
hétérosexuelLE, citoyenNE apolitique, et parfois même plus important
puisque le reste de ma vie était fortement engagé dans le combat.
La première fois que j’ai lu les poèmes d’Irena Klepfisz[1], lesbienne
et juive, j’ai éprouvé comme un frisson de reconnaissance. Non pas que
mes semblables aient été « rayé·es de la carte » ou assassiné·es comme
l’ont été les siennes. Non, nous avions été encouragé·es à nous détruire
nous-mêmes, on nous avait rendu·es invisibles parce que nous ne collions
pas au mythe, engendré par la classe moyenne, des bons pauvres. Même
maintenant, à quarante ans passes et obstinément fière de ma famille, je
ressens le poids de cette mythologie, de cette vision romancée et
tronquée des pauvres. Je me retrouve à regarder vers mon passé en me
demandant ce qui a été réel, ce qui a été vrai. À l’intérieur de ma
famille, tant de choses étaient sujettes à mensonges, plaisanteries,
dénis, ou dites de façon délibérément indirecte, d’une sourde
humiliation, ou accompagnées d’une brève grimace pincée qui démentait
tout ce qui venait d’être dit. Qu’est-ce qui était vrai ? La pauvreté
décrite dans les livres et les films était romantique, servant de toile
de fond à l’histoire de personnages qui arrivaient à s’en échapper.
La pauvreté dont les intellectuels de gauche faisaient le portrait était
tout aussi romantique, une tribune pour taper sur les hautes et moyennes
classes, et, dans leur perspective, le héros de la classe ouvrière était
invariablement masculin, vertueusement indigné, et inhumainement noble.
La réalité faite de haine de soi et de violence était ou absente ou
caricaturée. La pauvreté que je connaissais était monotone,
anesthésiante, honteuse ; les femmes y avaient du pouvoir mais sur des
critères qui n’apparaissaient pas comme héroïques au reste de la
société.
On ne voyait les vies de ma famille ni à la télévision, ni dans les
livres, ni même dans les bandes dessinées. Il existait un mythe des
pauvres dans ce pays mais il ne nous incluait pas, malgré tous les
efforts que je faisais pour nous y faire rentrer de toutes mes forces.
Il y avait une notion de bon·nes pauvres – travaillant dur,
déguenillé·es mais propres, et intimement honorables. J’ai compris que
nous étions les mauvais·es pauvres : les hommes buvaient et étaient
incapables de garder un travail ; les femmes, invariablement enceintes
avant le mariage, devenaient rapidement usées, grosses et vieilles
d’avoir trop travaillé et porté trop d’enfants ; les enfants avaient le
nez qui coule, les yeux humides et des mauvaises manières. Mes cousins
ont quitté l’école, volé des voitures, pris de la drogue et fait des
métiers qui ne mènent à rien comme pompistes ou serveurs. Nous n’étions
ni nobles, ni reconnaissant·es, ni même plein·es d’espoir. Nous nous
savions méprisé·es. Les membres de ma famille avaient honte d’être
pauvres et de n’avoir aucun espoir. Travailler, économiser, lutter ou se
battre pour quoi ? Nous avions eu les générations précédentes pour nous
apprendre que rien n’avait jamais changé et que celles et ceux qui
avaient tenté d’y échapper avaient échoué.
Ma maman avait onze frères et sœurs et je ne connais le nom que de six
d’entre elles/eux. Aucun·e n’est encore vivant·e pour me dire le nom des
autres. C’est ma grand-mère qui m’a parlé de mon vrai papa, un bel homme
sans ambition qui s’était marié, avait eu six enfants, et qui vendait
des assurances-vie au rabais à des Noir·es sans le sou. Ma maman s’est
mariée quand j’avais un an, mais son mari est décédé un an plus tard,
just·e après la naissance de ma petite sœur.
Lorsque j’avais cinq ans, maman s’est mariée avec l’homme qui allait
partager sa vie jusqu’à sa mort. Durant leur première année de mariage,
maman a fait une fausse couche et, pendant que nous attendions à
l’extérieur sur le parking, mon beau-père m’a frappée pour la première
fois, un geste qu’il a continué de faire jusqu’à mes treize ans passes.
Lorsque j’avais peut-être huit ans, maman nous a emmenées dans un motel
après que mon beau-père m’eut tellement battue que cela avait causé un
scandale dans la famille, mais nous sommes rentrées deux semaines après.
Maman m’a dit qu’elle n’avait vraiment pas le choix : elle ne pouvait
pas nous nourrir seule. Lorsque j’avais onze ans, j’ai dit à un de mes
cousins que mon beau-père me battait. Maman a fait mes bagages et ceux
de mes sœurs et nous a emmenées quelques jours ailleurs, mais une
nouvelle fois mon beau-père a juré qu’il ne recommencerait plus, et une
nouvelle fois nous sommes revenues après quelques semaines. J’ai cessé
de parler pendant un moment, et n’ai qu’un vague souvenir des deux
années qui ont suivi.
Mon beau-père travaillait comme vendeur itinérant, ma mère comme
serveuse, blanchisseuse, cuisinière, ou ouvrière pour emballer les
fruits. Je n’ai jamais pu comprendre, vu qu’ils travaillaient si dur et
tant d’heures par jour, que nous n’ayons jamais assez d’argent, mais
c’était également le cas des frères et sœurs de maman qui trimaient dur
dans les minoteries et les aciéries. En fait mes parents y arrivaient
mieux que n’importe qui dans la famille. Mais par la suite mon beau-père
a été licencié et nous avons touché le fond – des mois de cauchemar avec
les huissiers à la porte, les meubles repris, et les chèque en bois. Mes
parents ont monté une combine pour qu’on croie que mon beau-père nous
avait abandonnées, mais en réalité il est descendu en Floride, a eu un
nouveau travail, et nous a loué une maison. Il est revenu avec un camion
U-Haul en pleine nuit, a emballé nos affaires, et nous a emmenées vers
le Sud.
La nuit où nous avons quitté la Caroline du Sud, ma maman s’est penchée
vers la banquette arrière de sa vieille Pontiac et nous a promis à nous
les filles : « Ce sera mieux là-bas. » Je ne sais pas si nous l’avons
crue, mais je me revois traversant la Géorgie au petit matin, regardant
les collines d’argile rouge et la végétation de mousse tirant vers le
gris s’éloigner dans la lunette arrière. Je n’arrêtais pas de regarder
le camion derrière nous, ridiculement petit pour contenir tout ce que
l’on possédait. Maman n’avait rien emballé qui ne fût déjà remboursé en
totalité, ce qui voulait dire qu’elle n’avait que deux choses de
valeur : sa machine à laver et sa machine à coudre, toutes deux
solidement attachées aux parois du camion. Pendant le trajet j’imaginais
un accident qui aurait éventré le camion, éparpillant les vieux habits
et brisant la vaisselle sur le macadam.
Je n’avais que treize ans. Je voulais qu’on reparte de zéro, recommencer
comme des gens nouveaux sans traces du passé. Je voulais fuir ce que
l’on avait vu de nous, ce que nous avions été. Ce désir, je l’ai senti
chez d’autres membres de ma famille. C’est la première chose à laquelle
je pense quand des problèmes surgissent – la solution géographique.
Changer ton nom, quitter la ville, disparaître, te refaire. Ce qui se
cache derrière cette pulsion, c’est la conviction que la vie que vous
avez vécue, la personne que vous êtes n’ont pas de valeur, qu’il vaut
mieux les abandonner, que fuir est plus facile que d’essayer de changer
les choses, que changer soi-même n’est pas possible. Parfois je me dis
que c’est cette conviction – plus séduisante que l’alcool ou la
violence, plus subtile que la haine du sexe ou l’injustice entre les
genres – qui a dominé ma vie et rendu tout vrai changement si difficile
et douloureux.
Déménager en Floride n’a pas amélioré nos vies. Cela n’a pas fait cesser
la violence de mon beau-père, ni soulagé ma honte, ni rendu ma mère
heureuse. Une fois là-bas, nos vies ont été régies par la maladie de ma
mère et les factures des soins médicaux. Elle avait subi une
hystérectomie lorsque j’avais environ huit ans, ainsi qu’une série
d’hospitalisations pour des ulcères et un problème de dos chronique.
Tout au long de mon adolescence elle a par superstition refusé que
quiconque prononce le mot cancer. Lorsqu’elle n’était pas malade,
maman et mon beau-père allaient au travail, luttant pour rembourser ce
qui semblait être une insurmontable montagne de dettes.
Avant que j’ai quatorze ans, mes sœurs et moi avions trouvé des moyens
pour décourager la plupart des avances sexuelles de mon beau-père. Nos
efforts se sont trouvés secondés lorsqu’il a été examiné par un
psychothérapeute après qu’il eut un accès de colère au travail et qu’on
lui eut prescrit des médicaments qui le rendaient renfrogné mais moins
violent. Nous avons grandi rapidement, mes sœurs prenant le chemin
d’abandonner l’école tandis que j’avais de bonnes notes et passais le
plus d’examens possible en vue d’obtenir une bourse. Je fus la première
personne de la famille à avoir le bac, et le fait que je poursuive mes
études a été une véritable surprise.
Nous imaginons tou·tes que nos vies sont normales, et je ne savais pas
que la mienne n’était pas celle de tout le monde. C’est en Floride que
j’ai commencé à comprendre combien nous étions différent·es. Les gens
que nous rencontrions là-bas n’avaient pas été façonnés par la structure
de classe rigide qui dominait le Piémont de Caroline du Sud. La première
fois que j’ai regardé mes camarades de collège et que j’ai pris
conscience que je ne savais pas qui ils étaient – non seulement en tant
qu’individus mais en tant que catégorie, qui étaient leurs semblables et
comment ils se voyaient eux-mêmes – j’ai aussi pris conscience qu’ils ne
me connaissaient pas. À Greenville, tout le monde connaissait ma
famille, tout le monde savait qu’on était de la racaille, et cela
voulait dire qu’on serait sûrement pauvres, qu’on aurait sûrement des
boulots lugubres et mal payés, qu’on tomberait enceintes pendant notre
adolescence, et qu’on ne finirait jamais l’école. Mais la Floride dans
les années soixante était pleine de fuyards et d’immigrant·es, et notre
école de la banlieue ouvrière majoritairement blanche nous classait non
pas d’après le revenu et les origine familiales, mais d’après des tests
d’intelligence et d’aptitude. Soudain j’ai été propulsée sur la voie
menant aux études supérieures, et si l’on me méprisait pour mon talent
inexistant en société, ma garde-robe lamentable et mon long accent
traînant, il y avait également quelque chose que je n’avais jamais connu
avant : un anonymat protecteur, ainsi qu’une sorte de respect et de
curiosité réticents concernant mon avenir. Parce qu’ils ne voyaient pas
la pauvreté et le désespoir comme une issue courue d’avance pour moi,
j’ai pu commencer à imaginer d’autres avenirs pour ma vie.
Dans ce pays, nous étions inconnu·es. Le mythe du pauvre s’était posé
sur nous et nous donnait du prestige. Je le voyais dans les yeux de mes
professeur·es, dans ceux du représentant du Lion’s Club qui avait payé
mes nouvelles lunettes, et dans ceux de la femme de la Junior League qui
me parlait de la bourse que j’avais obtenue. C’était mieux, beaucoup
mieux, d’être une pauvre mythique que de faire partie des ils que
j’avais connus avant. J’ai aussi fait l’expérience d’un nouveau niveau
de peur, la peur de perdre ce qui auparavant n’aurait jamais été
imaginable. Ne me laissez pas perdre cette chance, priais-je, vivant
dans la terreur que l’on ne me voie à nouveau comme je me connaissais
moi-même.
Adolescente, je trouvais que la fuite de ma famille de Caroline du Sud
ressemblait à un mauvais film. Nous avons fui comme des esclaves
auraient pu le faire, avec le shérif arrêtant mon beau-père dans le rôle
du garde-frontière imaginaire. Je suis sûre que si nous étions resté·es
en Caroline du Sud, j’aurais été prise au piège de la misère héritée de
ma famille, avec la prison, des enfants sans père – et que même être
intelligente, obstinée, et lesbienne n’y aurait rien changé.
Ma grand-mère est morte lorsque j’avais vingt ans, et après que maman
fut allée à la maison pour l’enterrement j’ai fait une série de rêves
dans lesquels nous vivions toujours à Greenville, en bas de la rue où
était morte mamie. Dans mes rêves, j’avais deux enfants et un seul œil,
je vivais dans une caravane, et je travaillais dans une filature. La
plus grande part de mon temps consistait à me demander quand je me
déciderais à nous tuer, moi et mes enfants. Les rêves étaient si vivants
que je me suis persuadée qu’ils étaient littéralement la vie que
j’aurais eue, et j’ai commencé à travailler plus pour mettre autant de
distance que possible entre ma famille et moi. J’ai copié les tenues,
les manières, les attitudes et les ambitions des filles que je
rencontrais à la fac, changeant ou cachant mes propres goûts, centres
d’intérêt et désirs. J’ai gardé mon lesbianisme secret, m’abritant
derrière l’amitié d’un garçon efféminé, ce qui nous arrangeait tou·tes
les deux. J’expliquais à mes amies que je rentrais rarement à la maison
parce que mon père et moi nous disputions trop pour que je me sente bien
chez lui. Mais ce n’était qu’une partie de la raison pour laquelle
j’évitais de rentrer à la maison, la raison la plus commode. La vérité
c’est que j’avais peur de ce que je pourrais devenir en rentrant chez ma
maman, la femme des fameux rêves – odieuse, violente et désespérée.
Il est dur d’expliquer que j’ai fui ma propre vie de façon si délibérée
et minutieuse. Je n’avais pas oublié d’où je venais, mais je serrais les
dents et je le cachais. Lorsque ma bourse n’a plus été suffisante pour
payer mes études supérieures, j’ai passé un an de travail acharné à
faire des salades, à être professeure remplaçante ou femme de chambre.
J’ai finalement trouvé un job après avoir accepté d’être parachutée
n’importe où, là où les services de la Sécurité Sociale avaient besoin
d’une employée. Une fois que j’ai eu un travail et une place fixe, je
suis devenue active sur le plan politique et aussi dans ma vie sexuelle,
rejoignant l’équipe de volontaires de la Maison des femmes, et tombant
amoureuse d’une série de femmes de la classe moyenne qui pensaient que
mon accent et mes histoires étaient profondément charmants. Ce que je
leur racontais au sujet de ma famille, de la Caroline du Sud, sur le
seul fait d’être pauvre, tout cela n’était que des mensonges, savamment
mis bout à bout pour paraître drôles ou amusants. Je savais trop bien
que personne ne voulait entendre la vérité sur la pauvreté, le désespoir
et la crainte, le sentiment que rien de ce que je faisais ne changerait
rien, ou le ressentiment furieux qui couvait sous mes plaisanteries.
Même lorsque avec ma petite amie nous avons formé une famille lesbienne
alternative, partageant ce que nous pouvions de nos ressources, j’ai
maintenu la vérité sur mes origines et celle que je me savais être dans
un flou précautionneusement mystérieux. J’ai travaillé très dur pour
devenir une nouvelle personne, une lesbienne activiste radicale bien
dans sa tête, et j’ai totalement cru qu’en me recréant moi-même j’aidais
à refaire le monde.
Durant une dizaine d’années, je ne suis jamais retournée à la maison
pour plus de quelques jours à chaque fois.
Lorsque dans les années quatre-vingt j’ai rencontré par hasard le
concept de sexualité féministe, je ne savais pas véritablement ce qu’il
véhiculait. Bien que j’aie été, et sois encore, féministe, que je me
sois engagée à réclamer le droit de gérer mes désirs sexuels sans placer
ces désirs sous la coupe d’une société qui a peur du sexe, les demandes
d’explication ou de justification de mes fantasmes sexuels m’ont
embarrassée. Comment chacune explique-t-elle ses pulsions sexuelles ?
La guerre des sexes est terminée, m’a-t-on dit, et ça me donne toujours
envie de demander qui l’a gagnée. Mais mon sens de l’humour paraîtrait
sans doute un peu obscur à des femmes qui ne se sont jamais senties
menacées par la manière dont la plupart des lesbiennes pensent et
utilisent les termes pervers et queer. J’utilise le terme queer pour
signifier plus de choses qu’avec celui de lesbienne. Depuis que je l’ai
utilisé pour la première fois en 1980 j’ai toujours pensé qu’il
impliquait que j’étais non seulement une lesbienne mais aussi une
lesbienne fem transgressive – passive, masochiste, aussi sexuellement
agressive que les femmes que je recherche, et aussi pornographique dans
mon imaginaire et mes activités sexuelles que la pensée hétérosexuelle
dominante l’a toujours cru.
Ma tante Dot plaisantait : « Il y a deux ou trois choses que je sais
parfaitement, mais jamais les mêmes et pas aussi parfaitement que je le
voudrais. » Ce que je sais assurément c’est que la classe sociale, le
genre, l’orientation sexuelle, et les préjugés – raciaux, ethniques, et
religieux – forment un maillage complexe qui façonne et place des
barrières dans notre vie et que la résistance à la haine n’est pas un
acte simple. Clamer son identité dans le creuset de la haine et résister
à cette haine est infiniment compliqué et, pire, presque impossible à
expliquer.
Je sais que j’ai été haïe parce que j’étais lesbienne, à la fois par la
« société » et le milieu plus intime de ma famille au sens large, mais
j’ai été également haïe ou méprisée (ce qui est d’un certain côté plus
fragilisant et insaisissable que la haine) par des lesbiennes dont le
comportement et les pratiques sexuelles avaient été forgées par leur
classe sociale. Mon identité sexuelle est intimement façonnée par ma
classe sociale et ma région d’origine, et la haine dirigée contre mes
préférences sexuelles est pour une grande part dirigée contre mon milieu
social – bien que beaucoup de gens, les féministes en particulier,
aiment prétendre que ce n’est pas un facteur. Le genre de femmes qui
m’attire est invariablement le genre de femmes qui embarrasse les
lesbiennes féministes politisées et respectables des classes moyennes.
Mon idéal sexuel est butch, exhibitionniste, doté d’un physique
agressif, c’est une femme plus intelligente qu’elle ne veut le faire
croire, et fière d’être traitée de perverse. Le plus souvent elle fait
partie de la classe ouvrière, elle a une aura de danger et un humour
plein d’ironie. Beaucoup de nos contemporain·es prétendent faire preuve
d’une grande tolérance sexuelle, mais le fait que ma sexualité soit
construite au cœur du fétichisme cuir, et autour de dynamiques
butch/fem, est largement considéré avec du dégoût ou une haine
catégorique.
Tout une partie de ma vie on m’a supposée malavisée, abîmée par
l’inceste et les abus sexuels de mon enfance, me livrant délibérément à
des pratiques sexuelles haïssables et dégradantes dans le souci égoïste
de me concentrer sur ma seule satisfaction sexuelle. On s’attendait à ce
que j’abandonne mes désirs pour devenir la femme normalisée qui flirte
avec le fétichisme, qui s’amuse à renverser les rôles et devise avec
humour ou un léger mépris sur les catégories historiques de désirs
déviants mais n’en prend aucune suffisamment au sérieux pour revendiquer
une identité sexuelle basée sur ces catégories. Il était déjà assez dur
de me débarrasser de ces exigences quand elles étaient formulées par la
société straight. Cela devenait consternant lorsque ces mêmes exigences
étaient formulées par d’autres lesbiennes.
Une des forces que je tire de mon milieu social est l’habitude du
mépris. Je sais que je n’ai aucune chance de devenir ce que mes
détracteurs espèrent de moi, et je crois que même la tentative de leur
plaire ne récolterait que leur mépris, et le mien par la même occasion.
Néanmoins, la relation entre la vie que j’ai vécue et la façon dont
cette vie est perçue par les autres a toujours invité à une sorte de
fantasme m’automythifiant. Il a toujours été tentant pour moi de faire
jouer les stéréotypes et les idées fausses de la culture dominante,
plutôt que de décrire une difficile et parfois douloureuse réalité.
J’essaie de comprendre comment nous intériorisons les mythes de notre
société même lorsque nous leur résistons. J’ai eu la tentation très
forte d’écrire au sujet de ma famille une sorte de conte moral, nous
dans le rôle des héros et les classe moyennes et supérieures dans celui
des vilains. Cela aurait fait partie du mythe romantique, par exemple,
de prétendre que nous étions ces nobles blancs du Sud dépeints dans les
films, travaillant au moulin depuis des générations et sortant du droit
chemin à cause de l’alcoolisme, d’une tendance familiale à la rébellion
et aux discussions syndicales. Mais cela aurait été un mensonge. La
vérité c’est que personne dans ma famille n’a jamais été syndiqué.
Poussé à la limite, le mythe du pauvre placerait ma famille au-dessus
des organisations syndicales et des personnes brisées par l’échec des
syndicats. Pour ma famille, les leaders syndicaux, comme les
prédicateurs, étaient d’une autre classe, suspecte et haïe autant
qu’admirée pour ce qu’elle essayait d’accomplir. Nominalement baptiste
du Sud, aucun membre de ma famille ne prêtait attention dans les faits
aux prédicateurs, et seul·es les enfants allaient au catéchisme. Une
croyance sérieuse en quoi que ce soit – toute idéologie politique,
système religieux, ou théorie sur le sens ou le but de la vie – était
jugée irréaliste. C’était une attitude qui m’a beaucoup gênée lorsque
j’ai commencé à lire les romans socialement engagés que je trouvais au
rayon livres de poche aux alentours de onze ans. J’aimais
particulièrement les romans de Sinclair Lewis et je voulais imaginer ma
famille faisant partie de la lutte ouvrière.
« Nous n’étions pas des suiveurs », m’a dit ma tante Dot avec un sourire
lorsque je lui ai parlé des syndicats. Mon cousin Butch a rigolé, m’a
dit que les syndicats faisaient payer de cotisations, et a dit :
« Diable, on arrive même pas à nous faire mettre un sou à la quête.
J’vais pas en donner aux syndicats. » J’ai trouvé dommage que la seule
chose en laquelle ma famille croyait de tout cœur fût la chance et les
caprices du destin. Ils avaient l’intime conviction que le plus prudent
et le plus admirable était de garder son sens de l’humour, de ne jamais
pleurnicher ni trembler, et de faire confiance à la chance, qui pourrait
un jour tourner. Le fait que je devienne une activiste politique dotée
d’une ferveur presque religieuse fut ce qui a le plus scandalisé ma
famille et la communauté ouvrière du Sud dont elle faisait partie.
De façon similaire, ce n’est pas ma sexualité, mon lesbianisme, que ma
famille a trouvé le plus rebelle ; durant la plus grande partie de ma
vie, personne excepté ma maman n’a pris mon orientation sexuelle très au
sérieux. Non, c’était ce que je pensais au sujet du travail, de
l’ambition, et du respect de soi-même. Les femmes de ma famille étaient
serveuses, filles de comptoir ou ouvrières dans des blanchisseries.
J’étais la seule qui aie travaillé comme bonne, une chose que je n’ai
dite à aucun d’eux. Ils auraient été en colère s’ils l’avaient appris.
Pour eux le travail c’était le travail, quelque chose de nécessaire. Tu
faisais ce que tu avais à faire pour survivre. Ils ne tiraient pas
autant de fierté de leur travail que de leur capacité à endurer le dur
travail et les mauvaises passes. En même temps, ils maintenaient qu’il y
avait certaines formes de travail, dont celui de femme de chambre, qui
étaient seulement pour les Noirs, pas pour les blancs, et alors que je
ne partageais pas cette opinion je savais qu’elle faisait
intrinsèquement partie de la façon dont ma famille voyait le monde.
Quelquefois j’avais l’impression d’être à cheval sur les deux cultures
sans appartenir à l’une ou à l’autre. Je serrais les dents face au
racisme indiscutable de ma famille et continuais à respecter leur
patience pleine de pragmatisme. Mais de plus en plus, en vieillissant,
ce que j’ai ressenti c’est une profonde brouille de mes sentiments
affectifs due à leur vue sur le monde, et graduellement une honte qui
leur a été totalement incompréhensible.
« Tant qu’il y a des restaurants pour manger, tu peux toujours trouver
du travail », me disaient ma mère et mes tantes. Puis elles ajoutaient :
« On peut se faire un peu plus avec un sourire. » Il est évident qu’il
n’y avait rien de honteux derrière cela, ce sourire attendu derrière le
comptoir, ce sourire triste lorsque vous n’aviez pas le loyer, ou la
façon mi-provocante, mi-implorante de ma maman de couvrir de
gentillesses le patron du magasin pour obtenir un petit crédit. Mais je
détestais ça, je détestais le besoin que l’on avait qu’elle le fasse, et
la honte qui suivait chaque fois que je le faisais moi-même. Pour moi
c’était de la mendicité, une quasi-prostitution que je méprisais, alors
même que je continuais à compter dessus. Après tout, j’avais besoin
d’argent.
« Fais juste un sourire », plaisantaient mes cousines, et je n’aimais
pas ce qu’elles voulaient dire. Après mes études supérieures, lorsque
j’ai commencé à subvenir à mes besoins et à étudier les théories
féministes, je suis devenue plus méprisante que compréhensive à l’égard
des femmes de ma famille. Je me disais que la prostitution était une
profession qualifiée et que mes cousines n’étaient jamais que des
amatrices. Cela contenait une certaine part de vérité, bien que, comme
tout jugement sévère rendu de l’extérieur, il fît l’impasse sur les
conditions dans lesquelles on en était arrivées là. Les femmes de ma
famille, y compris ma mère, avaient des papas-gâteaux, pas des jules,
des hommes qui leur glissaient de l’argent parce qu’elles en avaient
terriblement besoin. De leur point de vue elles étaient gentilles avec
ces hommes parce qu’ils étaient gentils avec elles, et ce n’était jamais
un arrangement direct et grossier au point de mettre un prix sur leurs
faveurs. Elles n’auraient d’ailleurs jamais décrit ce qu’elles faisaient
comme étant de la prostitution. Rien ne les mettait plus en colère que
de suggérer que les hommes qui les aidaient le faisaient uniquement pour
leurs faveurs. Elles travaillaient pour vivre, juraient-elles, mais ça
c’était différent.
Je me suis toujours demandé si ma mère détestait son papa-gâteau, ou
sinon lui, son besoin à elle de ce qu’il lui offrait, mais dans mon
souvenir cela n’apparaît pas. C’était un vieil homme, à moitié infirme,
hésitant et dépendant, et il traitait ma maman avec énormément de
considération et, oui, de respect. Leur relation était douloureuse, et
comme ni mon beau-père ni elle ne gagnaient assez d’argent pour faire
vivre la famille, maman ne pouvait pas refuser l’argent de son
papa-gâteau. En même temps cet homme ne donnait aucune indication comme
quoi cet argent servait à acheter à maman ce qu’elle n’aurait pas
normalement offert. La vérité, je crois, est qu’elle l’aimait
sincèrement, et que cela était partiellement dû au fait qu’il la
traitait si bien.
Même maintenant, je ne suis pas sûre qu’ils avaient des relations
sexuelles. Maman était une jolie femme, et elle était gentille avec lui,
une gentillesse dont évidemment personne n’avait fait preuve envers lui
durant sa vie. De plus, il prenait grand soin de ne lui causer aucun
problème avec mon beau-père. En tant qu’adolescente, avec le mépris des
adolescentes pour les entorses à la morale et les complexités sexuelles
quelles qu’elles soient, j’étais persuadée que les relations entre ma
maman et ce vieil homme étaient méprisables. Et aussi, que jamais je ne
ferais une chose pareille. Mais la première fois qu’une petite amie m’a
donné de l’argent et que je l’ai pris, tout a bougé dans ma tête. Le
montant n’était pas élevé pour elle, mais pour moi il l’était et j’en
avais besoin. Alors que je ne pouvais le refuser, je me suis haïe de le
prendre et je l’ai haïe de me le donner. Pire, elle montrait moins de
bonne grâce à l’égard de mes besoins que papa-gâteau n’en avait montré
envers maman. Tout le mépris amer que j’éprouvais envers mes tantes et
mes cousines dans le besoin s’est déchaîné et a consumé l’amour que
j’éprouvais pour elle. J’ai rapidement mis un terme à notre relation,
incapable de me pardonner d’avoir vendu ce qui, estimais-je, ne devait
être qu’offert librement – pas le sexe mais l’amour lui-même.
Lorsque les femmes de ma famille disaient combien elles travaillaient
durement, les hommes crachaient sur le côté et secouaient la tête. Les
hommes avaient de vrais métiers – des travaux durs, dangereux, qui
réclamaient de la force physique. Ils allaient en prison, et pas
seulement ceux qui n’avaient pas froid aux yeux, les garçons insouciants
qui me faisaient peur avec leurs manières brutales, mais leurs frères
plus doux et gentils. C’était de famille ça aussi, c’est ce que
prédisaient les gens au sujet des proches de ma mère, ou de mes proches.
« Son papa est celui qui a fait de la prison en Géorgie, et son oncle
aussi. Probablement, il est bien pareil », entendait-on dire au sujet de
garçons si jeunes qu’ils avaient encore leurs dents de lait. Nous
allions toujours dans des fermes d’État voir quelqu’un, un oncle, un
cousin, ou une relation sans nom. La tête rasée, mornes et sonnés, ils
pleuraient sur l’épaule de maman ou suppliaient mes tantes de les aider.
« J’ai rien fait, maman », disaient-ils, et cela était peut-être vrai,
mais si même nous nous ne les croyions pas, qui les aurait crus ?
Personne ne disait la vérité, pas même combien leurs vies étaient
détruites.
Un de mes cousins préférés a fait de la prison quand j’avais huit ans,
pour avoir fracturé une cabine de téléphone publique à pièces avec un
autre garçon. L’autre garçon fut renvoyé à la garde de ses parents. Mon
cousin fut envoyé au département garçons de la ferme d’État. Après trois
mois, ma maman nous a emmenées lui rendre visite, avec un gros paquet de
poulet frit, du maïs froid, et de la salade de pommes de terre. Avec une
centaine d’autres nous nous sommes assis·es sur la pelouse avec mon
cousin et l’avons regardé manger comme s’il n’avait pas eu de repas
complet depuis trois mois. Je vis sa tête presque rasée et ses oreilles
marquées par une fine cicatrice bleue témoignant d’une coupe sans
ménagement. Les gens riaient, il y avait de la musique, et un homme
grand, paresseux, en uniforme, est passé à côté de nous en mâchonnant un
cure-dents et en nous examinant de près. Mon cousin a gardé la tête
baissée, le visage rempli de haine, et n’a regardé le surveillant que
lorsqu’il s’était retourné.
« Les fils de putes », a-t-il murmuré, ma maman lui a fait « Chut ! ».
Nous étions tou·tes assis·es sans bouger lorsque le garde a fait
volte-face. Il y a eu un long moment de calme, puis l’homme a déridé son
visage pour faire un grand sourire.
« Oui, oui », a-t-il dit. C’est tout ce qu’il a dit. Puis il s’est
éloigné. Aucun·e de nous n’a parlé. Aucun·e de nous n’a mangé. Il est
retourné à l’intérieur peu de temps après, et nous sommes parties. De
retour dans la voiture, ma mère s’est assise pour pleurer en silence. La
semaine d’après, mon cousin a eu un rapport pour bagarre et sa détention
a été prolongée de six mois.
Mon cousin avait quinze ans. Il n’est jamais retourné à l’école, et
après la prison il n’a pas pu intégrer l’armée. Quand par la suite il
est rentré à la maison, nous n’en n’avons jamais parlé, nous n’en avons
jamais eu besoin. Je savais sans le demander que le garde avait eu sa
petite revanche, et je savais aussi que mon cousin fracturerait à
nouveau une cabine téléphonique dès qu’il le pourrait mais le ferait
discrètement et sans se faire prendre. Je connaissais, sans demander la
cause de sa fureur, ce qu’il ressentait à l’égard des gens propres, bien
habillés, méprisants, qui le regardaient comme si sa vie ne comptait pas
plus que celle d’un chien. Je le savais parce que je le ressentais moi
aussi. Le garde nous avait regardées, maman et moi, avec la même
expression que pour notre cousin. Nous étions des ordures. Nous étions
ceux pour lesquels ils construisaient les fermes d’État. Le garçon
qu’ils ont renvoyé chez ses parents était le fils d’un diacre, le
directeur du magasin d’électroménager.
Autant j’ai haï cet homme, et son fils, autant d’une certaine façon j’ai
haï mon cousin aussi. Il aurait dû savoir, je me disais, les risques
qu’il encourait. Il aurait dû faire plus attention. Lorsque j’ai grandi
et commencé à vivre ma propre vie, c’était une rengaine que je me
répétais plus furieusement qu’à mon cousin. Je savais qui j’étais, je
savais que la chose la plus importante à faire était de me protéger et
de cacher mon identité méprisable, fondue dans le mythe du bon pauvre et
de la lesbienne raisonnable. Quand je suis devenue militante féministe,
cette litanie résonnait dans ma tête, avec, en note de fond, quelque
chose de tellement ancré et omniprésent que je ne l’entendais plus, même
lorsque tout ce que je faisais était à son diapason.
En 1975, je gagnais péniblement ma vie en étant l’assistante d’un
photographe de Tallahassee, en Floride. Mais le vrai travail de ma vie
était mon activisme lesbien féministe, le travail que j’ai réalisé avec
la maison des femmes locale et le comité pour créer un programme
d’études féministes à l’université d’état de Floride. Mon rôle
consistait en partie, c’est comme ça que je le voyais, à être une
lesbienne féministe évangélique, et à aider à développer une analyse
politique de cette société qui haïssait les femmes. Je ne parlais pas de
classe, ou seulement pour reconnaître pour la forme que nous devions y
penser, de la même façon, pensais-je, que nous devions toutes réfléchir
au racisme. J’étais une personne décidée, vivant au sein d’un collectif
de lesbiennes – toutes jeunes, blanches et sérieuses – étudiant chaque
nouveau livre qui avait pour but de s’adresser aux féministes, conduite
par ce que je voyais comme un besoin de révolutionner le monde.
Des années plus tard, il est difficile de faire comprendre à quel point
ma vie me semblait raisonnable à cette époque. Je n’étais pas
désinvolte, ni sciemment condescendante, ni inconsciente de la dureté
d’une lutte remodelant les relations sociales, mais comme tant de femmes
de ma génération je croyais dur comme fer que je pourrais changer
quelque chose avec ma vie, et j’étais décidée à donner ma vie pour
tenter de changer quelque chose. Je m’attendais à des moments
difficiles, à de longues et lentes périodes de sacrifices et de corvées,
je m’attendais à être haïe et attaquée en public, à avoir à laisser mes
désirs personnels, mes amours, ma famille de côté afin de faire partie
de quelque chose de mieux et de plus important que mes préoccupations
individuelles. En même temps, je travaillais furieusement à prendre plus
au sérieux mes désirs, ma sexualité, mes besoins de femme et de
lesbienne. Je pensais que je menais une révolution politique personnelle
à tout moment, que je nettoie à la brosse le sol de la crèche, que je
trouve un budget pour que l’université achète une collection de livres
sur les femmes, que je participe à l’édition du magazine féministe local
ou à la création d’une librairie des femmes. Que je sois constamment
épuisée et n’aie pas d’assurance santé, que je fasse pendant des heures
un travail monotone et non rémunéré, ou encore que je m’éloigne
furtivement du collectif pour des rendez-vous avec des femmes butchs que
mes colocataires jugeaient rétrogrades et sexistes, tout cela n’a jamais
perturbé mon engagement total dans la révolution féministe. Je ne vivais
pas dans une bulle : j’avais compartimenté ma pensée à un tel point que
je ne me demandais jamais ce que je faisais ni pourquoi. Et je n’ai
jamais admis ce qui sous-tendait mes convictions féministes – une
incrédulité face au changement, imprégnée par ma classe, une peur
secrète qu’un jour on ne me découvre comme j’étais réellement, que l’on
me découvre et me rejette. Si je n’avais pas été élevée dans l’idée de
donner ma vie, aurais-je fait une aussi bonne révolutionnaire, efficace
et sacrifiée ?
Ma concentration étroitement limitée de révolutionnaire n’a bougé que
lorsque je me suis remise à écrire. L’idée d’écrire des histoires
paraissait frivole tant il restait à faire, mais tout a changé lorsque
je me suis retrouvée confrontée à des émotions et à des idées qui ne
pouvaient être expliquées plus tard ou attendre l’après-révolution. Cela
s’est passé de façon simple et inattendue. Une semaine, on m’a demandé
de parler devant deux groupes complètement différents : un cours de
catéchisme épiscopalien et un centre de détention pour mineures. Les
épiscopaliennes étaient toutes blanches, bien habillées, s’exprimaient
extrêmement clairement et facilement, étaient bien élevées, et voulaient
à tout prix savoir (sans me le demander directement) comment ça se passe
deux-femmes-qui-couchent-ensemble. Les délinquantes étaient toutes des
femmes, à quatre-vingts pour cent Noires et Hispaniques, elles portaient
des robes-uniformes vertes ou des jeans et des blouses, étaient
grossières, ignorantes, n’avaient peur de rien, et étaient tout aussi
déterminées à savoir ce qui se passe entre deux femmes dans un lit.
J’ai essayé de m’amuser avec les épiscopalien·nes, les titillant sur
leurs peurs et leur anxiété, et en étant d’une grande honnêteté en ce
qui concernait mes pratiques sexuelles. Le professeur de catéchisme, un
homme qui m’avait assurée de s·es idées libérales, rougissait et
bégayait au fur et à mesure que les questions sur la découverte, puis
l’expression de ma sexualité devenaient plus précises. Lorsque la
rencontre a été terminée j’ai marché dehors dans le soleil, irritée par
le mépris déguisé de leurs questions et, bien que je ne sache pourquoi,
si déprimée que je n’ai pas pu pleurer.
Les délinquantes furent une autre histoire. Effrontées, elles m’ont fait
rougir au bout des premières minutes, hurlant des questions qui étaient
d’une part de la curiosité et d’autre part une façon pour elles de
mettre en avant ce qu’elles savaient déjà. « T’es butch ou fem ? »,
« T’as jamais baisé avec des mecs ? », « T’as jamais eu envie ? », « Tu
veux des enfants ? », « Elle est comment ta copine ? ». J’ai fini par
craquer quand une fille, très grande et sûre d’elle, s’est levée et m’a
interpellée : « Hé, chérie ! Je vais sortir d’ici le week-end prochain.
Tu fais quoi ce soir-là ? » J’ai rigolé si fort que j’ai presque toussé.
J’ai rigolé jusqu’à ce que nous soyons toutes à ricaner ou hurler de
rire. Même être fouillée en partant n’a pas entamé ma bonne humeur. Je
souriais toujours lorsque j’ai rejoint ma copine dans le waterbed ce
soir-là, souriant jusqu’à ce qu’elle m’entoure de ses bras et que
j’éclate en sanglots.
J’ai compris alors, soudainement, tout ce qui était arrivé à mes
cousin·es et à moi-même, je l’ai compris avec une toute nouvelle et
déchirante perspective, où il était clair que j’avais été, et à quel
point, brutale avec ma famille et moi-même. J’ai saisi à nouveau combien
nous avions été rejeté·es et privé·es de tout, et que j’avais tout fait
pour ne pas avoir à y penser. J’avais appris comme une enfant que ce qui
ne pouvait pas être changé devait rester non dit, et pire, que celles et
ceux qui ne peuvent pas changer leur propre vie ont toutes les raisons
d’en avoir honte et de la cacher. J’avais accepté cette honte et y avais
cru, mais pourquoi ? Qu’est-ce que mes cousin·es ou moi-même avions fait
pour mériter le mépris qui nous était adressé ? Pourquoi nous avais-je
toujours cru·es méprisables par nature ? J’ai voulu parler à quelqu’un·e
de toutes les choses auxquelles je pensais cette nuit-là, mais je n’ai
pas pu. Parmi les femmes que je connaissais il n’y en avait pas une qui
aurait compris ce que j’avais dans la tête, il n’y avait pas de femme de
la classe ouvrière au sein du collectif où j’habitais. J’ai commencé à
me dire que nous ne partagions aucun langage pour parler de ces vérités
amères.
Les jours qui ont suivi, je me suis souvent rappelé cet après-midi à la
ferme d’État, ce sentiment d’être un animal dans un zoo, une chose que
l’on regarde et dont on rit, utilisée par les vraies personnes, celles
qui nous observent. Malgré ses convictions libérales, ce professeur de
catéchisme m’avait regardée avec les yeux du surveillant de la prison de
mon cousin. J’étais renvoyée à mon enfance, à toutes les peurs
auxquelles j’avais essayé d’échapper. Une nouvelle fois je me suis
sentie à la merci de ces gens importants qui savent s’habiller et
parler, à qui l’on accordera toujours le bénéfice du doute, pas comme
pour moi et ma famille.
J’ai ressenti une rage si ancienne que je n’ai pas pu analyser à quel
point elle avait déterminé ma vie. J’ai pris à nouveau conscience qu’à
certain·es on ne fait pas de quartier, on ne laisse pas de chance. Que
le courage, l’humour et l’amour de son prochain ne sont qu’une
plaisanterie pour ceux qui édictent les règles du jeu, et j’ai haï ceux
qui font ces règles. Enfin, j’ai reconnu que la plupart de mes maux
venaient du fait que je ne savais plus qui j’étais ni à quelle catégorie
j’appartenais. J’avais fui ma famille, refusé d’aller lui rendre visite,
et essayé par tous les moyens de me fabriquer un autre personnage.
Comment pouvais-je être issue de la classe ouvrière et avoir un diplôme
universitaire ? En étant militante lesbienne ? J’ai repensé aux gardiens
du centre de détention. Ils ne m’avaient pas regardée avec le même
regard vide que celui qu’ils adressaient aux filles venues m’écouter,
des filles trop proches de la vie que j’aurais dû vivre pour que je
puisse supporter de les affronter. Le mépris dans leur regard était lié
au fait que je sois lesbienne, un mépris différent mais pareil, car
toujours du mépris.
Tandis que je laissais éclater ma colère, ma copine me tenait, me
réconfortait, et essayait de me faire expliquer ce qui me faisait tant
souffrir, mais j’en étais incapable. Elle m’avait tant parlé des
relations difficiles qu’elle entretenait avec sa famille, avec son père
qui dirigeait sa propre affaire et qui continuait de lui envoyer un
chèque tous les mois. Elle ne savait presque rien sur ma famille, hormis
les blagues et quelques histoires soigneusement triées. Je me suis
sentie si seule et en danger dans ses bras que je n’aurais rien pu
expliquer du tout. Je pensais à ces filles du centre de détention et aux
histoires rapides et brutales qu’elles racontaient sur leurs sœurs,
leurs frères, leurs cousin·es et leurs amoureuxs·es. Je pensais aux
brèves allusions qu’elles faisaient à ce qu’elles avaient perdu,
n’évoquant jamais la perte de leur espoir, de leur propre futur, ou la
tournure douloureuse que prendrait leur vie quand elles seraient
libérées. Ayant séché mes larmes, j’étais allongée et je regardais ma
copine endormie tout en réfléchissant à ce que je n’avais pas été
capable de lui dire. Au bout de quelques heures, je me suis levée et
j’ai rédigé quelques notes en vue d’écrire un poème, une litanie
dépouillée et douloureuse sur la perte, formulée comme une conversation
entre deux femmes, l’une ne pouvant pas comprendre, et l’autre ne
pouvant pas tout dire.
Il m’a fallu du temps pour transformer ce poème, violent cri de douleur
et de rage, en une histoire qui m’expliquait quelque chose que je
n’avais jamais voulu voir de près – le processus de la fuite, de
l’enfermement sur soi-même, de la dissimulation. Il m’a fallu presque
toute la vie pour comprendre cela, pour voir comment et pourquoi celles
et ceux d’entre nous qui sont né·es pauvres et différent·es sont
conduit·es à se perdre ou à se trahir, mais surtout, à simplement
disparaître en tant que tel·les. Le temps que ce poème devienne
l’histoire River of Names, j’avais pris la décision d’inverser ce
processus : de parler de ma famille, de ma vraie histoire, et de dire la
vérité non seulement sur qui j’étais, mais également sur la tentation du
mensonge.
Le temps d’apprendre par moi-même les bases du storytelling à l’écrit,
j’ai su qu’il n’y aurait qu’une seule histoire qui me hanterait tant que
je n’aurais pas su comment la raconter – l’histoire compliquée,
douloureuse, de la façon dont ma maman m’avait, et ne m’avait pas,
sauvée quand j’étais petite fille. Écrire L’histoire de Bone[2]
devint, par la suite, un moyen de retrouver la fierté et la tragédie de
ma famille, ainsi que la sexualité assiégée et meurtrie que j’avais
bâtie sur des bases de violences et de viol.
La vie compartimentée que je m’étais créée vola en éclats à la fin des
années soixante-dix, après que j’ai eu commencé à écrire ce que je
pensais réellement de ma famille. J’en ai eu assez d’avoir peur de ce
que pensaient les femmes avec qui je travaillais, principalement des
lesbiennes, sur les femmes avec qui je couchais et sur ce qu’on faisait
au lit. Lorsqu’un schisme s’est créé dans mon réseau ; lorsque je n’ai
plus été capable de me dissimuler au sein de la communauté gouine
traditionnelle ; lorsque je n’ai plus pu continuer à justifier ma raison
d’être par un activisme politique permanent ou à me distraire en
couchant à droite et à gauche ; lorsque mes mœurs sexuelles légères, mon
orientation vers des dynamiques butch/fem, et mon exploration du sexe
sadomasochiste sont devenues en partie ce qui me poussait hors de la
communauté que je m’étais choisie, je suis revenue à la maison. Je suis
revenue pour ma mère et mes sœurs, pour les voir, pour parler, discuter,
et commencer à comprendre.
Une fois à la maison j’ai vu que, pour ma famille, les lesbiennes
étaient des lesbiennes, qu’elles portent des manteaux ou des blousons de
cuir. De plus, durant tout le temps où je n’avais pas fait la paix avec
moi-même, ma famille s’était arrangée pour faire la paix avec moi. Mes
copines étaient traitées comme des versions un peu plus bizarres que les
maris de mes sœurs, tandis que je restais tout simplement la sœur qui a
toujours été difficile mais qui faisait toujours partie de leur vie.
Cela a eu pour résultat de m’amener à m’interroger sur ce qui m’avait
rendue incapable de parler à mes sœurs pendant toutes ces années. J’ai
découvert qu’elles ne savaient pas non plus qui j’étais, et il fallu
beaucoup de temps et d’écoute entre nous pour redécouvrir mon sens de la
famille et mon amour pour elles.
C’est uniquement en tant qu’enfant issue de ma classe sociale et de mon
milieu familial que j’ai pu déterminer ce qui est pour moi une vision
politique qui signifie quelque chose, que j’ai pu retrouver un sens à
mon action militante, et que j’ai pu me rappeler l’importance de la
découverte de soi-même chez les lesbiennes. Il n’y a aucune analyse
féministe complète qui rende compte de la complexité avec laquelle notre
sexualité et le cœur de notre identité sont façonnés, ou encore de notre
façon de nous voir nous-mêmes comme faisant partie à la fois de la
famille qui nous a vues naître et de la famille élargie d’amies et
d’amantes que nous construisons invariablement au sein de la communauté
lesbienne. Pour moi, l’essentiel était devenu de résister à cette peur
omniprésente, à ce besoin de me cacher et de disparaître, de maquiller
ma vie, mes désirs, et la vérité sur le fait que nous comprenons
finalement si peu de choses – même lorsque nous essayons de transformer
le monde en un lieu plus juste et plus humain. Par-dessus tout, j’ai
essayé de comprendre la politique du eux, pourquoi l’être humain craint
et stigmatise celui qui est autre tout en redoutant secrètement d’être
lui-même un de ces autres. Classe, race, sexualité, genre – et toutes
les autres catégories dans lesquelles nous nous classons et nous
rejetons les un·es et les autres – ont besoin d’être raclées de
l’intérieur.
L’horreur de la société de classes, du racisme, et des préjugés, c’est
que des personnes commencent à croire que la sécurité de leur famille et
de leur communauté dépend de l’oppression des autres, que, pour que
quelque-un·es puissent vivre bien, il doit y en avoir d’autres dont les
vies sont tronquées et violentées. C’est une croyance qui prédomine dans
cette culture. C’est ce qui rend les blancs pauvres du Sud si
désespérément racistes, et les classes moyennes si méprisantes à l’égard
des pauvres. C’est un mythe qui permet à certain·es de croire qu’ils et
elles construisent leur vie sur les ruines de celle des autres : le
noyau secret de la honte des classes moyennes, un moteur et un éperon
pour la classe ouvrière marginale, et quelque chose qui touche
suffisamment les sans-abris et les pauvres pour qu’elles et ils ne
soient pas gêné·es par la haine et la violence. La puissance de ce mythe
apparaît d’autant plus lorsqu’on examine, au sein même des communautés
lesbiennes et féministes où nous avons pourtant porté une attention
particulière au problème de la marginalisation, combien il y a encore de
peur, d’exclusion, et de personnes qui ne se sentent pas en sécurité.
J’ai grandi dans la pauvreté, la haine, victime de violence physiques,
psychologiques et sexuelles, et je sais que souffrir ne rend pas noble.
Ça détruit. Pour résister à la destruction, à la haine de soi ou au
désespoir à vie, nous devons nous débarrasser de la condition de
méprisé·e, de la peur de devenir le eux dont ils parlent avec tant de
mépris. Nous devons refuser les mythes mensongers et les morales
faciles. Nous devons nous voir nous-mêmes comme des êtres humains, avec
des défauts, et extraordinaires. Nous tou·tes – extraordinaires.
[1] Irena Klepfisz, A Few Words in the Mother Tongue : Poems, Selected and Ne, Eigth Mountain Press, Portland, Oregon, 1990.
[2] Dorothy Allison, L’histoire de Bone, Éditions 10/18, Paris, 1999. Paru aux USA en 1992, sous le titre Bastard out of Carolina.